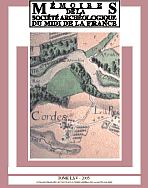
Mémoires
de la Société Archéologique
du Midi de la France
_____________________________________
Tome LXV (2005)
|
Mémoires |
BULLETIN DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE
2004-2005
établi par Patrice CABAU & Maurice SCELLÈS
Les parties non reproduites dans l'édition papier apparaissent en vert dans cette édition électronique.
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 269
SÉANCE DU 5 OCTOBRE 2004
Présents : Mme Pradalier-Schlumberger, Présidente,
MM. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Scellès, Secrétaire général, Mme Suau,
Bibliothécaire-Archiviste, MM. Cabau, Secrétaire-adjoint, Latour,
Bibliothécaire-adjoint ; Mme Napoléone, M. Bordes, le Père Montagnes, MM. Hermet,
Peyrusse, Pradalier, Prin, Mgr Rocacher, MM. Roquebert, Tollon, membres titulaires ;
Mmes Andrieu, Bayle, Bellin, Conan, membres correspondants.
Excusés : M. Cazes, Directeur, Mmes Cazes, Fournié, Labrousse, MM. Garland, Lapart.
La Présidente déclare ouverte l’année académique 2004-2005 en se réjouissant de partager le plaisir de nous retrouver tous régulièrement. Le programme de l’année est établi et mis en ligne sur notre site Internet, mais il souffrira des modifications : quelques changements sont déjà intervenus et il faut en particulier signaler qu’une séance supplémentaire aura lieu le 14 juin 2005.
La Présidente annonce à la Compagnie le décès de notre confrère Robert Gillis, survenu le 1er août, et celui d’André Soutou, qui n’était pas membre de notre Société mais que connaissaient nombre d’entre nous ; préhistorien, André Soutou avait beaucoup fouillé sur le Larzac.
Michèle Pradalier-Schlumberger signale
encore qu’après examen par le Bureau, quatre candidatures au titre de membre
correspondant seront présentées à la Compagnie lors d’une prochaine séance :
à celles de deux historiens anglais, M. et Mme Barber, se sont jointes les candidatures
de Mlles Karine Maziès et Géraldine Cazals, primées au printemps dernier.
La Présidente rappelle
enfin que les journées d’études consacrées à La maison en Languedoc et en
Catalogne à l’époque moderne se tiendront les 8 et 9 octobre prochains à
l’Hôtel d’Assézat.
Le Secrétaire général donne lecture du procès-verbal de la séance du 1er juin 2004, qui est adopté.
La Présidente rend compte de la
correspondance qui comprend de nombreuses invitations et annonces de colloques. En outre
M. Hervé Gras-Rascol remercie notre Société de l’aide qui lui a été apportée
dans ses recherches sur l’abbé Marcel Rascol ; il joint à son courrier une
notice biographique de l’abbé Rascol (1897-1964), devenu membre de notre Société
en 1943.
À l’invitation de
notre confrère Robert Manuel, ancien Président, et du Président actuel, Michèle
Pradalier-Schlumberger a représenté notre Société lors de la manifestation organisée
à l’occasion du centenaire de la Société des Amis du Vieux Cordes. M. Manuel a
rappelé avec beaucoup de chaleur le soutien moral et financier que la Société
Archéologique du Midi de la France avait alors apporté à Charles Portal, également
membre de notre Société.
Plusieurs dons viennent enrichir notre bibliothèque. Louis Peyrusse offre un exemplaire en très bon état du premier volume des Mémoires de notre Société, devenu très précieux, Michèle Pradalier-Schlumberger le volume Lumières de l’an mil en Orléanais. Autour du millénaire d’Abbon de Fleury, Brepols-Musée des Beaux-Arts d’Orléans, 2004, 279 p. Yves Cranga nous adresse le premier numéro de Polia, Revue de l’Art des Jardins, 160 p. Notre confrère explique que cette nouvelle revue, fondée à l’initiative d’anciens élèves de l’École de Versailles, vient combler un vide puisque aucune revue française ne traitait jusque-là de la dimension historique et patrimoniale des jardins ; la revue s’ouvrira aux jardins du monde entier, développera des rubriques d’actualité, prendra en compte le
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 270
paysage,
l’archéologie des jardins, les problématiques de restauration, etc. ; Yves
Cranga pense orienter ses propres recherches sur les mécanismes de patrimonialisation et
d’investigation du jardin historique.
La Présidente fait
circuler les bulletins de commande des actes des trois colloques qui se sont tenus à
Narbonne en 1990, 1992 et 1994 et édités par la Ville de Narbonne : Les vitraux
de Narbonne. L’essor du vitrail gothique dans le Sud de l’Europe, 136
p. ; Autour
des maîtres d’œuvre de la cathédrale de Narbonne. Les grandes églises
gothiques du Midi, sources d’inspiration et construction, 172 p. ; Autour du
palais des archevêques de Narbonne. Les arts picturaux en France méridionale et en
Catalogne du XIIIe au XVe siècle, 170 p.
La parole est au Père Bernard Montagnes pour sa communication :
« Une légende à laquelle il faut renoncer : la chasuble dite “du Père Lacordaire”
La plus belle pièce de la sacristie du couvent des Dominicains de Toulouse a été présentée dans quatre expositions publiques, au cours des vingt dernières années, comme la chasuble du Père Lacordaire, ainsi qu'elle est désignée par la tradition locale : en 1982, au musée des Augustins de Toulouse (Toulouse et l'art médiéval de 1830 à 1870, n° 283 du catalogue) ; en 1989, à la Mairie du 6e arrondissement de Paris (exposition intitulée Lacordaire, Dieu et la liberté, à l'occasion du colloque Lacordaire, son pays, ses amis et la liberté des ordres religieux pour le 150e anniversaire du rétablissement de l’Ordre en France) ; en 1999, au réfectoire des Jacobins de Toulouse (Toulouse sur les chemins de Saint-Jacques, n° 235 du catalogue et excellente photographie p. 260) ; le 12 mai 2002, au couvent des Dominicains de Rangueil, à Toulouse (pour commémorer le bicentenaire de la naissance de Lacordaire). Seules les expositions de 1982 et de 1999 ont donné lieu à la publication d'un catalogue, lequel comporte chaque fois une notice consacrée à notre chasuble. Autre forme de publicité encore reposant sur la même attribution : un cliché de Yan, Chasuble du Père Lacordaire, qui illustre le livre d’Albert Guittard, Le Père Lacordaire à Toulouse, Toulouse, Couvent des Dominicains, 1955, p. 66 (pour le centenaire du rétablissement des Dominicains à Toulouse) ; une carte postale éditée par le couvent des Dominicains de Rangueil dans les années 1980, intitulée Chasuble du Père Lacordaire (détail) : Saint Dominique.
Maurice Prin, auteur de la notice de 1982, estimait plausible l'attribution à Lacordaire, traditionnelle au couvent Saint-Romain de Toulouse (rue Espinasse) : “Visiblement inspiré par la chasuble ‘de saint Dominique’ conservée à Saint-Sernin, ce magnifique vêtement sacré fut offert au père Lacordaire par les dames du Tiers-Ordre dominicain de Toulouse, vraisemblablement pour l'inauguration de la chapelle de la rue Vélane (3 mai 1856) ou pour la fête de saint Dominique de la même année.” Le choix des saints personnages représentés est tout à fait toulousain et l’un d’entre eux fournit même un élément de datation : “Il s'agit des saints dont les reliques reposent dans la crypte de la basilique Saint-Sernin. L'inscription Beata Germana en fait un ouvrage contemporain de l'acte de la béatification (7 mai 1854).” Cet indice fournissait une fourchette chronologique assurée entre la béatification de 1854 et la canonisation de 1867.
Christine Aribaud, dans sa notice de 1999, examine la chasuble en spécialiste de la paramentique religieuse, en donne une description technique et dresse l'inventaire de tous les personnages identifiables (l'usure rendant quelques inscriptions illisibles). “Cette abondance de noms rend compte de l'hagiographie locale”, observation qui permet de conclure que ce vêtement liturgique “est un témoignage important d'un admirable travail de broderie locale identifiable grâce à son hagiographie”. Quant à la dénomination traditionnelle, Christine Aribaud s'en remet à la notice de Maurice Prin, qu'elle reprend, au conditionnel : “Ce vêtement aurait été offert au père Lacordaire, probablement en 1856.”
Que pouvait-on, alors, tenir pour assuré ? D'abord la provenance toulousaine, puisque les saints représentés sont pour leur plus grand nombre ceux dont les reliques reposent dans les cryptes de Saint-Sernin, avec pourtant une note spécifiquement dominicaine. Dominique et Thomas d'Aquin, il est vrai, appartiennent de plein droit à Toulouse, tandis que Albert le Grand, Pie V, Catherine de Sienne n'ont pas d'attache particulière avec Toulouse. Leur présence atteste un lien avec l'ordre dominicain, c'est-à-dire, supposait-on, avec Lacordaire. Ensuite la mention Beata Germana fournit une fourchette chronologique : après le 7 mai 1854 (date de la béatification), avant le 19 juillet 1867 (date de la canonisation), qui n'excluait pas la possession par Lacordaire.
Les choses en sont demeurées là jusqu'en mai 2002. À la suite de l'exposition du 12 mai, deux documents nouveaux sont venus clarifier le débat. Tout d'abord celui communiqué par la sœur Marie de Jésus, archiviste de Prouille. La chronique du monastère, que la sœur était en train d'étudier, faisait mention en 1936 de notre chasuble. Le couvent de Toulouse confiait aux sœurs de Prouille, le mardi 21 janvier 1936,
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 271
CHASUBLE « DU PÈRE LACORDAIRE », schéma iconographique.
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 272
deux chasubles précieuses à réparer. “La plus belle des deux chasubles, note la chronique du 21 janvier, fut offerte au Père Lacordaire par un prêtre de Toulouse. Les artistes sont inconnus.” Le 22 juillet suivant, les réparations étant achevées, le vêtement peut retourner à Toulouse. “La chasuble sera d'un port plus aisé [la forme des épaules étant légèrement modifiée, sans nuire au riche dessin à fleurs et à personnages] et les bonnes demoiselles qui l'ont conçue et exécutée avec tant d'art et tant d'amour tressailliront dans leur éternité de voir mieux apprécié le travail de leurs mains. Car elles ont signé leur chef-d'œuvre : en découpant l'orfroi, sœur Catherine a trouvé entre la doublure et le drap d'or un petit morceau de soie blanche avec ces mots d'une encre jaunie : ‘Cet ornement a été fait par les demoiselles Meilhon. Il a été commencé en dix-huit cent cinquante-neuf et fini en dix-huit cent soixante-quatre. Cet ornement a été brodé pour Monsieur l'abbé Crépel, alors vicaire de Saint-Sernin. Marie Meilhon, Claire Meilhon, Jeanne Meilhon, Anna Debourg de Mongay, Anna Uguenelle, Clotilde Meilhon’.”
Le second document, tiré du registre du Conseil du couvent Saint-Romain, ne pouvait prendre sens qu'à condition d'être lu après le précédent. Le hasard de mes propres recherches dans les archives de la province de Toulouse a voulu qu'il en fût ainsi. À la fin de son priorat de 1865 à 1868 à Saint-Romain, le P. Jean-Dominique Sicard (1827-1907) ajoute un post-scriptum à son rapport de fin de charge, en date du 19 avril 1868 : “Je répare ici un oubli involontaire relatif à un ornement très précieux que M. l'abbé Crépel, alors curé de Saint-Clar, aujourd'hui de Cugnaux, a déposé dans notre sacristie, avec la permission de nous en servir discrètement, et destination définitive pour le couvent si nulle disposition contraire n'intervient de sa part.” D'où il appert que la prétendue “chasuble du Père Lacordaire” est en réalité celle confectionnée pour l'abbé Crépel de 1859 à 1864, et confiée par lui au couvent Saint-Romain après 1864 et avant 1867. On peut même resserrer la fourchette, puisque la chasuble a été déposée sous le priorat de Jean-Dominique Sicard (commencé le 6 février 1865) et avant la nomination de Crépel à la cure de Cugnaux (annoncée dans La semaine catholique de Toulouse du 13 octobre 1867). Comme le P. Lacordaire était mort le 21 novembre 1861, la chasuble n'a pas pu lui appartenir.
Comment, néanmoins, chez les Dominicains de Toulouse, le souvenir de l'abbé Crépel a-t-il pu être si étroitement associé à celui du Père Lacordaire qu'il a fini par se confondre avec lui ? Jean-Louis Crépel, né à Toulouse le 28 septembre 1821, ordonné prêtre en 1846, vicaire à Saint-Sernin durant quinze ans, était le conservateur du trésor et des reliques de la basilique. Ensuite il a été aumônier des Dames de Saint-Maur, curé de Saint-Clar, puis curé de Cugnaux, où il est décédé le 6 février 1885. Il a été présent à Saint-Sernin de 1846 à 1861, sous Bertrand Roger, curé et vicaire général. Il semble s'être mis en relation avec Lacordaire dès 1851, avant que le Dominicain vienne pour la première fois à Toulouse afin de prêcher à Saint-Sernin, le 18 juillet 1852, pour la translation du chef de saint Thomas d'Aquin. En effet, le Père lui écrit, le 22 août 1853 : “Je vous remercie, Monsieur l'abbé, de tout ce que vous avez fait depuis deux ans pour préparer notre établissement à Toulouse.”
C'est à Jean-Louis Crépel que Lacordaire, le 29 mai 1852, accuse réception de la missive que l'abbé lui avait envoyée le 20 mai, et répond qu'il accepte en principe de prêcher la fête de saint Thomas d'Aquin le 18 juillet. Après la fête, Lacordaire se félicite de l'accueil qu'il a trouvé : “J'ai été reçu à Toulouse, écrit-il le 7 août, on ne peut mieux, par le clergé et un grand nombre de laïcs” et d'abord par le clergé de Saint-Sernin. L'année suivante, le 18 mars, Lacordaire écrit à l'abbé Crépel qu'il met à la disposition du curé de Saint-Sernin le P. Souaillard pour prêcher la prochaine fête de saint Thomas d'Aquin.
CHASUBLE « DU PÈRE LACORDAIRE », détail : saint Thomas d'Aquin. Cliché Bruno Venzac et Daniel Mennecier, Conseil général de la Haute-Garonne–Archives départementales.
CHASUBLE « DU PÈRE LACORDAIRE », détail : saint Dominique. Cliché Bruno Venzac et Daniel Mennecier, Conseil général de la Haute-Garonne–Archives départementales.
CHASUBLE « DU PÈRE LACORDAIRE », détail : saint Saturnin. Cliché Bruno Venzac et Daniel Mennecier, Conseil général de la Haute-Garonne–Archives départementales.
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 273
Le 24 juin de la même année 1853, l'abbé Crépel adresse à Lacordaire des propositions fermes pour établir les Dominicains à Toulouse. À quoi Lacordaire répond, le 15 juillet : “Dans ma prochaine lettre au Rme vicaire général [Jandel], je lui ferai part des dispositions que l'on nous montre à Toulouse, et je traiterai avec lui, de qui la chose dépend, la question d'un établissement.” Le 22 août, Lacordaire annonce à Crépel que le P. Jandel a accordé l'autorisation nécessaire. “Mon intention, ajoute-t-il, est donc de me rendre à Toulouse dans les premiers jours de septembre, afin de m'entendre avec Mgr l'archevêque, dont le consentement est nécessaire, et de voir par moi-même le lieu où il conviendrait de nous établir.”
L'assentiment de l'archevêque obtenu, Lacordaire est reparti, confiant à l'abbé Crépel le soin de conclure l'achat de l'immeuble choisi. “C'est vous, lui écrit-il le 16 septembre, qui vous êtes fait l'homme de saint Dominique à Toulouse, d'où j'espère bientôt recevoir des nouvelles au sujet de notre grande affaire.” Et, le 23 septembre : “Aucune nouvelle ne m'est encore venue de vous au sujet de l'achat de notre maison. Encore même que rien ne soit conclu, vous m'obligeriez beaucoup de me dire où en sont les choses.” À la fin du mois, l'accord est conclu pour l'achat de l'hôtel de Puymirol, rue Vélane. “Je vous remercie, écrit Lacordaire à Crépel le 8 octobre, de l'heureuse nouvelle que vous me donnez par votre lettre du 27 septembre dernier. […] J'arriverai seul à Toulouse le 31 de ce mois, je prendrai possession le 31 octobre.” Lacordaire n'aura qu'à signer l'acte notarié le 3 novembre. Entre temps, l'abbé Crépel s'occupe de l'aménagement matériel de la maison et acquitte les travaux effectués par l'entrepreneur Gout (dont les quittances sont encore conservées aux archives de la province). “J'ai reçu ici [à Flavigny] vos deux lettres du 12 et du 16, lui répond Lacordaire le 20 octobre, et vous remercie bien de toutes les peines que vous prenez pour nous. […] La salle à manger du bas [doit être arrangée pour] devenir la chapelle provisoire.”
Après l'arrivée de Lacordaire à Toulouse, le 29 octobre, la correspondance avec l'abbé Crépel cesse, mais non les contacts, puisque le Père, durant les mois suivants, va célébrer la messe tous les mercredis à Saint-Sernin devant les reliques de saint Thomas et qu'il accepte, le mardi 7 mars 1854, d'y prononcer, au cours d'une célébration présidée par l'archevêque, le panégyrique de saint Thomas d'Aquin.
En confiant sa chasuble précieuse au couvent des Dominicains de Toulouse, l'abbé Crépel ne faisait qu'accomplir un devoir d'amitié et de reconnaissance envers Lacordaire, en la personne de ses fils.
Bernard Montagnes »
La Présidente remercie le Père
Montagnes de nous avoir fait découvrir ce très beau vêtement liturgique magistralement
documenté, et parfaitement replacé dans un contexte historique précis et passionnant.
Louis Peyrusse risque
une hypothèse, en relevant que le Père Crépel, qui disposait d’une fortune
personnelle, a pu commander la chasuble pour l’offrir au Père Lacordaire ;
celui-ci étant décédé avant l’achèvement de l’ornement, il en aurait fait
don au couvent des dominicains, mais l’appellation traditionnelle serait fondée. La
chasuble est en tout cas très luxueuse pour un simple vicaire. Le Père Montagnes dit ne
pas avoir cette audace, tout en admettant que l’hypothèse n’est pas dénuée de
vraisemblance et en rappelant que le Père Crépel ne se considérait que comme le
dépositaire de cette chasuble.
Henri Pradalier
voudrait avoir des explications à l’engouement du Père Crépel pour les
dominicains. Pour Bernard Montagnes, il est plausible que l’idée de faire revivre la
présence dominicaine au couvent des Jacobins – quand il a été question que
l’armée le libère – soit venue de Saint-Sernin où étaient conservées les
reliques de saint Thomas d’Aquin. Henri Pradalier note que l’iconographie de la
chasuble favorise les dominicains, et ne retient que deux franciscains. Le Père Montagnes
dit s’être demandé quelle était l’importance de la présence dominicaine à
Toulouse dans la première moitié du XIXe siècle, et il constate qu’il y
est lui-même arrivé trop tard dans sa vie pour entreprendre les recherches qu’il a
pu mener dans d’autres villes. Il est au moins sûr que ce n’est pas le vide
total. Ainsi la confrérie du Rosaire est-elle reconstituée immédiatement après la
Révolution. Dès 1830 une communauté existe sous la forme des fameuses béates de
Chaudesaigues, dont il semble que personne à Toulouse ne sache alors qu’il
s’agit d’un tiers-ordre dominicain. Elles se sont installées bien que
l’archevêque n’ait pas été très favorable à leur venue. Lacordaire est
entré en contact avec elles et elles ont donné naissance à la communauté des
sœurs dominicaines d’Albi.
Henri Pradalier exprime
ses doutes sur l’identification de la Pentecôte alors que manquent les douze
apôtres et la Vierge et il demande si la scène n’a pu être modifiée quand la
chasuble a été réparée. Le Père Montagnes peut affirmer que la réparation n’a
porté que sur les épaules, afin de donner plus d’aisance aux bras, et qu’elle
n’a pas touché l’iconographie. La chronique de Prouille fait d’ailleurs
état de l’ébahissement exprimé devant la qualité de l’ouvrage et en
particulier devant la colombe avec ses rayons.
Répondant à une
question de la Présidente, le Père Montagnes précise que les brodeuses ne sont connues
que par
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 274
la seule mention du document retrouvé dans la chasuble lors de sa restauration,
et qu’aucun autre ouvrage ne leur est donc actuellement attribué.
Henri Pradalier évoque
le décor de l’abside de Saint-Clément comme modèle possible pour la chasuble, en
se demandant s’il n’y aurait pas d’autres exemples plus proches et plus
récents. Louis Peyrusse rappelle que Saint-Clément a fait l’objet d’une
publication en 1844 dans les Monumenti delle arti cristiane primitive nelle metropoli
del cristianismo designati et illustrati du Padre Marchi, et que les Catacombes de
Rome de Louis Perret, paru en 1851 avec des dessins de Savinien Petit, montrent des
motifs assez proches de Saint-Clément. Le Père Montagnes relève les similitudes et les
différences avec le décor de la chasuble, et Henri Pradalier évoque encore
Saint-Raymond de Durban.
Louis Peyrusse étant
revenu sur l’hypothèse proposée par l’appellation de la chasuble, le Père
Montagnes rappelle que lorsque Lacordaire fonde la maison de Toulouse, il est très
enthousiaste et qu’il prévoit alors d’y fixer sa résidence. Mais six mois plus
tard, Lacordaire est à Sorèze et il disparaît alors de l’histoire de Toulouse.
Louis Peyrusse fait remarquer que c’est oublier la puissance de séduction de
Lacordaire, ce que le Père Montagnes reconnaît. La Présidente conclut l’échange
en indiquant que cette question sera sans doute réexaminée lors de la communication que
notre confère nous fera au mois de mars.
Au titre des questions diverses, le Secrétaire général présente le dernier volume de nos Mémoires, paru pendant les vacances. Il souhaite que la publication du prochain volume n’accuse pas autant de retard.
Patrice Cabau présente à la Compagne trois éléments lapidaires : une clef de voûte, un chapiteau double et un chapiteau de réseau de fenêtre, achetés cet été par notre Société. Alerté par Dominique Watin-Grandchamp, notre confrère s’est rendu chez un antiquaire de la rue de la Colombette qui avait en vente une clef de voûte ornée d’un écu aux armes des Montaut. Sans pouvoir donner la provenance exacte des trois pierres qui étaient en sa possession, le vendeur pouvait néanmoins indiquer pour origine un antiquaire et une commune « -sur-Lèze ». Considérant l’intérêt de ces sculptures, le Bureau réuni dans l’urgence décida de les acquérir.
|
1. CLEF DE VOÛTE. Cliché M. Scellès. |
2. CHAPITEAU DOUBLE. Cliché M. Scellès. |
3. CHAPITEAU D'UN TRUMEAU DE FENÊTRE. Cliché M. Scellès. |
La Présidente exprime
la grande satisfaction ressentie par le Bureau de renouer ainsi avec une tradition
d’acquisition et de sauvegarde héritée du marquis de Castellane.
Louis Latour indique
qu’il y avait à Lézat un antiquaire, M. Gaubert, qui avait formé un musée des
vieux outils, dont la collection a été achetée par la ville de Montagaillard. Or cet
antiquaire a vendu le reste de son fonds. Patrice Cabau précise que les vendeurs
l’ont assuré que les sculptures ne venaient pas de Lézat. Il ajoute que Daniel
Cazes a eu vent de la dispersion d’une collection de Labarthe-sur-Lèze, information
qu’il n’a pas eu le temps de vérifier. Louis Latour et Patrice Cabau discutent
des armes et des branches de la famille de Montaut et, avec Bernadette Suau, des fonds
d’archives disponibles.
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 275
Maurice Scellès évoque une récente
émission des Matins de France-Culture, au cours de laquelle le journaliste recevait
une architecte. Une affirmation préliminaire des deux interlocuteurs lui paraît devoir
retenir notre attention. Il était en effet posé, sans la moindre restriction, que la
conservation des centres anciens entraînait une muséification de nos villes et
qu’elle empêchait la création architecturale contemporaine ; l’autre
terme du débat était celui de la densification des cœurs de ville. Notre confrère
déclare avoir été choqué de constater que, dans un milieu que l’on peut a priori
considérer comme bien informé, des banalités aussi grossières et tellement éculées
étaient admises comme autant de vérités intangibles. La reprise de l’habituelle
double équation musée = mort et architecture contemporaine = vie est aussi facile
que bête,
mais le propos révèle aussi une totale méconnaissance des réelles questions que
soulèvent la conservation, la restauration et la mise en valeur des centres anciens et
les enjeux scientifiques de leur étude sont totalement ignorés. Nous avons donc fort à
faire pour expliquer que les centres anciens de nos villes et l’aménagement urbain
en général méritent une autre réflexion.
François Bordes
signale que, dans le cadre de « la semaine de l’architecture », un débat
est organisé à Toulouse sur patrimoine et architecture contemporaine dans les locaux de
Météo-France. Il serait souhaitable d’y participer. Henri Pradalier confirme que
l’on débat actuellement beaucoup de la construction de tours dans les villes et de
la densification des centres urbains et Guy Ahlsell de Toulza rappelle que 75 % des
Parisiens interrogés lors d’un sondage se sont déclarés opposés aux tours. Pour
Louis Peyrusse, il n’y a pas lieu de se formaliser outre mesure de la doxa énoncée
par le journaliste de France-Culture, propos d’un journaliste habitué à traiter
chaque jour des sujets les plus divers.
SÉANCE DU 19 OCTOBRE 2004
Présents : Mme Pradalier-Schlumberger, Présidente,
MM. Scellès, Secrétaire général, Ahlsell de Toulza, Trésorier, Mme Suau,
Bibliothécaire-Archiviste ; Mmes Merlet-Bagnéris, Napoléone, Watin-Grandchamp, Mgr
Rocacher, membres titulaires ; Mmes Félix, Ugaglia, membres correspondants.
Excusés : MM. Cazes, Directeur, Latour, Bibliothécaire-adjoint.
Invitée : Mlle Martine Rieg, M. Jean-Claude Bonneval.
La Compagnie est accueillie au Musée Saint-Raymond par notre consœur Évelyne Ugaglia, conservateur au musée et commissaire de l’exposition Gaulois des pays de Garonne.
Après un exposé général des enjeux de l’exposition, Évelyne Ugaglia présente chacune des sections. Les fouilles de l’Ermitage à Agen et le char de Boë nous rappellent quelle perte a été la mort prématurée de notre confrère Richard Boudet, dont on souhaiterait que soit établie la bibliographie complète. Devant la maquette et les objets mis au jour au Puy-d’Issolud alias Uxellodunum, Évelyne Ugaglia donne la parole à Jean-Paul Girault qui nous fait une présentation très détaillée du site et des fouilles successives. La Présidente remercie Jean-Paul Girault pour son exposé très vivant de cette célèbre bataille et félicite Évelyne Ugaglia de ce beau travail d’équipe.
SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 2004
Présents : Mme Pradalier-Schlumberger, Présidente,
MM. Cazes, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier, Mme Suau, Bibliothécaire-Archiviste,
MM. Cabau, Secrétaire-adjoint, Latour, Bibliothécaire-adjoint ; Mmes Cazes,
Napoléone, Watin-Grandchamp, MM. Bordes, Gilles, Hermet, Lassure, le Père Montagnes, MM.
Pradalier, Roquebert, membres titulaires ; Mme Bellin, M. Salvan-Guillotin, membres
correspondants.
Excusé : M. Scellès, Secrétaire général.
La Présidente ouvre la séance à 17 heures. Le Secrétaire-adjoint donne lecture du compte rendu de la visite de l’exposition Gaulois des pays de Garonne, qui a eu lieu le 19 octobre au musée Saint-Raymond. Ce compte rendu, rédigé par le Secrétaire général, est adopté.
La parole est à André Hermet pour l’éloge de notre confrère Robert Gillis, disparu cet été :
Robert Gillis
1920-2004« En 1990, Robert Gillis fut élu membre correspondant de la Société Archéologique du Midi de la France. Ce choix n’était pas dû à ses compétences en les vestiges matériels des civilisations anciennes. En lui accordant cet honneur, la Société Archéologique reconnaissait ses mérites dans les domaines de la culture et de la vie sociale.
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 276
Né le 29 octobre 1920 à Toulouse, Robert Gillis ne quitta jamais notre cité, poursuivant ses études du Lycée de la rue Gambetta à la Faculté de Droit. Tout naturellement, il s’orienta vers des fonctions administratives, faisant carrière à la préfecture de la Haute-Garonne. Reçu au concours de rédacteur, Robert Gillis occupa successivement les fonctions de chef de bureau, chef de division et enfin directeur des services financiers du département avant de diriger les services de la mission régionale Midi-Pyrénées.
Dans ses différentes fonctions, les qualités rédactionnelles de ce fonctionnaire furent distinguées et nombre d’allocutions prononcées par des personnalités administratives locales furent issues de sa plume. Car c’était un excellent rédacteur, maniant le français avec élégance et de surcroît un conférencier aux accents énergiques, toujours attentif à être compris.
Pendant sa vie professionnelle, il traita forcément de questions administratives et assez souvent de questions économiques, comme ce fut le cas lors de missions en Allemagne et en Autriche. De ses nombreuses conférences outre-Rhin, dans la langue du pays, nous retiendrons le discours qu’il prononça à Ratisbonne en 1963 pour célébrer l’anniversaire du traité franco-allemand et plus tard celui confrontant les économies de la Région Midi-Pyrénées à celles de la Bavière centrale.Robert Gillis possédait l’esprit associatif. Pendant plusieurs décennies, il occupa les fonctions de secrétaire général de la Mutuelle des personnels des préfectures et des administrations territoriales. Lorsqu’il prit la retraite en 1982, il s’honorait d’être depuis 1964 membre de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse. Cette compagnie lui confia pendant vingt ans le poste de secrétaire perpétuel. Il en devint ensuit le président pendant deux ans.
Toulousain de naissance, il se devait d’être admis à l’association des Toulousains de Toulouse. Il en assuma la présidence pendant dix ans, se fixant comme objectif la progression du nombre des adhérents.
Depuis quelques années, son état de santé l’avait éloigné de ses diverses fonctions associatives. Il s’est éteint, âgé de 84 ans, au début du mois d’août. Il reste ses écrits. Ils sont nombreux et divers. En voici quelques sujets : La protection sociale avant la Sécurité sociale, Naissance des liaisons interurbaines à Toulouse, Heurs et malheurs de l’industrie toulousaine au XIXe siècle, Histoire des Amidonniers… Ses textes parurent dans les Mémoires de l’Académie des Sciences de Toulouse, dans les Actes des congrès des sociétés savantes, dans la Revue d’Histoire des communications, dans la Revue de Comminges, et bien sûr dans L’Auta.Robert Gillis était commandeur des palmes académiques. L’Allemagne et l’Espagne l’avaient honoré de la croix du Mérite.
Au cours de sa vie liée aux fonctions administratives et aux associations sociales et culturelles, Robert Gillis sut, avec simplicité, être l’ami de beaucoup d’entre nous.
André Hermet »
Michèle Pradalier-Schlumberger remercie M. Hermet de cet hommage.
La Présidente présente un courrier de l’Association des Amis de l’Hôtel d’Assézat proposant la cession à prix réduit d’un certain nombre d’exemplaires de l’ouvrage sur l’Hôtel publié en 2002. Puis elle fait circuler la correspondance imprimée, qui comprend notamment :
- le dernier numéro paru du Jardin
des Antiques, édité par l’Association des Amis du musée Saint-Raymond (n° 37,
octobre 2004, 52 p.) ;
- les programmes des
manifestations organisées par diverses institutions : musée du Louvre,
Bibliothèque municipale et Institut catholique de Toulouse, Centre de Préhistoire du
Pech-Merle (46), Maison de la Culture de Larrazet (82)…
Michèle Pradalier-Schlumberger fait voir un registre manuscrit que Maurice Scellès a récemment acquis au marché aux puces et dont il fait don à notre Bibliothèque. Il s’agit d’un livre de raison rédigé au XIXe siècle, provenant de la famille d’un notaire de Cintegabelle nommé Ferriol, et qui contient des pièces remontant au XVIIe siècle. Cet ouvrage est intéressant parce qu’il donne un aperçu de la vie, des préoccupations quotidiennes d’un notable au milieu du XIXe siècle. Louis Latour signale que la famille Ferriol avait laissé de nombreux documents, qui ont été détruits ou dispersés ; il dit que Roger Armengaud ou Roger Ycart, qui se sont intéressés à l’histoire de Cintegabelle, pourraient certainement apporter des renseignements plus précis. François Bordes souligne l’intérêt de ce livre de raison en disant combien le XIXe siècle est mal connu pour la région toulousaine. Un échange de vues s’ensuit sur les causes de cette méconnaissance, qui peut s’expliquer par le fait que les chercheurs, notamment les universitaires, ont été peu nombreux à s’intéresser à cette période.
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 277
Michèle Pradalier-Schlumberger présente deux volumes contenant les procès-verbaux originaux de nos séances, accompagnés de documents annexes, pour les années académiques 2000-2001 et 2001-2002 (182 feuillets), 2002-2003 et 2003-2004 (183 feuillets). Ces deux recueils, qui sont à notre usage interne et seront déposés dans nos archives, ont servi de base pour la rédaction des Bulletins publiés sur le site Internet de la Société puis imprimés dans ses Mémoires (t. LXI, LXII, LXIII et LXIV).
L’ordre du jour prévoyant l’élection de nouveaux membres correspondants, la Présidente donne la parole à nos confrères chargés des rapports sur quatre candidatures : Bernadette Suau, pour celles de Mme Lisa Jefferson et de M. Giles Barber ; Henri Gilles, pour celle de Mlle Géraldine Cazals ; Henri Pradalier, pour celle de Mlle Karine Madiès. Il est procédé au vote : les quatre impétrants sont élus membres correspondants de notre Société.
Louis Latour nous donne des nouvelles de nos confrères Gabriel Manière et Robert Manuel, qui nous envoient leurs amitiés, et de notre consœur Marie-Thérèse Blanc-Rouquette, qui nous réserve un exemplaire de sa thèse sur l’histoire de la presse et de l’information à Toulouse avant 1789.
La Présidente donne la parole à Jean-Michel Lassure pour la communication du jour, intitulée Le décor peint des céramiques (plats et assiettes) de Giroussens, publiée dans ce volume (t. LXV, 2005) de nos Mémoires.
Michèle Pradalier-Schlumberger remercie
notre confrère pour sa présentation et note la qualité de la documentation projetée.
Jean-Michel Lassure dit la devoir à M. Matthieu Ferrier. La Présidente relève
l’élégance, le caractère aristocratique des costumes que portent les personnages
figurés sur les plats. M. Lassure abonde en ce sens : ces gentilshommes portant
l’épée, « habillés à la mode », paraissent comme
« endimanchés ».
Guy Ahlsell de Toulza
intervient pour préciser que les céramiques que nous avons vues ne constituent
qu’une infime partie de la production des ateliers de Giroussens : les cinquante
à quatre-vingts potiers qui ont travaillé au cours des XVIIe et XVIIIe
siècles ont fabriqué par millions des plats dont la durée d’utilisation paraît
avoir été très courte. Les quelque 300 pièces répertoriées conservées en bon état
posent le problème de leur emploi effectif. Si certaines ont été retrouvées servant de
bassine sous le robinet d’un tonneau ou dans un grenier sous une gouttière, il
apparaît que les grand plats ornés formaient à l’origine une vaisselle de montre
destinée à être exposée sur des dressoirs. Cette « belle production »,
caractérisée par la richesse de ses décors, portant pour quelques exemplaires des
armoiries estampées, répondait à des commandes « aristocratiques ». Un plat
représentant une scène de vénerie – et non, comme l’a cru Lucien Raffin, la
conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant – a pu constituer avec
d’autres un « service de chasse ». La production à beaux décors est
datable du dernier tiers du XVIIe siècle et des deux premières décennies du
XVIIIe, et les costumes figurés correspondent bien à ceux du règne de Louis
XIV. Les plats richement ornés sont des créations en série, mais sans recours à des
poncifs ; après 1720, la génération des peintres décorateurs disparaît et
l’ornementation s’appauvrit. Guy Ahlsell de Toulza donne des précisions
concernant un plat qui porte le motif d’un écureuil, un unicum :
brisée, cette pièce avait été restaurée au XIXe siècle et une
photographie des environs de 1900 la montre avec deux écureuils affrontés ; elle a
été restaurée à nouveau et le tracé du seul écureuil partiellement conservé a été
complété. S’agissant des armoiries, qui disparaissent au début du XVIIIe
siècle, M. de Toulza rejette avec vigueur les identifications avancées par L.
Raffin : un écusson portant un lion dressé n’appartient pas à la famille de
Gélas d’Ambre, telles armes attribuées à un « amiral de France » sont
en réalité celles de la marine de Louis XIV… Il apparaît que les armoiries sont
fréquemment celles de la petite noblesse municipale et que les potiers de terre ont
utilisé des sceaux employés à l’origine par les potiers d’étain.
Jean-Michel Lassure
rappelle qu’il a été très prudent pour ce qui est des « blasons »,
puis il justifie l’analyse systématique des décors à laquelle il a
procédé : il s’agit de fournir aux archéologues des éléments
d’identification pour les fragments de céramiques de Giroussens trouvés en fouille.
Michèle
Pradalier-Schlumberger demande s’il est possible de proposer une chronologie fine. M.
Lassure répond par la négative, mais il espère que l’exploration archéologique
des dépotoirs des potiers pourra fournir de bons repères. Quitterie Cazes ajoute que les
dépôts de fouilles recèlent des milliers de pièces encore non étudiées, et Dominique
Watin-Grandchamp évoque une « archéologie des réserves archéologiques ».
Guy Ahlsell de Toulza mentionne quelques jalons chronologiques : la céramique de
Giroussens est présente dans la maison Champlain, à Montréal, brûlée en 1702, ainsi
qu’à l’abbaye Saint-Vincent de Nieul-sur-l’Autise (85), supprimée en
1718. Après avoir indiqué que le programme commun de recherche élaboré entre la France
et le Canada semble avoir avorté, il invite les membres de la Société à visiter le
musée de Rabastens, dont les collections de Giroussens viennent de s’enrichir
considérablement.
Au titre des questions diverses, Guy Ahlsell de Toulza signale à propos de l’Hôtel de Castellane (10 rue Croix-
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 278
Baragnon) un récent article de M. Christophe Marquez paru dans L’Auta (4e série, n° 57, novembre 2004, p. 604-606). Le Directeur nous informe qu’il a vu rue Deville, sur la façade de l’ancien collège de Foix, un panneau annonçant des travaux de mise aux normes.
SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2004
Présents : Mme Pradalier-Schlumberger, Présidente, MM. Coppolani, Directeur
honoraire, Ahlsell de Toulza, Trésorier, Scellès, Secrétaire général, Cabau,
Secrétaire-adjoint, Latour, Bibliothécaire-adjoint ; Mmes Napoléone,
Watin-Grandchamp, MM. Bordes, Gilles, Hermet, Peyrusse, Pradalier, Tollon, Vézian,
membres titulaires ; Mmes Bayle, Cazals, Félix, Galés, Guiraud, Jefferson, Marin,
MM. Barber, Garland, Ginesty, Salvan-Guillotin, membres correspondants.
Excusés : Mme Suau, Bibliothécaire-Archiviste, M. Cazes, Directeur.
La Présidente ouvre la séance à 17 h en souhaitant la bienvenue aux nouveaux membres correspondants élus dans les séances du 18 mai et du 9 novembre : Mmes Hélène Guiraud, Géraldine Cazals, Lisa Jefferson et M. Giles Barber. Puis elle annonce une triste nouvelle : la disparition de Jean Lartigaut, Président de la Société des Études du Lot, membre correspondant de notre Société depuis 1976, décédé au début de ce mois.
Le Secrétaire-adjoint donne lecture du procès-verbal de la séance du 9 novembre, qui est amendé et adopté.
La Présidente rend compte de la correspondance imprimée, qui comprend en particulier le programme du Centre européen de Préhistoire de Tautavel et l’annonce de la conférence inaugurale du Pôle régional de l’Institut européen en Sciences des Religions : « Enseigner le fait religieux dans un esprit laïque : enjeux et perspectives » (24 novembre 2004, Université des Sciences sociales de Toulouse).
Michèle Pradalier-Schlumberger
présente ensuite les dons faits à la Société par deux de ses membres, qu’elle
remercie :
- Louis Peyrusse, pour
une photographie ancienne montrant en perspective le flanc méridional de la basilique
Saint-Sernin de Toulouse dans l’état antérieur à l’intervention
d’Eugène Viollet-le-Duc (épreuve collée sur carton) ;
- Giles Barber, pour
son ouvrage consacré à Saint-Girons - Ses rues, leur histoire à travers les âges
(Aspet, PyréGraph, 2004, 175 p.).
La parole est à Bruno Tollon pour la communication du jour, intitulée Traditions et nouveautés distributives dans les hôtels de la Renaissance à Toulouse.
La Présidente remercie notre confrère pour son exposé et lui demande si l’unique pièce voûtée de l’Hôtel de Cheverry n’aurait pas pu correspondre à une chapelle particulière. Bruno Tollon répond que la question de l’existence dans les hôtels particuliers et grandes maisons urbaines d’oratoires privés, tels qu’il s’en trouve dans les châteaux, a été posée lors des journées d’étude sur la demeure moderne qui se sont tenues au début du mois d’octobre dernier sous l’égide de notre Société. Les textes toulousains ne font mention ni de lieux de culte domestiques, ni d’ecclésiastiques attachés, si bien qu’il faut croire que les dévotions se faisaient dans les églises, particulièrement dans les chapelles funéraires familiales.
Pour Henri Ginesty, les espaces objets de la communication – des pièces voûtées, dépourvues de cheminée, aux ouvertures fortement barreaudées, exceptionnelles dans le cadre des hôtels particuliers du XVIe siècle – paraissent avoir eu pour fonction essentielle d’abriter les papiers importants des négociants toulousains, qui devaient les y conserver dans des coffres ou des armoires ; cette destination est par exemple manifeste à l’Hôtel de Subernes. Maurice Scellès abonde en ce sens, évoquant des dépôts de pièces d’archives et de documents comptables ; il opère une distinction entre ces lieux sécurisés liés à une activité professionnelle et les cabinets de travail des intellectuels adonnés à l’étude. Guy Ahlsell de Toulza et Dominique Watin-Grandchamp ayant signalé l’existence, au château de Mézens, d’un cabinet disposé dans l’ébrasement d’une grande baie du bâtiment médiéval, Bruno Tollon cite le cas de l’« étude » aménagée pour Claude d’Urfé au château de La Bastie d’Urfé (Forez) pour redire que la fonction de ces pièces n’était pas de nature professionnelle. Il note par ailleurs qu’il existait dans certains hôtels particuliers toulousains un espace réservé au loisir du maître des lieux : c’était la pièce voûtée située au sommet de la tourelle d’escalier, sous la terrasse.
Maurice Scellès aborde le problème que pose la disparition des salles étudiées dans les hôtels construits à partir du XVIIe siècle. Bruno Tollon relève l’intérêt de cette question et regrette qu’elle n’ait pas encore fait l’objet d’une
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 279
recherche. M. Scellès envisage l’hypothèse selon laquelle l’absence de « comptoir » dans les hôtels des XVIIe et XVIIIe siècles puisse s’expliquer par le fait qu’ils n’ont pas été construits pour des négociants, mais pour des parlementaires et autres aristocrates. M. Tollon signale que le « comptoir » de l’Hôtel d’Assézat est mentionné dans un inventaire de 1792 comme ayant servi de bureau de travail pour le personnel attaché au service du baron de Marcassus-Puymaurin.
L’échange de vues qui s’ensuit fait apparaître l’ambivalence des espaces en question. Il y a en effet ambiguïté dans les dénominations : lors des journées d’étude du mois d’octobre, les chercheurs d’outre-Pyrénées ont indiqué que la pièce servant à l’activité professionnelle était appelée estudi en catalan, et studi en majorquin. Au-delà de la terminologie, Maurice Scellès fait remarquer que ces salles constituent des lieux intermédiaires, situés à l’articulation de l’espace privé et de l’espace public. Dans ces conditions, il est loisible d’imaginer pour le « comptoir » des utilisations diverses : pièce des affaires et des paiements pour Dominique Watin-Grandchamp, du versement des redevances pour Guy Ahlsell de Toulza, pièce forte pour Louis Peyrusse ou salle au trésor pour Jeanne Bayle…
Emmanuel Garland souligne l’exiguïté de ces pièces et fait observer que, sans doute humides, elles n’étaient guère propices à la conservation de papiers. François Bordes explique à ce propos les pratiques de conservation des documents au Moyen Âge et au début des Temps modernes, et Henri Pradalier rappelle que les archives des établissements religieux se trouvaient fréquemment dans une tour ou un clocher. Dominique Watin-Grandchamp cite le cas des archives de la Maison toulousaine des Hospitaliers, où la pièce du donjon dévolue aux archives était de petites dimensions.
Patrice Cabau intervient à propos d’un document projeté au sujet de l’Hôtel de Maleprade, édifié dans les années 1623-1626 : un plan issu d’un prospectus de promotion immobilière présentant le « Corps de passage » sur la rue Gambetta, aujourd’hui démoli, comme datant du « XIXe siècle ». Bruno Tollon et Louis Peyrusse pensent, quant à eux, que ce corps d’entrée, conçu dans le style Louis XIII, avait été bien été construit au XIXe siècle.
Au titre des questions diverses, Henri Pradalier, Président de l’Union des Six Académies et Sociétés savantes de l’Hôtel d’Assézat, communique des informations relatives au problème de sécurité que pose la fermeture du grand escalier de l’Hôtel. La convention conclue avec la Fondation Bemberg prévoyait un accès à notre salle des séances par le grand escalier et le sas aménagé à cet effet ; les travaux récemment réalisés dans la cour de l’Hôtel ont entraîné la condamnation de cet accès, qu’il faut impérativement rouvrir, sauf à transformer notre salle des séances en « souricière ». Il convient donc d’adresser le calendrier de nos réunions à la Fondation Bemberg, afin que celle-ci puisse prendre les dispositions conformes aux impératifs de circulation. M. Pradalier évoque également les problèmes concernant les issues de la salle Clémence-Isaure.
Guy Ahlsell de Toulza présente une série de photographies montrant deux poutres peintes que lui a communiquée le propriétaire du château de Flamarens (Gers). Après avoir rappelé l’histoire de cette demeure, Guy Ahlsell de de Toulza commente le décor porté par ces poutres, lequel consiste en une série de figures fantastiques, animales et humaines, prises dans des rinceaux et paraît pouvoir être daté des dernières décennies du XVe siècle. Au jugement de Dominique Watin-Grandchamp et de Louis Peyrusse, le mode de traitement en grisaille peut faire également penser aux premières décennies du XVIe siècle. Guy Ahlsell de Toulza en convient et indique pour terme extrême la date d’un testament rédigé en 1536. S’agissant de plafonds peints, il signale celui découvert au château d’Azas, près de Montastruc-la-Conseillère (31) : au dernier étage se voient de grands médaillons ovales encadrant des scènes mythologiques, décor attribuable au premier tiers du XVIIe siècle.
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 280
CHÂTEAU DE FLAMMARENS (Gers), premier étage. Face 1en haut, face 2 en bas (montages photographiques).
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 281
Le Secrétaire général, parvenu jusqu’à nous après le début de la séance, peut faire entendre le procès-verbal de la réunion du 5 octobre, qui est adopté.
SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2004
Présents : Mme Pradalier-Schlumberger, Présidente,
MM. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Scellès, Secrétaire général, Mme Suau,
Bibliothécaire-Archiviste, MM. Cabau, Secrétaire-adjoint, Latour,
Bibliothécaire-adjoint ; Mme Napoléone, MM. Bordes, Hermet, Julien, Lassure, le
Père Montagnes, M. Peyrusse, Mgr Rocacher, MM. Roquebert, Tollon, membres
titulaires ; Mmes Andrieu, Bayle, Cazals, Félix, Fournié, Jefferson, MM. Barber,
Laurière, Molet, Salvan-Guillotin, Stouffs, membres correspondants.
Excusés : M. Cazes, Directeur, Mmes Cazes, Conan, M. Garland.
Invité : M. Arnaud Ramière de Fortanier, conservateur des Archives des Yvelines.
Le Secrétaire-adjoint donne lecture du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2004, qui est adopté. La Présidente remarque que l’appel du Trésorier a été entendu et que quelques cotisations ont été payées. Puis elle fait circuler dans l’assemblée une feuille d’inscription en demandant aux membres présents de bien vouloir y porter les noms et les adresses de personnes de leur connaissance à inviter à notre séance publique. La Présidente rappelle à ce propos que la conférence sera faite cette année par notre consœur Françoise Galés, qui présentera les châteaux de Gaston Fébus.
La Présidente rend compte de la correspondance manuscrite et le Secrétaire général y ajoute deux courriels reçus par notre Société. C’est tout d’abord une étudiante en architecture qui nous demande de lui indiquer des édifices toulousains en déshérence afin d’en faire le sujet de son diplôme : lui ont été signalés l’ancien hôpital de La Grave et l’hôpital Marchant. Le second courriel est de Mme Christine Réfalo, du Musée de la poterie méditerranéenne à Saint-Quentin-la-Poterie dans le Gard, et vient en écho aux discussions de la séance du 5 novembre 1996, qui évoquaient des « demoiselles d’Avignon », en supposant qu’elles provenaient de la côte méditerranéenne : Mme Christine Réfalo nous indique que les deux « demoiselles » que possède son Musée, et dont elle joint des photographies, viennent de Turquie, et qu’elles auraient été rapportées par des soldats provençaux ayant fait la guerre de Crimée ; certaines de ces poteries portent même une inscription donnant le nom de la ville où elles ont été produites : Çannakale. Elle ajoute que ces poteries vont apparemment par deux, avec un modèle féminin et un modèle masculin.
|
Musée de la poterie méditerranéenne à Saint-Quentin-la-Poterie. « Demoiselle ». |
Musée de la poterie méditerranéenne à Saint-Quentin-la-Poterie. « Demoiselle ». |
La Présidente présente à la Compagnie un rapport de Lucien Babonneau, Défense de Toulouse contre le désordre anarchique de la construction, multigraphié, s.d. [1958], 18 p., offert par Guy Ahlsell de Toulza qui l’a acheté mercredi dernier chez un bouquiniste. Notre confrère précise que Lucien Babonneau était docteur de l’Université et qu’il était membre de l’Académie des Sciences. 1956, c’est le moment où l’on envisage en particulier la future place occitane, et bien des propos de cet ingénieur sont toujours d’actualité.
La parole est alors à Pascal Julien pour une communication sur Les cartes du « Cours de Garonne » dressées en 1716-1720 par Hyppolite Matis, géographe du roi, publiée dans ce volume (t. LXV, 2005) de nos Mémoires.
La Présidente remercie Pascal Julien de nous avoir fait une présentation passionnante de cette très belle découverte, qui s’inscrit dans les recherches menées par notre confrère sur les marbres mais intéressera nombre d’entre nous en raison des nombreuses informations que recèlent ces cartes, qu’il s’agisse de plans de villes ou de détails qui fourmillent et peuvent être exploités pour des recherches très diverses. Pascal Julien souligne qu’en effet tous les endroits relais sont détaillés, car c’étaient des lieux où il fallait pouvoir décharger les marbres en cas d’urgence.
François Bordes demande si les cartes sont accompagnées des procès-verbaux de lever, et, observant qu’elles mentionnent de nombreux noms de lieux, de quelle origine sont les arpenteurs et quel intérêt présentent-elles pour la connaissance de la toponymie occitane. Pascal Julien précise qu’il n’y a pas de procès-verbaux mais des « fragmentaires » sur lesquels sont portées toutes les informations relevées sur le terrain. La série O1, des bâtiments du roi, contient tous les paiements à Matis, avec mention du lieu et de la date de la mission. Les informations sont très nombreuses et restent à exploiter, dans une série qui comporte un nombre considérable de pièces. François Bordes note qu’en effet les « fragmentaires » portent mention de bois, de prés, etc. Pascal Julien confirme que ces informations sont très précises. Répondant au deuxième point de la question, il indique qu’il semble que Matis soit originaire de la région de Marseille. Il y a bien quelques erreurs dans les noms, mais elles sont peu importantes, ce
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 282
qui laisse penser que Matis en avait une certaine habitude. Michel Roquebert relève néanmoins des francisations pittoresques : La Rize pour l’Arize, La Riège pour l’Ariège…
M. Ramière de Fortanier dit que l’archivistique est une science exacte, mais qu’elle est aussi une aventure et il explique comment les Archives départementales des Yvelines ont récupéré ces cartes qui devaient se trouver dans une pièce particulière de Versailles, où elles faisaient partie des collections destinées à l’éducation du Dauphin. Puis il dit quelle belle histoire a été la rencontre avec Pascal Julien, l’homme vedette du congrès de Versailles sur les marbres, et annonce que toutes ces cartes ont été numérisées en haute définition et sont mises en ligne sur le site Internet des Archives départementales.
Henri Molet dit que ces cartes sont les plus anciennes et les plus détaillées qu’il connaisse, et les plus complètes pour la représentation des voies de communication. La carte la plus détaillée qu’il connaissait jusque-là pour les voies de l’ensemble du Toulousain n’est pas antérieure aux dernières années du XVIIIe siècle. Henri Molet souligne à son tour le soin du détail qui caractérise cet ensemble, en effet organisé en fonction des besoins du transport du marbre. À propos du stockage des marbres dans le port de Bordeaux, il ne croit pas que les archéologues qui ont fouillé cette zone aient su ce qu’étaient les blocs qu’ils mettaient au jour. Pascal Julien assurant les avoir avertis, Henri Molet rappelle que plusieurs équipes se sont succédé sur le site.
Pascal Julien indique que Matis est revenu dans la région en 1721, pour faire le relevé des cours de la Dordogne et de la Vézère, parce qu’il y avait un projet d’exploitation des marbres de Saint-Céré, qui fut un échec ; on prévoyait en même temps l’exploitation des bois.
M. Ramière de Fortanier constate qu’en fait cet ensemble de documents constitue les archives privées d’un arpenteur. Il rappelle que François de Dainville a écrit une histoire des géographes. Il attire l’attention sur le fait que les états gravés des cartes de Cassini doivent être utilisés avec beaucoup de prudence et qu’il serait en fait nécessaire d’avoir recours aux minutes. Une étude comparative des minutes de Cassini et des « fragmentaires » de Matis serait sans doute très intéressante. Henri Molet évoque un relevé plus détaillé encore que ceux de Matis, réalisé à peu près à la même époque par Claude Masse sur le cours de la Garonne de Valence d’Agen à Bordeaux.
SÉANCE DU 4 JANVIER 2005
Présents : Mme Pradalier-Schlumberger, Présidente,
MM. Cazes, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier, Scellès, Secrétaire général, Mme
Suau, Bibliothécaire-Archiviste, MM. Cabau, Secrétaire-adjoint, Latour,
Bibliothécaire-adjoint ; Mme Napoléone, MM. Peyrusse, Prin, membres
titulaires ; Mmes Bayle, Jefferson, MM. Barber, Stouffs, membres correspondants.
Excusés : Mmes Andrieu, Cazes, Galés, M. Pradalier.
La Présidente ouvre la séance en
souhaitant à tous une bonne année 2005, et elle remercie tous ceux qui lui ont adressé
leurs vœux.
Le Secrétaire
général donne lecture du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2004, qui est
adopté après quelques compléments et corrections.
La Présidente rend compte de la
correspondance manuscrite. Mme Martine Rouche, vice-présidente du Salon du livre
d'histoire locale de Mirepoix, nous invite à participer à une journée foraine le samedi
4 juin 2005, journée qui sera consacrée à Camon et Mirepoix. La Présidente, Louis
Latour, Lisa Jefferson et Jeanne Bayle donnent des indications sur le programme et les
intervenants.
Notre confrère Gabriel
Manière nous adresse ses meilleurs vœux pour l’année nouvelle en réaffirmant
son très cordial attachement à notre Société. Il nous annonce sa décision de donner
à la Société Archéologique du Midi de la France la collection de diapositives
réalisées lors de ses fouilles et de ses recherches archéologiques. Louis Latour
précise qu’il s’agit de la quasi-totalité de la collection de notre confrère,
excepté les photographies d’Aurignac et de Cazères, et quelques autres qu’il a
données à la Société des Études de Comminges. La Présidente remerciera Gabriel
Manière pour le don de ces documents précieux. Bernadette Suau pense qu’il faudra
envisager leur numérisation pour en assurer la conservation et Maurice Scellès suppose
qu’il serait possible d’obtenir des subventions pour cela, d’autant plus
que nous assurons la communication au public des documents numérisés.
Outre divers envois de
vœux et une invitation de l’Académie des Sciences à une conférence du Maire
de Toulouse, sur le thème de la politique culturelle de la Ville, la correspondance
comprend le pré-programme du prochain Congrès des Sociétés savantes organisé par la
Fédération historique de Midi-Pyrénées et qui se tiendra les 17-19 juin prochains à
Tarbes. Bernadette Suau rappelle que ces congrès favorisent la rencontre entre
universitaires, chercheurs, étudiants et érudits locaux qui n’ont pas toujours
l’occasion de travailler ensemble et elle invite tous ceux
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 283
qui pourraient être intéressés à proposer des projets de communication. Les thèmes sont très variés, de la préhistoire à nos jours.
Notre bibliothèque s’enrichit de La France archéologique. Vingt ans d’aménagements et de découvertes, sous la direction de Jean-Paul Demoule, Paris, Hazan, 2004, 256 p., offert par Louis Peyrusse. Maurice Prin offre à la Société un recueil de photographies de la fin du XIXe siècle, contenant de précieux clichés de Moissac, Cazères, etc. Au nom de notre Société, la Présidente remercie nos deux confrères. Maurice Scellès remarque que le volume de photographies offert par Maurice Prin est exactement semblable aux deux recueils qu’il lui avait été donné d’acheter au marché Saint-Sernin et qu’il a offerts à notre Société en 1995 (M.S.A.M.F., t. LV, p. 240-241). Maurice Prin confirme qu’il a fait son acquisition au même endroit à peu près à la même date, d’après son souvenir. Les deux premiers volumes concernaient l’Italie et la Tunisie, celui-ci la région toulousaine. Il faut donc penser que celui qui a constitué ces recueils de monuments et de sites archéologiques était de Toulouse ou de ses environs. On aimerait en savoir plus sur ce personnage. La numérotation des recueils laisse penser que la série est loin d’être complète.
La Présidente annonce la candidature de M. Christian Darles, professeur à l’École d’Architecture de Toulouse, au titre de membre correspondant de notre Société. Le rapport sera présenté lors d’une prochaine séance par Maurice Scellès.
La parole est à Guy Ahlsell de Toulza pour une communication sur Les tapisseries de la reine Zénobie du château de Saint-Géry, publiée dans ce volume (t. LXV, 2005) de nos Mémoires.
La Présidente remercie Guy Ahlsell de Toulza pour cette flamboyante évocation de la reine Zénobie et pour l’étude de cette magnifique tenture qui nous permet de mieux mesurer quelle perte pour les amateurs d’art ont été son départ du château de Saint-Géry et sa dispersion. D’après les photographies présentées, il semble qu’elle soit très proche de celle de Madrid. Guy Ahlsell de Toulza le confirme tout en précisant que si la tenture de Lucques est exposée au palais Manci, celle de Madrid est en grande partie en réserve, à l’exception de quelques pièces présentées à Tarragone et à Ségovie. Il a pu voir les pièces actuellement au musée de Bruxelles, mais on ne peut guère se fier aux couleurs des reproductions publiées pour établir des comparaisons.
La Présidente lui ayant demandé si l’on avait des informations sur le sort des autres pièces de la tenture de Saint-Géry, Guy Ahlsell de Toulza indique que les seules à être sûrement localisées sont celles qui ont été achetées par le musée de Bruxelles ; il sait par ailleurs qu’une autre est partie à Prague ; pour localiser les autres, il faudrait suivre systématiquement les ventes. Guy Ahlsell de Toulza insiste sur la très grande qualité de ces tapisseries en disant qu’il n’en connaît pas d’équivalent dans la région, pas même au château de Merville. Pour expliquer la présence de cette tenture à Saint-Géry, il fait l’hypothèse d’un achat réalisé dans le deuxième quart du XVIIIe, plutôt qu’à la fin du siècle, mais la facture n’a pas été retrouvée dans les archives de la famille.
Daniel Cazes demande si les tapisseries de Bruxelles sont nombreuses dans le Midi de la France, et il ajoute qu’il s’est toujours étonné de la présence à la collégiale de Saint-Gaudens de pièces tissées sur des cartons de Rubens. Guy Ahlsell de Toulza cite des pièces de grande qualité mais éparses, comme au château de Merville, alors que les inventaires mentionnent des tentures comprenant plusieurs pièces, la plupart du temps mitées, ce qui arrive aux tapisseries quand elles ne sont pas exposées. À Saint-Géry, les différentes pièces de la tenture étaient réparties dans tout le château, ce qui montre qu’il ne s’agit pas d’une commande. Guy Ahlsell de Toulza rappelle qu’on ne connaît que trois versions de cette tenture, mentionnées par les textes et encore conservées, et il ajoute que le musée de Bruxelles considère comme le chef-d’œuvre de ses collections les pièces provenant de la tenture de Saint-Géry, comptant parmi les plus belles productions de la fin du XVIIe siècle.
Daniel Cazes remarque que notre confrère a fort bien su mettre en évidence le goût du XVIIe siècle pour le faste oriental antique. La tenture conservée à la cathédrale de Tarragone illustre à la manière de Rubens l’histoire de Cyrus le Grand, avec une magnificence qui fait un très grand contraste avec l’iconographie antique. On cherche toujours un éventuel portrait de la reine Zénobie parmi les milliers de portraits sculptés à Palmyre au IIIe siècle de notre ère, portraits qui montrent en tout cas des costumes fastueux et un luxe qui a d’ailleurs été confirmé par l’archéologie. La manière dont le XVIIe siècle a su faire revivre cette société du IIIe siècle est assez étonnante.
Louis Peyrusse est, quant à lui, frappé par ce que ces tapisseries doivent au théâtre baroque, plus qu’aux sources antiques. Il croit, avec Guy Ahlsell de Toulza, qu’il faut renoncer à la tradition d’une tenture commandée par un médecin du roi, même s’il faut sans doute retenir la piste espagnole, et il souligne qu’une telle série de tapisseries ne pouvait être présentée que dans un palais.
Bernadette Suau voudrait savoir s’il existe des inventaires après décès ou des inventaires révolutionnaires du château de Saint-Géry. Guy Ahlsell de Toulza explique que le seul inventaire révolutionnaire connu mentionne les meubles mais pas les tapisseries, mais il ajoute qu’une partie des archives du château n’est pas encore bien classée.
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 284
Puis il indique que Clément de Rey de Saint-Géry, parlementaire, a été guillotiné pendant la Révolution et la famille internée ; les biens ont été saisis, mais récupérés après la Révolution.
SÉANCE DU 18 JANVIER 2005
Présents : Mme Pradalier-Schlumberger, Présidente, MM. Cazes, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier, Scellès, Secrétaire général, Mme Suau, Bibliothécaire-Archiviste, MM. Cabau, Secrétaire-adjoint, Latour, Bibliothécaire-adjoint ; Mmes Félix-Kerbrat, Jefferson, MM. Bordes, Julien, Peyrusse, Tollon, membres titulaires ; Mmes Bayle, Fournié, M. Barber, membres correspondants.
La Présidente rend compte de la correspondance et nous fait part des vœux adressés par nos confrères Robert Manuel et Claude Péaud-Lenoël, puis d’une invitation à la Septième Fête d’hiver du Livre de Mirepoix, organisée à la mairie de cette ville le samedi 22 janvier 2005.
Le Secrétaire général explique les perfectionnements apportés au système d’indexation du site Internet de notre Société, puis il nous transmet une question parvenue par courriel à propos d'un tableau disparu de l’église de Baralle (62) qui représentait le pressoir mystique. Louis Latour signale qu’il a trouvé trace sur Internet d’un colloque sur ce thème iconographique tenu à Recloses en 1989, puis il indique l’existence d’un dossier constitué par le chanoine Achille Auriol, ancien président de la S.A.M.F., qui publia un article « À propos d’une toile de la Daurade représentant le pressoir mystique » (B.S.A.M.F., séance du 10 avril 1934).
Conformément à l’ordre du jour, la Compagnie se constitue ensuite en Assemblée générale.
La Présidente présente le rapport
moral pour l’année académique 2003-2004. Le Trésorier présente le bilan
financier, arrêté au 18 janvier 2005. Un échange de vues s’ensuit quant à
l’état des finances de notre Société et quant à son mode de fonctionnement.
S’il y a tout lieu
de se féliciter du succès des ventes du volume hors-série consacré à La maison au
Moyen Âge dans le Midi de la France, on doit déplorer le défaut de paiement
d’un quart des cotisations. On peut aussi regretter la disparition d’une partie
des nouveaux membres correspondants, mais le phénomène n’est pas récent et il
convient certainement de le considérer comme structurel. Le Secrétaire général met en
évidence la nécessité de faire face aux dépenses croissantes impliquées par notre
bibliothèque et notre site Internet (il faudrait rechercher des subventions, ce qui pose
le problème du montage de multiples dossiers et de l’implication d’un ou de
plusieurs de nos confrères dans ce domaine), outre l’impératif du financement de la
publication de nos Mémoires. Le Trésorier insiste sur l’importance du
maintien de nos avoirs en capital. Louis Peyrusse juge au fond « très moyen »
un exercice financier dont les ressources ont été grossies par des « circonstances
exceptionnelles ».
La discussion
s’engage ensuite sur la question de la modernisation éventuelle des statuts, dont la
rédaction remonte à la fin du XIXe siècle, et d'une nouvelle rédaction du
règlement intérieur qui pourrait apporter des formules de fonctionnement mieux adaptées
à notre temps.
À l’issue de cet échange, les rapports moral et financier sont adoptés, et quitus est donné au Trésorier pour sa bonne gestion.
L’ordre du jour appelle ensuite les élections statutaires, qui portent sur la moitié des membres du Bureau et concernent cette année les postes de Directeur, de Secrétaire-adjoint et de Trésorier. Il est procédé au vote : Daniel Cazes, Patrice Cabau et Guy Ahlsell de Toulza sont reconduits dans leurs fonctions.
La parole est à notre consœur Jeanne Bayle pour la communication du jour, intitulée Les peintres-verriers toulousains du XVIe siècle, publiée dans ce volume (t. LXV, 2005) de nos Mémoires.
La Présidente remercie notre collègue
et fait appel aux questions ou remarques de la Compagnie.
Michelle Fournié
intervient à propos du peintre Pèlerin Frizon, qui a très probablement contribué à
l’illustration du livre d’heures récemment acquis par la Bibliothèque
municipale de Toulouse. Parmi les saints portés au calendrier de ce manuscrit, nombreux
sont en effet ceux qui étaient honorés par la confrérie des Corps-Saints de
Saint-Sernin ; or le registre des comptes de cette confrérie pour les années
1499-1513 contient à plusieurs reprises le nom de Pèlerin Frizon, qui travaillait alors
à des décors en rapport avec le culte de sainte Suzanne de Babylone.
France Félix-Kerbrat
signale un peintre-verrier allemand, appelé « Jean Verroy », auquel elle a
consacré une communication lors du Congrès des Sociétés savantes de 1971 :
celui-ci vécut à Toulouse et fut enterré dans le couvent des Grands Carmes, à
proximité d’un triptyque dont l’élément central, figurant la messe de saint
Grégoire,
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 285
a été reproduit sur la couverture du volume LII de nos Mémoires
(1992). Cette peinture, qui appartenait en dernier lieu à un particulier, fut mise aux
enchères publiques. La Ville de Toulouse ne voulut pas l’acquérir. L’acheteur
qui l’emporta s’en défit bientôt et on la revit proposée à la vente à
Paris, dans une galerie d’antiquités du faubourg Saint-Germain, à un prix fortement
multiplié et avec une attribution fantaisiste.
François Bordes
observe que les noms cités par Mme Bayle se retrouvent constamment dans les comptes de la
Ville et il note la polyvalence de ces artistes, qui travaillent tantôt comme peintres,
tantôt comme verriers pour réaliser les enluminures, fresques et
« veyrines » de la Maison commune ; ils œuvrent également pour
l’hôpital municipal Saint-Sébastien.
Patrice Cabau demande
si l’on a trace de commandes de vitraux pour des hôtels particuliers. Jeanne Bayle
et Bruno Tollon répondent par la négative.
Pascal Julien
intervient à propos des verrières de Saint-Sernin, faisant remarquer que la plupart des
fenêtres des bas-côtés ont conservé leurs châssis et barlotières du XVIe
siècle. Il note que les baies étaient systématiquement murées lorsque les vitraux
étaient trop abîmés, puis démurées lorsqu’on en installait de nouveaux.
SÉANCE DU 1er FÉVRIER 2005
Présents : Mme Pradalier-Schlumberger, Présidente,
MM. Cazes, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier, Scellès, Secrétaire général, Mme
Suau, Bibliothécaire-Archiviste, MM. Cabau, Secrétaire-adjoint, Latour,
Bibliothécaire-adjoint ; Mmes Napoléone, Watin-Grandchamp, MM. Bordes, Gilles,
Tollon, membres titulaires ; Mmes Cazals, Fraïsse, Jefferson, M. Stouffs, membres
correspondants.
Excusés : Mmes Bayle, Cazes, Galés, MM. Garland, Pradalier.
Le Secrétaire général et le Secrétaire-adjoint donnent lecture des procès-verbaux des séances des 4 et 18 janvier, qui sont adoptés après quelques menues corrections. Louis Latour donne de très bonnes nouvelles de la santé de Gabriel Manière, âgé de 96 ans, et indique qu’il apportera bientôt les diapositives offertes par notre confrère.
La Présidente rend compte de la correspondance manuscrite et signale plus particulièrement que notre confère Christophe Balagna nous fait parvenir un tiré-à-part de son article « Merveilles du Savès. Église de Poucharramet, XIIIe s. », supplément à Archéologie en Savès, septembre 2004, 28 p.
La Présidente informe la Compagnie que M. Julien Lugand propose au concours sa thèse soutenue à l’automne dernier à l’Université de Toulouse-Le Mirail : Peintres et doreurs (1650-1730) en Roussillon, 2 volumes, 879 p., dont elle fait circuler un exemplaire apporté par Bruno Tollon. Le rapport, confié à Louis Peyrusse, sera présenté au cours de la prochaine séance.
L’ordre du jour appelle l’élection d’un membre correspondant. La Compagnie entend le rapport de Maurice Scellès sur la candidature de M. Christian Darles. On procède au vote : M. Christian Darles est élu membre correspondant de notre Société.
Pour remercier Mlle Martine Rieg et M. Georges Cugulières des services qu’ils ont rendus et qu’ils continuent à rendre à notre Société, Louis Latour propose qu’il leur soit attribué la qualité d’invités permanents, proposition favorablement accueillie par la Présidente et tous les membres présents.
Guy Ahlsell de Toulza informe la Compagnie du courrier concernant la statue de Dame Tholose qu’il a adressé au maire de Toulouse. Puis il signale le décès du statuaire toulousain Joseph Giscard, annoncé par la presse locale qui remarque qu’il a connu une fin de vie très précaire. Notre confrère précise que la Ville de Toulouse est l’héritière de ses collections et comme il s’interroge sur une éventuelle protection au titre des Monuments historiques, il est indiqué que les bâtiments sont inscrits sur la liste supplémentaire des Monuments historiques mais que le mobilier n’est pas protégé. Un membre dit que les négociations étaient assez difficiles, mais que des contacts avaient été pris ces derniers temps. On ajoute que des aménagements seraient nécessaires pour que les bâtiments puissent accueillir le public mais qu’aucune décision n’est prise pour le moment. Il est encore rappelé que l’ensemble de cette affaire n’est pas aussi simple qu'on pourrait le penser.
La parole est à Géraldine Cazals pour une communication sur Le Catalogue et summaire de la fondation, principales coutumes… de Tholoze de Guillaume de la Perrière, publiée dans ce volume (t. LXV, 2005) de nos Mémoires.
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 286
La Présidente remercie Géraldine
Cazals d’avoir fait pour nous le point de ses découvertes et de nous avoir
présenté ce manuscrit inédit. Les mentions des inscriptions de la cathédrale
Saint-Étienne peuvent alimenter notre connaissance du cloître. La Présidente demande si
Guillaume de La Perrière a donné une liste des évêques de Toulouse. Géraldine Cazals
répond par la négative en soulignant que le propos de notre auteur n’est pas
l’histoire religieuse et qu’il se concentre sur l’histoire politique
municipale. On pourrait imaginer une certaine réticence, en 1540, à évoquer
l’Église romaine pour quelqu’un dont l’entourage est ouvert au
protestantisme et qui se compose en tout cas d’humanistes.
Patrice Cabau fait
observer que Quitterie Cazes a parfaitement situé les inscriptions du cloître de
Saint-Étienne, et que les inscriptions dont fait état le manuscrit de de La Perrière
ont également été mentionnées par Noguier puis Catel. Daniel Cazes ajoute qu’il
s’agissait d’inscriptions médiévales et non antiques.
Henri Gilles souligne tout
l’intérêt de la communication de notre consœur concernant la pensée politique
des Toulousains dans la première moitié du XVIe siècle. D’une part se
fait jour la nécessité de procéder à la récupération des archives alors bien mal en
point, mais nous assistons d’autre part à une première résistance à la
centralisation monarchique, qui se manifeste déjà au XVe siècle mais
s’exprime surtout au début du siècle suivant. Les notaires toulousains s’en
tiennent au minimum pour l’application de l’édit de Villers-Cotterêts qui
impose le français pour la rédaction des actes. En 1522, l’édition du texte des
coutumes provoque des attaques de la part de l’Université, qui juge qu’il se
réfère au droit romain mais pas au droit de Justinien, avec une influence de la
monarchie beaucoup plus impérative qu’au XVe siècle, et il suffit en
effet de constater l’importance du sénéchal dans la désignation des capitouls.
L’élite toulousaine réagit.
François Bordes
souligne que c’est en 1528 qu’est prise la première décision de faire une
copie du cartulaire municipal AA3. Il ajoute que les capitouls avaient le pouvoir de créer des
notaires, pouvoir qui est remis en cause par l’administration royale et il
s’ensuit une enquête. La Ville fait valoir des arguments tirés de l’Antiquité
et de la période des comtes pour justifier son privilège. Trois personnages ont alors un
rôle prépondérant : Jean Balard, Pierre Salamon et Guillaume de La Perrière.
François Bordes dit avoir essayé de reconstituer la tradition de l’histoire des
comtes de Toulouse et il cite la généalogie placée en introduction à la chronique de
1490-1491 des Annales : pourquoi cette année-là ?
La discussion se
poursuit sur les emprunts à Bernard Guy, sur les apports et les rôles de Nicolas
Bertrand et de Bernard de Rousergue, sur la localisation des manuscrits et sur la non
exécution par leurs successeurs de la décision prise par les capitouls de 1527-1528 de
copier le manuscrit AA3.
SÉANCE DU 22 FÉVRIER 2005
Présents :
Mme Pradalier-Schlumberger, Présidente, MM. Cazes, Directeur, Scellès, Secrétaire
général, Cabau, Secrétaire-adjoint ; Mme Napoléone, Mgr Rocacher, MM.
Bordes, Hermet, Prin, membres titulaires ; Mmes Czerniak, Félix-Kerbrat,
Fournié, Fronton-Wessel, Jiménez, M. Stouffs, membres correspondants.
Excusés : Mme Suau, Bibliothécaire-Archiviste, M. Latour, Bibliothécaire-adjoint.
Invitée : Mme Martine Jaoul.
La séance se tient à partir de 17 h en l’église Notre-Dame-du-Taur. Jean-Marc Stouffs présente à la Compagnie la peinture murale figurant la généalogie de Jacob selon saint Matthieu (I, 1-15), dont il a achevé la restauration au mois de décembre 2004. La Présidente félicite notre confrère pour un résultat final « absolument extraordinaire », révélant tout ce que laissait espérer la restauration partielle que les membres de notre Société avaient pu voir le 11 mai 2001 (M.S.A.M.F., t. LXI, p. 241-243).
Michèle Pradalier-Schlumberger ayant relevé que le fond de la peinture n’avait pas été mis en couleur, M. Stouffs précise qu’il était à l’origine parsemé d’étoiles dorées à la feuille d’or, et que les couronnes des personnages étaient traitées de même. Notre confrère souligne la diversité et la sophistication des techniques employées dans la réalisation de cette œuvre, qui est fondamentalement une peinture a secco : on ne trouve pas en effet, notamment sur la longueur, entre les deux registres, les sutures caractéristiques de la jonction des panneaux de mortier successifs (giornatas) d’une peinture a fresco. Après avoir donné des indications sur la préparation du support, M. Stouffs montre combien il est aberrant de parler de « semi-fresque ».
Mgr Rocacher s’inquiète de la protection de la peinture restaurée contre l’humidité et la pollution. Jean-Marc Stouffs répond que le problème du mur support n’a malheureusement pas été traité avant son intervention, mais qu’il n’y a pas pour le moment de remontées capillaires ; il ajoute qu’il aurait d’abord fallu déposer la boiserie qui couvre la base de la paroi, puis il donne un aperçu des diverses méthodes possibles pour pallier le risque d’humidité. Quant à la pollution,
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 287
elle est minime à l’intérieur de l’église, où ne se produit qu’un « encrassement normal ». Bien plus cruciale apparaît la protection contre le public, toujours tenté de toucher ce qu’il voit : l’état de la zone inférieure de la peinture, nettement plus lacunaire que le registre du haut, témoigne assez de cette propension. On rappelle que les mesures à envisager pour la préservation de cette œuvre sont du ressort de la Conservation des Monuments Historiques.
Patrice Cabau réagit à propos de la datation avancée pour cette peinture : Robert Mesuret la plaçait dans la première moitié du XIVe siècle, et il a été question dans l’exposé de la fin du XIIIe. Jean-Marc Stouffs s’en rapporte aux conclusions de Virginie Czerniak, qui propose effectivement, en se fondant sur des comparaisons stylistiques, de situer cette réalisation aux alentours de 1300. Michèle Pradalier-Schlumberger souligne le caractère précieux du style, sans équivalent à Toulouse ou dans sa région, et qui paraît très proche de la manière parisienne de l’époque ; elle note en particulier la finesse du traitement des visages, la grande qualité des drapés. M. Stouffs fait remarquer néanmoins la répétition de stéréotypes, certaine maladresse dans le dessin des mains, ainsi que le débordement de plusieurs inscriptions par rapport au cadre initialement prévu : les lettres qui les composent ont été tracées après exécution des personnages et des phylactères que ceux-ci présentent.
Daniel Cazes appelle l’attention sur le décalage de la composition peinte par rapport à la travée, désaxement qui laisse sur la gauche un emplacement vide ; l’étrangeté de cette disposition est d’autant plus sensible que la peinture est bien délimitée par sa bordure à frise et les quatre écussons qui la cantonnent. Cette bizarrerie peut s’expliquer par le fait que s’élevait jadis à cet endroit la chaire de maîtrise de la confrérie qui aurait eu son banc au-dessous de la peinture. Interrogé au sujet de cette confrérie, François Bordes dit qu’on ne connaît pas d’association de métier qui ait eu son siège en l’église du Taur. Au titre des curiosités, Jean-Marc Stouffs signale la présence, sur la limite inférieure et sur la limite droite de la peinture, de baguettes de bois incluses dans le mortier et destinées à une fonction non identifiée.
SÉANCE DU 1er MARS 2005
Présents : MM. Cazes, Directeur, Ahlsell de Toulza,
Trésorier, Scellès, Secrétaire général, Mme Suau, Bibliothécaire-Archiviste, MM.
Cabau, Secrétaire-adjoint, Latour, Bibliothécaire-adjoint ; Mme Napoléone, M.
Bordes, le Père Montagnes, MM. Peyrusse, Prin, Mgr Rocacher, M. Tollon, membres
titulaires ; Mmes Bayle, Cazals, Jiménez, M. Darles, membres correspondants.
Excusés : Mme Pradalier-Schlumberger, Présidente, M. Garland.
Le Directeur ouvre la séance en demandant à la Compagnie d’excuser l’absence de notre Présidente, actuellement en voyage, et il souhaite la bienvenue à M. Christian Darles, nouvellement élu membre correspondant.
Le Secrétaire général donne lecture du procès-verbal de la séance du 1er février, qui est adopté après quelques corrections.
Le Directeur rend compte de la correspondance manuscrite. À côté de plusieurs invitations et annonces de colloque, c’est une lettre de notre confrère André Hermet qui sollicite son classement au titre de membre libre de notre Société. Daniel Cazes rappelle les nombreuses publications d’André Hermet, et en particulier sa bibliographie toulousaine. À l’unanimité des membres présents, André Hermet est élu membre libre.
Notre bibliothèque s’enrichit du don, fait par les Archives municipales de Toulouse, de 15 volumes du Bulletin de la Société académique des Hautes-Pyrénées, qui complètent fort bien notre collection.
L’ordre du jour appelle le rapport sur le concours, présenté par Louis Peyrusse :
« M. Julien Lugand a présenté en décembre 2004 devant l’Université de Toulouse-Le Mirail une thèse de doctorat Peintres et doreurs en Roussillon (1650-1730), préparée sous la direction de notre confrère Bruno Tollon. Le jury de cette thèse, présidé par Michel Hochmann (École Pratique des Hautes Études), composé de Bruno Tollon (rapporteur), de Mme Ariane James-Sarazin, de Joaquim Garriga (Université de Gérone) et de Michel Brunet (U.T.M.), lui a conféré le titre de docteur avec la mention Très Honorable et les félicitations du jury à l’unanimité. Il soumet ce travail (2 vol. : 879 p. dont 79 pl.) au jugement de notre Société.
En fait, le second volume (p. 421-794) correspond au travail principal de Julien Lugand et se présente sous une apparence austère : un dictionnaire biographique des peintres et doreurs dont les traces, importantes ou menues, ont été retrouvées dans un énorme corpus d’archives intégralement dépouillées : 3000 cotes d’archives notariales, 135 livres de comptes de confréries ou de fabriques, 200 liasses concernant le clergé,
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 288
100 cotes dans le fonds de justice (non classé) aux Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, sans compter les archives des confréries conservées in situ. Ce dictionnaire est accompagné de pièces justificatives : les statuts et procès-verbaux du Collège Saint-Luc (1629-1727). Il s’agit là d’un outil documentaire tout à fait remarquable pour lequel il faudrait inventer une édition électronique.
La thèse, présentée dans le premier volume, ne se borne pas à la réécriture des fiches. Julien Lugand a risqué une synthèse au carrefour de l’histoire de l’art, de l’histoire du goût et de l’histoire sociale. Le cadre de la Province du Roussillon appelle des comparaisons systématiques avec des centres bien étudiés : Venise, Bologne, les Provinces-Unies, Paris – comparaisons un peu écrasantes car on ne dispose pas d’enquête systématique pour les provinces françaises.
La première partie s’intéresse au métier et à son organisation. Un collège placé sous l’invocation de saint Luc est créé en 1630 puis refondé en 1698 : il s’agissait pour les maîtres peintres et doreurs et sculpteurs de se séparer des autres corps de métiers trop dominateurs (orfèvres, menuisiers…) et de régenter le milieu professionnel : essentiellement de se protéger de la concurrence extérieure (artistes venus d’ailleurs et marchands), d’organiser la formation. La première confrérie n’a connu qu’une existence éphémère du fait de l’histoire. En 1698, on souhaite organiser l’apprentissage (sept ans au maximum) en privilégiant les enfants et les gendres des maîtres et séparer les deux métiers de peintre et de doreur. Si l’organisation reste simple (un recteur, un syndic, un bedeau), c’est qu’elle ressemble aux autres corporations régissant les métiers manuels : cordonniers, maçons… L’apprentissage reste limité à la reproduction du geste magistral ; il n’y a aucune inspiration libérale ou académique. Il s’agit à l’évidence de protéger l’accès au métier. Toutefois, la compétence du collège reste limitée à Perpignan et à ses alentours. Le contrôle professionnel ne pouvait guère aller plus loin et il s’appliquait rarement aux maîtres en place.
À suivre les actes livrés par les archives, on mesure combien l’apprentissage est long et traditionnel. L’apprenti (au singulier car ils sont rarement nombreux) entre dans l’atelier du maître en payant une redevance fort modeste ; il est exploité “en toutes choses honnêtes et licites” par ce maître et sa famille. L’âge est assez avancé (16 ans), le milieu social désespérément homogène, la formation s’acquiert sur le tas (plus dans l’atelier que sur les chantiers), elle n’a rien d’intellectuel ou même d’artistique si l’on suit la lettre des contrats.
Officiellement le compagnonnage qui devrait suivre n’existe pas à Perpignan. Il est déguisé en apprentissage prolongé (permettant de rentabiliser la formation) ou en aide familiale. La maîtrise est très précisément réglementée : attestation d’apprentissage, enquête de bonne vie et mœurs, examens sur lequel les sources sont assez laconiques, trois dessins dont l’un est à la base d’un tableau, ou dorure et peinture d’une statue. La dernière étape de l’admission au collège est plutôt formelle, l’approbation des consuls de la ville. Le système mis en place est très protectionniste, il favorise fils et gendres de maître, il refuse tout candidat étranger à la profession et à la Province.
Alors que le Roussillon a été une terre de passage accueillante aux artistes venus d’ailleurs, la situation se fige et se ferme : les deux tiers des maîtres recensés sont roussillonnais, un petit tiers vient du Languedoc ou de la Catalogne. De 1650 à 1730, le nombre d’artistes-artisans est restreint : 60 dont 23 doreurs, 21 peintres-doreurs, 16 peintres, concentrés surtout à Perpignan. Les ateliers de peintres sont sédentaires alors que les doreurs sont requis sur des chantiers extérieurs. Les étrangers itinérants (ils existent !) doivent surtout éviter Perpignan et bouger avant tout contrôle.
La place de ces peintres-doreurs dans la société du temps peut assez justement être appréhendée. Ils ne se distinguent pas des autres professions manuelles et artisanales ; l’ascension sociale y reste exceptionnelle, l’exemple le plus éclatant étant fourni par Hyacinthe Rigaud qui fait toute sa carrière hors du Roussillon. Les inventaires sont cruels : fortune moyenne médiocre, habitat ordinaire (quatre pièces pour un peintre-doreur moyen, douze pièces dans une maison bourgeoise), mobilier insignifiant… Pas de riche mariage, pas d’héritage. Le bilan tracé par Julien Lugand est désolant. Il est vrai que le seul luxe recherché concerne les funérailles (nombre de prêtres, nombre de messes…). Les doreurs qui manient du métal précieux ne semblent pas s’être plus enrichis que les peintres : la seule échappatoire est de pratiquer d’autres activités : l’affermage, le commerce.
Donc un milieu étroit, fermé, médiocre. Circonstance aggravante, peu de culture. Dans les inventaires après décès, les livres sont rarissimes. Seul Antoine Guerra le Jeune possède cinquante-deux livres (dont le Traité sur la peinture de Léonard et un Traité de perspective). Il est le seul à posséder un ensemble conséquent de gravures, ce qui permet d’appréhender sa culture visuelle aux carrefours de mouvements européens. Les peintres sont à l’image de leurs commanditaires, incapables de fournir des modèles venus de Paris ou de Rome : on ne note que quelques tapisseries, quelques tableaux romains commandés par accident pour un retable de la cathédrale.
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 289
Les métiers de peintre et de doreur, séparés vers 1675-1680, sont analysés dans la deuxième partie de l’ouvrage.
Les doreurs travaillent sur des chantiers qui les font beaucoup bouger : ils sont alors logés et nourris par les communautés qui financent, se font aider par leur famille. Ils ne s’enrichissent guère. L’or en feuille (qui vient de Toulouse) ne vient pas farder l’ordinaire des jours : c’est que les commanditaires ont beaucoup de mal à réunir les 2 000 livres nécessaires, en moyenne, à la dorure d’un retable : ils fragmentent les chantiers, étalent leurs versements ; les délais sont très larges. Les artisans s’adaptent. Un chapitre passionnant analyse la conduite des chantiers : échafaudage (ou plus rarement démontage), nettoyage, apprêt, travail d’incision, dorure et enfin polychromie, car il faut ensuite “étoffer et incarner”. La technique la plus savante concerne les étoffes somptueuses (brocart, damas) : on peint sur la dorure puis, par la technique du sgraffito, on gratte jusqu’à l’or les motifs du brocart ; la peinture gagnant grâce au fond d’or un éclat exceptionnel.
Pour gagner leur vie, les doreurs exécutent d’autres travaux : statues et petit mobilier de papier mâché, argenture de devants d’autel. La dorure des bordures de tableaux est l’activité la plus rémunératrice. Ces cadres dorés (fort chers) sont paradoxalement assez répandus. L’analyse du travail des doreurs se termine par un exemple révélateur, le retable des saintes Eulalie et Julie à la cathédrale de Perpignan, dont Julien Lugand analyse le livre de comptes.
Les peintres travaillent dans leur estudi (qui ne fait qu’un avec la botiga). Cet atelier a le plus souvent une structure familiale. On y trouve des toiles prêtes à la vente, le plus souvent d’imagerie religieuse, ce qui laisse supposer que les commandes sont rares. Ces commandes, qui correspondent aux tableaux les plus savants, ne font pas l’objet de contrat, hélas. Sans doute peintre et commanditaire s’entendent-ils sur un modèle gravé restreignant d’autant la part d’invention de l’artiste. Il faut ajouter que les prix pratiqués sont très bas. Seuls les Guerra arrivent à atteindre 70 livres pour quelques tableaux importants, la taille (et non le nombre de personnages, la difficulté des sujets) restant le critère essentiel de l’évaluation. On peut se douter que le salaire des peintres est faible.
Pour autant, bon nombre de toiles sont accrochées sur les murs des intérieurs roussillonnais. Les inventaires après décès (dont Julien Lugand a pris un double échantillon) montrent que la bourgeoisie possède en moyenne 8 tableaux en 1650 et 10 en 1730. Il arrive même que des artisans, des boulangers, des paysans en aient. L’analyse assez fine permet de noter la distinction suivant les classes sociales : nobles, bourgeois, religieux, artisans… sans qu’on puisse parler d’un goût pour la peinture et encore moins d’une culture de la curiosité ; pas de collection, pas de tableau hors les murs de la ville, mais des gravures un peu partout. À l’évidence, les tableaux sont d’abord des objets de dévotion (75 % ont un sujet religieux en 1650, cette proportion baisse par la suite). La peinture de genre décline alors que les portraits se multiplient. Il faut ajouter que le peintre pratique d’autres techniques : le dessin – mais ceux-ci sont rares –, les décors muraux dans les couvents, les églises, les maisons, la peinture d’armoiries (pour les obsèques ou les fêtes), les étendards des confréries, la peinture sur papier pour des décors de fête et jusqu’à la peinture en bâtiment ! Marginalement, il faut mentionner des calligraphies, quelques peintures sur cuir et, bien entendu, la restauration d’œuvres anciennes ou de décors réemployés.
Pour échapper à un constat désolant, l’auteur termine par un “profil” de l’atelier des Guerra – sur lequel il doit revenir dans un catalogue d’exposition en 2005. Deux générations, trois noms : Antoine Guerra le Vieux (+ 1705) est formé par Antoine Ranc à Montpellier. Premier recteur du Collège Saint-Luc en 1698, il exécute avec un certain métier des tableaux au schéma préétabli et à l‘iconographie répétitive. Son fils Antoine le Jeune (+ 1711) est le plus brillant, le plus cultivé, on l’a vu. Ayant exécuté un portrait de Philippe V, il peut se parer du titre de « Peintre de Sa Majesté ». Dans des toiles abouties, il fait entrer des références européennes (Raphaël, Pierre de Cortone, Ribera, Le Brun). Le huitième enfant, François (+ 1729), revient à une conception plus traditionnelle du métier.
Le travail de Julien Lugand présente des conclusions plutôt désolantes, mettant au jour une histoire immobile, un milieu fermé, médiocre, préoccupé d’intérêts vitaux, très éloigné de l’étincelle de la création (il faut rappeler que les peintres-doreurs ne sont pas à cette époque des artistes essentiels : l’art majeur est la sculpture). Pour autant, il s’agit d’un travail exemplaire, au caractère pionnier, mené de façon magistrale. Le livre posthume d’Antoine Schnapper, Le métier de peintre au grand siècle, paru après la thèse, a montré que la réalité parisienne était loin des images d’Épinal répandues. Julien Lugand explore une province lointaine sur la base d’une enquête exhaustive avec des questionnements intelligents empruntés à la sociologie de l’art et l’histoire culturelle. Il échappe à la myopie campaniliste des travaux enfermés dans un lieu : il offre une base à des comparaisons à venir.
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 290
Je recommande très chaleureusement à la Société de le couronner en lui décernant le prix le plus élevé mis au concours.
Louis PEYRUSSE »
Le Directeur remercie Louis Peyrusse pour ce rapport très détaillé qui permet d’apprécier pleinement le contenu et les qualités du travail du candidat. Puis il sollicite Bruno Tollon, qui confirme le rapport. À l’unanimité des suffrages des membres présents, le prix de Clausade 2005, doté de 450 € et accompagné d’une médaille d’argent, est décerné à M. Julien Lugand.
La parole est à Bernard Montagnes pour une communication sur Les constructions des Dominicains entre la rue Vélane et la rue Espinasse (au XIXe siècle), publiée dans ce volume (t. LXV, 2005) de nos Mémoires.
Le Directeur remercie bien vivement le Père Montagnes pour cette communication très précise, en rappelant que si notre confrère a consacré une grande part de sa vie à l’étude de l’architecture dominicaine médiévale, il a aussi manifesté un grand intérêt pour le XIXe siècle. Il faudra publier tous ces documents qui, sur une période assez brève, fournissent des dates précises et éclairent sur les événements et les intentions. On regrettera bien sûr toujours la destruction de trois travées de l’hôtel de Mansencal, mais que reste-t-il aujourd’hui des constructions dominicaines du XIXe siècle ? Bernard Montagnes indique que tout a été détruit par le promoteur immobilier, conséquence d’une spéculation foncière qui a joué à plein.
Avant de céder la parole à Louis Peyrusse, Daniel Cazes note que les photographies de l’amorce du cloître montrent une architecture d’inspiration toscane et qui ne manquait pas d’allure. Louis Peyrusse ajoute que l’architecture est à l’évidence assez proche de celle de l’église des Jésuites ; il admire surtout dans le plan de Bach la capacité qu’a l’architecte de tout agencer dans une surface très réduite. Puis il demande si l’on a des informations sur les auteurs des sculptures de l’église, dont les modèles semblent être les œuvres de l’atelier de la chapelle de Rieux. Maurice Prin précise qu’elles étaient en stuc. Bernard Montagnes suppose que l'absence de toute information sur ces sculptures tient au fait qu’une grande partie de la documentation du Père Cormier a été distraite des archives pour être jointe au dossier de béatification de Lacordaire.
Bernadette Suau observe que notre confrère a beaucoup insisté sur les difficultés financières liées à la construction du premier établissement, alors qu’il n’a pas du tout évoqué cet aspect pour le deuxième. Bernard Montagnes explique que l’on dispose des pièces publiées à l’occasion du procès fait en 1876 pour régler la succession de Lacordaire, alors que la documentation fait ensuite défaut.
Maurice Scellès demande s’il faut penser que Du Mège ait pu fournir les dessins du mobilier. Bernard Montagnes affirme que non, et Daniel Cazes comme Louis Peyrusse n’y croient pas non plus.
SÉANCE DU 15 MARS 2005
Présents : Mme Pradalier-Schlumberger, Présidente,
MM. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Scellès, Secrétaire général, Mme Suau, Bibliothécaire-Archiviste,
MM. Cabau,
Secrétaire-adjoint, Latour,
Bibliothécaire-adjoint ; Mme Watin-Grandchamp, MM. Bordes, Gilles, le Père
Montagnes, MM. Peyrusse, Prin, Roquebert, Testard, membres titulaires ; Mmes Andrieu,
Cazals, Félix-Kerbrat, Fournié, Guiraud, Jefferson, MM. Barber, Darles, Stouffs, membres
correspondants.
Excusés : M. Cazes, Directeur, Mmes Cazes, Pousthomis-Dalle, M. Garland.
Invitée : Mlle Rieg.
La Présidente ouvre la séance à 17 h et annonce un ordre du jour assez chargé. Mais elle tient auparavant à faire part à notre Compagnie de deux disparitions douloureuses : celle de Pierre Bonnassie, professeur d’Histoire médiévale à l’Université de Toulouse-Le Mirail, et celle de Michèle Gaborit, professeur d’Histoire de l’Art médiéval à l’Université de Bordeaux, décédés tous les deux après une « longue maladie ».
Invitée à dire quelques mots sur Pierre Bonnassie, Michelle Fournié déclare qu’elle ne s’attendait pas à devoir prononcer l’éloge de son collègue, certes depuis longtemps très malade, mais dont la disparition vient de survenir brusquement (14 mars 2005) ; nul doute que la mort ait été pour lui une délivrance. Rassemblant des souvenirs dont les plus anciens remontent à une quarantaine d’années, Mme Fournié évoque la figure de Pierre Bonnassie, sa surprenante nonchalance d’allure, si peu « universitaire », son éternelle cigarette, sa profonde érudition, son goût de
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 291
la lecture, et pas seulement d’ouvrages d’histoire, son sens de l’échange : livres, idées… Ce professeur apprécié, qui savait rendre intéressantes jusqu’aux reprises d’exposés de ses étudiants, a formé des générations de chercheurs, suscité et dirigé des thèses remarquables. Le Midi de la France et le Nord de l’Espagne perdent avec lui un historien de première valeur.
Passant à l’ordre du jour, la Présidente fait état de la correspondance manuscrite, qui comprend entre autres l’annonce de deux manifestations : la Journée du Patrimoine de Pays, 8e année, à tenir le 19 juin 2005, et le 11e Salon du livre d’Histoire, organisé à Mirepoix le 3 juillet 2005. Puis nos confrères Bruno Tollon et Henri Pradalier expriment à notre Société toute leur gratitude pour la mise à disposition des salles de lecture et des séances, prêtées pour les accueillir avec leurs étudiants à la suite de l’explosion de l’usine AZF.
Notre Bibliothèque s’enrichit de divers ouvrages, pour la plupart offerts par Bruno Tollon, en témoignage de sa reconnaissance :
- Patrice Cabau, « Réflexions sur
la nouvelle édition du cartulaire de Saint-Sernin », extrait de Heresis - Revue
semestrielle d’Histoire des Dissidences médiévales, n° 41, automne/hiver 2004,
Carcassonne, Centre d’Études Cathares/René Nelli, 2005, p. 137-149 ;
- Bruno Tollon,
tirés-à-part de plusieurs articles parus dans les Congrès archéologiques de France
et la Gazette des Beaux-Arts ;
- Bruno Tollon, Les
retables sculptés en Roussillon et en Cerdagne française au XVIIIe siècle,
thèse de 3e cycle dirigée par Paul Guinard, Université de Toulouse-Le
Mirail, novembre 1972, 202 p. ;
- Toulouse-Bologna :
deux villes, une culture, catalogue d’exposition, mairie de Toulouse, 1981, 171
p. ;
- Jean Mesqui, Châteaux
et enceintes de la France médiévale. De la défense à la résidence, 2, La
résidence et les éléments d’architecture, Paris, Picard, 1993, 383 p. ;
- Valérie Nègre, L’ornement
en série. Le monde du bâtiment et la standardisation des produits en terre cuite et des
matériaux de construction au XIXe siècle dans le Midi toulousain,
thèse de doctorat dirigée par Pierre Pinon et André Guillerme, Université Paris-VIII
(Vincennes-Saint-Denis), décembre 2002, 2 volumes, 705 p.
Le Secrétaire-adjoint donne lecture du procès-verbal de la visite du 22 février 2005, qui est adopté.
La parole est à notre consœur Michelle Fournié pour la principale communication du jour, intitulée Les miracles de l’oratoire Saint-Rémésy et les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, publiée dans ce volume (t. LXV, 2005) de nos Mémoires.
La Présidente remercie Mme Fournié pour sa « présentation brillante de textes qui restaient à creuser ». Elle relève le caractère étrange de la série d’« images » disposée sur le mur de l’enclos des Hospitaliers, le long de la rue Saint-Rémézy, et demande si l’on connaît d’autres exemples de murs de clôture portant un décor peint sur la rue. Guy Ahlsell de Toulza, Maurice Prin et Maurice Scellès évoquent les villes italiennes, telle Naples, avec leurs nombreux « oratoires de rue ». À Toulouse, les niches placées aux carrefours et abritant une statuette de saint(e) peuvent apparaître comme des avatars des oratoires pratiqués dans les murs, à la manière des enfeus, et protégés par des grilles. M. Scellès fait observer que dans les textes médiévaux ou modernes le mot de « chapelle » désigne souvent de tels oratoires, et non une petite église.
Mme Fournié souligne l’intérêt
de la documentation qu’elle a exploitée pour la connaissance d’une dévotion
populaire propre à un quartier, dévotion qui se maintient dans le cas étudié de la fin
du XVe siècle au début du XIXe. Bernadette Suau se demande si le
décor en question correspond à l’expression de la piété des habitants du quartier
ou s’il s’agit d’un décor voulu par les commandeurs des Hospitaliers,
empreints de culture méditerranéenne. Guy Ahlsell de Toulza objecte que, dans cette
dernière hypothèse, le décor eût été ostensiblement placé sur la grand-rue.
Louis Latour retrace
l’évolution d’un très ancien culte populaire rendu à Auterive à la Vierge
protectrice de la ville : sa statue, abritée au XIIe siècle dans une
niche pratiquée dans le mur d’enceinte de la cité, fut placée au XVIIIe
siècle dans une chapelle spécialement édifiée sur une plate-forme établie sur le
fossé ; démolie à la Révolution, cette chapelle fut reconstruite en 1859, et elle
existe toujours.
À propos du mur oriental de clôture du Grand-Prieuré, sur la rue Saint-Remézy, François Bordes donne des détails tirés d’un document des archives municipales relatif à la voierie et datable du premier tiers du XVIIe siècle : il y est fait mention de l’oratoire, et le mur est décrit comme bâti avec des morceaux de tombeaux, des fragments de sarcophages. Christian Darles fait observer que, d’après le plan de 1812, cette muraille paraît avoir été d’une épaisseur considérable.
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 292
Concernant la population du quartier Saint-Rémézy évoquée dans le dossier documentaire, Henri Gilles rappelle l’existence à la fin du XVe siècle de l’« abbaye » ou maison de prostitution de la Madeleine, et Guy Ahlsell de Toulza note qu’on trouvait encore en 1761, au moment de l’affaire Calas, un loueur de chevaux dans la rue Saint-Rémézy.
Patrice Cabau relit le texte latin porté par le verso du folio 14 des Gesta Tholosanorum de Nicolas Bertrand, imprimés en 1515 : In cuius Remigii honorem [beatus Germerius] ecclesiam in vico Tholose qui dicitur Sancti Remesii edificari fecit, que protenditur et exit a parte Dealbate quam nunc vocatur Sancti Iohannis, unde et adhuc totus vicus la carriera de Sanct Remesii vocitatur […]. Ecclesiam tamen ipsius Hierosolimitani sub titulo beati Iohannis possident. Il n’y a manifestement aucune difficulté à identifier l’église Saint-Jean des Hospitaliers avec l’église Saint-Rémi qu’aurait fondée l’évêque de Toulouse Germier.
La parole est à notre consœur France Félix-Kerbrat pour une communication brève consacrée à La chapelle Notre-Dame (XVIe siècle) de l’église Saint-Exupère de Coupiac (Aveyron) :
« La paroisse de “Sancte Superie” n’est citée que dans deux documents datés de 1341 et 1476. L’église (dont le vocable est unique en Rouergue) n’apparaît dans aucun pouillé ou autre document officiel avant le XVIIe siècle ; peut-être parce que, de 1620 au début du XIXe siècle, elle est portée dans les registres paroissiaux comme annexe de Saint-Martin de Plaisance. L’étude de l’architecture et de la sculpture de l’édifice actuel permet de la dater (comme pour beaucoup d’églises dans le Vabrais) de la période qui a suivi la Guerre de Cent Ans et qui a vu la reprise économique.
Coupiac, église Saint-Exupère. Vue générale.
Cliché M. Kerbrat.Situé dans un très beau site de vallée étroite, le hameau de Saint-Exupère est formé de trois ou quatre maisons regroupées autour de l’église construite au confluent de deux ruisseaux et contre la montagne à laquelle elle est adossée par son côté nord. De cette situation viennent les nombreux problèmes, dus aux infiltrations d’eau, que l’église a toujours connus. Or à aucune époque la paroisse n’apparaîtra comme très riche, d’où le mauvais état permanent, et encore aujourd’hui, de ce monument.
L’église, longue de 15,50 mètres hors œuvre pour 6 mètres de large, est composée d’une nef unique à deux travées, voûtées de croisées d’ogives du XIXe siècle, ouvrant à l’est sur un chevet plat renforcé par deux contreforts aux angles et de deux chapelles formant transept. La chapelle Notre-Dame, au nord, est mentionnée comme chapelle du Rosaire vers 1839. La chapelle sud, dite depuis 1828 de Saint-Amans, a eu plusieurs noms avant la Révolution : de saint Antoine, en 1636, de Monsieur de Monteillet, en 1679 (puisque cette famille y avait sa sépulture), et de saint Exupère, en 1691. De forme barlongue, le clocher, épaulé de deux contreforts, est construit au-dessus de la chapelle méridionale.
Par leur forme et leur décor, les trois fenêtres de l’église rappellent l’époque gothique. Dans les parties anciennes, chœur et chapelles, la voûte est formée d’ogives supportées par des culots sculptés et les clefs pendantes, très décorées, sont ornées de blasons qui sont encore à l’étude.
La chapelle Notre-Dame
C’est la partie la plus intéressante de l’église avec sa voûte construite en étoile, à liernes, tiercerons et cinq clefs pendantes, et un riche décor sculpté.
Sur la clef centrale au fond étoilé, Dieu est représenté de face, à mi-corps, barbu et coiffé d’une tiare à triple couronne. Il bénit de la main droite et porte un globe crucifère dans la main gauche… Cette représentation de Dieu coiffé de la tiare, symbole de la papauté, apparaît dans les missels dès la fin du XVe siècle. Faite pour illustrer le canon de la messe, cette iconographie, en face de celle de la Crucifixion, ornait les livres liturgiques réservés aux prêtres.
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 293
Coupiac, église Saint-Exupère. Plan. Dessin R. Aussibal.
Sur les quatre clefs qui l’entourent sont sculptés les symboles des évangélistes : l’aigle (saint Jean), l’ange (saint Mathieu), le lion (saint Marc) et le taureau (saint Luc) ; la partie pendante des clefs est entièrement décorée de végétaux avec, en plus, sur la clef représentant le symbole de saint Jean et situées de part et d’autre : une tête et un crâne. La partie figurative des clefs est au centre d’un couronnement végétal ou lié, forme artistique de la Renaissance, traitée ici avec une certaine exubérance.
Les culots qui supportent la retombée des ogives sont également sculptés :
- au nord-ouest, saint Pierre porte le Livre et les clefs ; il est apôtre et symbole de l’Église.
- au nord-est, saint Jacques pèlerin avec chapeau, bourdon et gourde ; il est aussi apôtre, car il porte le Livre. Pour quelle raison est-il représenté ici ? Est-ce le saint patron du fondateur ?
- au sud-est, des têtes, des animaux et des végétaux mêlés ; l’identification est difficile car une partie de la sculpture est cachée par la chaire ;
- au sud-ouest un ange auréolé, souriant, est représenté à mi-corps. Vêtu d’une tunique très ornée, il présente un écu de forme italienne (XVIe siècle), chargé en chef d’une lettre M onciale suivie d’un I patté et au-dessous d’un S et d’un a ; le dernier motif serait simplement décoratif. On lit donc “misa”, mot latin pour dire messe mais en partie orthographié comme le mot occitan “mesa”. Cette affirmation de la messe prend toute sa valeur avec la sculpture suivante.
À l’entrée de la chapelle, sur la partie droite du mur et en continuité avec la sculpture de l’ange, un relief attire l’attention : sur un fond décoré de fleurs, deux personnages nimbés et agenouillés, présentent un calice surmonté d’une hostie. Il est assez surprenant de trouver dans ce thème des saints et non des anges (représentation traditionnelle). Cette glorification du sacrement de l’Eucharistie, reprise et accentuée par l’inscription “messe”, s'inscrit parfaitement dans le programme iconographique sculpté de la chapelle.
Il semblerait qu’il existe, symétriquement sur la partie droite du mur d’entrée de la chapelle une
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 294
Coupiac, église Saint-Exupère. Voûte de la chapelle Notre-Dame.
Cliché M. Kerbrat.Coupiac, église Saint-Exupère. Chapelle Notre-Dame. Clef centrale : Dieu bénissant et tête de mort sur la clef de saint Jean.
Cliché M. Kerbrat.Coupiac, église Saint-Exupère. Chapelle Notre-Dame. Clef avec le lion de saint Marc.
Cliché M. Kerbrat.Coupiac, église Saint-Exupère. Chapelle Notre-Dame. Culot : ange avec blason. Relief : deux personnages portent le calice.
Cliché M. Kerbrat.
sculpture, malheureusement aujourd’hui cachée par la chaire. Rien n’ayant été laissé au hasard dans ce programme sculpté, on peut supposer que son sujet vient compléter l’iconographie de l’ensemble.
Cette vision du Christ-Dieu entouré du tétramorphe est un thème de Salut bien connu dans la région puisqu’il est également présent sur les clefs de voûte de la chapelle de la Vierge dans la collégiale de Saint-Sernin-sur-Rance. Mais à Saint-Exupère l’accent est mis, en plus, sur les symboles de la papauté et donc la prééminence de l’Église de Rome, ainsi que sur l’importance de la messe, sans oublier la méditation sur la vie et la mort avec la présentation double de la tête du Vif et du Mort. Ce thème du “Memento mori” (Souviens-toi de mourir) apparaît dans le premier tiers du XVIe siècle sur les grains en ivoire des Rosaires sous la forme de deux têtes accolées. Mais peut-on dire pour autant que la chapelle ait été dès le XVIe siècle consacrée à Notre-Dame du Rosaire, appellation qui apparaîtra dans le livre de paroisse au début du XIXe siècle ? N’est-ce pas plutôt le signe d’une chapelle funéraire ?
Au sommet de l’arc d’entrée de la chapelle Notre-Dame, une sculpture en gros relief étonne : deux personnages présentent un blason dit « à l’italienne ». Il s’agit d’un blason royal : trois fleurs de lys surmontées d’une couronne. Pourquoi ce blason à Saint-Exupère ? Faut-il y voir un rapprochement avec Saint-Sernin, siège d’une justice royale depuis 1486 environ ? Le magistrat aurait ainsi honoré son roi à l’entrée de sa chapelle ? Peut-être y a-t-il une autre explication : le Rouergue est revenu dans le domaine royal après la guerre de Cent Ans et par l’emblème sculpté ici on demande la protection du roi tout en réaffirmant son appartenance à la Couronne. Un exemple proche vient renforcer cette hypothèse : il s’agit de la représentation du même thème sur une clef de voûte réemployée sur la façade de l’église voisine de Miolles (Tarn).
Les sculptures de Saint-Exupère sont probablement dues à un atelier itinérant qui, pour les thèmes, s’inspire des gravures qui circulaient et dont le style est influencé par les œuvres de l’Albigeois voisin. C’est un art “populaire” de bonne qualité et qui ne manque pas de charme. Il nous paraît opportun de dire qu’il existe dans le voisinage plusieurs clefs de voûte, en place ou réemployées, très proches par leur style et leur iconographie de celles de Saint-Exupère : à Balaguier, représentation d’une Vierge à l’Enfant, et à Miolles, Dieu le Père bénissant et couronné de la tiare… Nous avons là les œuvres d’un même atelier de sculpteurs du XVIe siècle.
Enfin il est évident qu’à Saint-Exupère la qualité de la sculpture n’est pas la même sur les œuvres de la chapelle et sur les culots du chœur. Pour ces derniers on peut penser qu’à côté des lapicides itinérants, certains tailleurs de pierre, pour décorer leur église, se sont essayé avec succès à la sculpture. En effet nous sommes ici dans une région où
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 295
le grès abonde ; les carrières de grès blanc de La Molière (connues et exploitées depuis très longtemps) sont sur la paroisse de Saint-Exupère et toutes proches de l’église ; le matériau a servi pour la construction et la sculpture de l’édifice ; tailleurs de pierre et sculpteurs travaillaient ensemble sur le chantier.
Le retable
Coupiac, église Saint-Exupère. Chapelle Notre-Dame. Le retable, vue d’ensemble.
Cliché M. Kerbrat.Le retable est la seconde œuvre de qualité dans la chapelle Notre-Dame. Placé sur le mur oriental, c’est un encadrement en pierre, entièrement sculpté. Haut de 160 cm et large de 165 cm, il entoure une niche (H : 127 cm, L : 105 cm) de 35 cm de profondeur qui abrite aujourd’hui une Vierge à l’Enfant en terre cuite polychrome ; on sait qu’il y avait, au début du XIXe siècle, une Vierge dorée et un tableau en l’honneur de Notre-Dame, commandé en 1828 au peintre de Rodez J.-B. Delmas (qui a d’ailleurs peint pour toutes les églises de la région) ; œuvre protégée par une grille dont il reste des traces. Il est logique de penser qu’il y avait aussi, au XVIe siècle, une œuvre peinte ou sculptée en l’honneur de Notre-Dame.
La corniche et le linteau du retable sont abondamment et finement décorés de petits végétaux. La partie inférieure du linteau est partagée en cinq carrés, occupés chacun par une grosse fleur élégamment travaillée. Les jambages (L : 20 cm, H : 15 cm) sont historiés.
Le jambage de gauche est formé de trois registres (L : 20 cm, H : 33 cm, P : 15 cm) sculptés de scènes lisibles de haut en bas :
- Dieu crée Ève sortie de la côte d’Adam endormi ;
- Le péché originel : Adam et Ève, nus et cachant leur sexe, se tiennent de part et d’autre de l’Arbre du Bien et du Mal sur lequel s’enroule le serpent. Ève cueille la pomme, Adam montre sa gorge et le morceau de fruit qui l’étouffe (même détail que sur le jubé de la cathédrale d’Albi, de la fin du XVe siècle) ;
- Adam et Ève chassés du Paradis : le séraphin, armé de l’épée, chasse le couple du Paradis ;
Le décor de palmettes est présent sur les côtés des trois scènes ; il symbolise le Paradis dans lequel vivent Adam et Ève. L’iconographie représentée ici est connue et assez facile à identifier, mais il n’en est pas de même pour l’autre jambage.
Le jambage de droite est aussi plus difficile à lire en raison de l’usure de la pierre et de l’enduit de chaux qui la recouvre (et qui laisse deviner des traces de couleurs). Sur trois registres et de haut en bas :
- Adam et Ève sont nus dans un espace végétal ; probablement le Paradis, avant la Faute ;
- Deux serpents aux corps enlacés, ouvrent des gueules monstrueuses ; représentation du Léviathan (l’Enfer) ;
- Dieu (au nimbe crucifère tenu par deux anges) unit, au-dessus d’un autel, les mains de l’homme et de la femme ; c’est bien d’un mariage qu’il s’agit.
En fait, on s’aperçoit qu’il faut lire les deux jambages en même temps et horizontalement, la lecture se faisant en parallèle : la Création et le Paradis (Éden), la Faute (le Péché originel) et l’Enfer (image symbolique du Mal), la Punition et la Rédemption (avec la sacralisation du mariage).
Une objection peut être faite pour notre interprétation de la scène du haut : ne pourrait-il pas s’agir du moment où, après la faute, entendant la voix de Dieu, Adam et Ève se cachent parmi les arbres du jardin et Adam répond à Yahvé : “ j’ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché” (Gen. 3, 10) ? Si l’explication de cette scène est logique, par contre sa place dans le récit sculpté ne l’est plus. En effet elle devrait alors, selon le texte de la Genèse, se trouver après la scène de l’Arbre de la connaissance.
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 296
La représentation du jambage de droite est étonnante. Selon l’iconographie habituelle de ce thème, on s’attendrait à trouver Adam et Ève travaillant sur terre ou souffrant dans les Limbes ; puis Dieu qui, ayant pardonné, va les chercher. Mais ici le travail a été supprimé ; on a préféré insister sur le péché et le mal ainsi que sur le mariage d’Adam et Ève : “c’est pourquoi l’homme quitte son père et sa mère et s’attache à sa femme et ils deviennent une même chair” (Gen. 2, 24). Ce dernier sujet (représenté ainsi vers la fin du Moyen Âge dans la Bible moralisée) est placé dans cet ensemble en fin d’histoire afin qu’on le voie mieux ; il prend ainsi plus d’importance ; le sacrement du Mariage représenté ici est aussi la préfiguration de l’union de Jésus-Christ avec la sainte Église.
Nous n’avons sur ce retable que des thèmes tirés de la Genèse ; donc bien sûr aucune représentation directe de la Vierge. Il est bien évident que ce thème rédempteur, issu de l’Ancien Testament, était très probablement renforcé par la présence, au centre du retable et sous forme de statue ou de peinture, de la Vierge appelée dans la Bible “la nouvelle Ève”. L’ensemble complète le thème du Salut représenté sur la voûte, sans oublier le symbole de l’Eucharistie à l’entrée de la chapelle. C’est là un programme iconographique de grand intérêt et plutôt rare pour l’époque dans une modeste église de campagne.
Le style, assez rustique pour les personnages, est plus minutieux et fin pour la représentation des végétaux ; les détails exécutés très librement, ainsi que la richesse iconographique, font notre admiration. La visite pastorale de 1636 ne parle absolument pas du décor sculpté de la chapelle ; par contre, le 11 mai 1841 l’évêque de Rodez, Monseigneur Pierre Giraud, “trouve la voûte de la chapelle Notre-Dame du Rosaire un chef-d’œuvre, ainsi que le cadre du tableau qui est en pierre”. Ce type de retable-encadrement en pierre n’est pas unique en Rouergue. Nous en connaissons quelques exemples (Prades d’Aubrac, Combret…) mais ils sont souvent bien moins riches iconographiquement que le retable de Saint-Exupère. Il faut, sans aucun doute, rapprocher cette œuvre des deux retables de l’église Saint-Jean à Combret, dans le même diocèse de Vabres et à une vingtaine de kilomètres à peine, mais où les sculptures, en pierre également, ne représentent que des végétaux et des figures géométriques.
La chapelle Notre-Dame dans l’église Saint-Exupère est exceptionnelle. Par sa recherche symbolique et son style, cet ensemble sculpté très cohérent (œuvre d’un même artiste ou en tout cas d’un même atelier) est surprenant dans un édifice qui est par ailleurs plutôt modeste. Était-elle, à l’origine, chapelle funéraire ? Rien dans les archives ne le laisse supposer. Mais il est évident que le donneur d’ordre, qu’il soit simple particulier ou communauté religieuse, est très connaisseur du message religieux à faire passer : les thèmes sont réfléchis et ne se contentent pas de recopier des modèles usuels. Il faut à cette époque, et dans cette région fortement marquée
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 297
par le protestantisme, affirmer la suprématie de l’Église catholique. Le programme sculpté de la chapelle apparaît ainsi comme un manifeste religieux, et n’oublie pas de rappeler l’appartenance à la Couronne.
Les thèmes iconographiques (notamment la valorisation des sacrements de l’Eucharistie et du Mariage ainsi que la méditation sur la mort) et les détails de style (comme la forme des blasons) permettent de dater la chapelle et son retable du XVIe siècle.
Addendum
« Dans le n° 88 du Bulletin de Sauvegarde du Rouergue, paru en 2005, consacré à Saint-Exupère de Coupiac, le texte de F. Félix-Kerbrat, p. 1-27, n'a non seulement pas été relu par l'auteur mais a été retouché à son insu ; de ce fait il comporte des erreurs dont il n'est pas responsable.
Une information donnée par P. Cabau vient d'être confirmée par de toutes récentes découvertes faites par B. Suau dans des fonds notariés. Elles ont révélé que, entre 1350 et 1500, l'église de Saint-Exupère était dédiée à la Vierge et s'appelait Beata Maria de Sancta Superia (écrit aussi Exsuperia). Sancta Superia (sainte Supérie) est une martyre quercynoise, du VIe siècle, vénérée dans la région de Cahors. On peut supposer que le changement de titulaire, voulu sans doute par l'autorité épiscopale, s'est fait lors de la reconstruction de l'église au XVIe siècle. La Vierge, à qui on consacre une belle chapelle, aurait été alors évincée par saint Exupère, tandis que sainte Supérie était tombée dans l'oubli. »France FÉLIX-KERBRAT »
La Présidente félicite Mme
Félix-Kerbrat pour la révélation de ce monument inédit. Michèle
Pradalier-Schlumberger juge un peu sévère la qualification de « tailleurs de
pierre » appliquée aux auteurs des sculptures, dont les œuvres appartiennent
à l’art populaire de la fin du Moyen Âge. Elle demande si l’édifice est
protégé au titre des Monuments historiques. France Félix-Kerbrat répond par la
négative et ajoute que, si cette église est abandonnée depuis les années 1960, la
population de la commune de Coupiac y demeure très attachée : c’est sans doute
que, au XIXe siècle, les paroissiens ont « travaillé beaucoup et
beaucoup payé » pour leur église érigée en succursale.
Guy Ahlsell de Toulza
propose une interprétation différente de l’iconographie du montant droit de la
niche pratiquée au-dessus de l’autel de la chapelle : pour le registre
supérieur, il pourrait s’agir d’Adam et Ève aux Limbes, et pour la scène du
bas, du Christ sortant Adam et Ève des Limbes. On revoit les diapositives, mais la
discussion qui s’engage avec France Félix-Kerbrat et Bernadette Suau n’aboutit
à aucune conclusion assurée.
Louis Peyrusse
s’intéresse à la chaire, vraiment « extraordinaire » : fabriquée
par l’atelier de Laclau, elle a été mise en place en 1893.
SÉANCE DU 29 MARS 2005
Présents : Mme
Pradalier-Schlumberger, Présidente, MM. Cazes, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier,
Cabau, Secrétaire-adjoint, Mme Suau, Bibliothécaire-Archiviste, M. Latour,
Bibliothécaire-adjoint ; Mmes Napoléone, Pousthomis-Dalle, MM. Bordes, Peyrusse, Prin,
Testard, membres titulaires ; M. Hermet, membre libre ; Mmes Czerniak, Guiraud,
Jefferson, Marin, MM. Balagna, Barber, Darles, Stouffs, membres correspondants.
Excusés : M. Scellès, Secrétaire général, Mme Cazes, M. Garland.
La Présidente ouvre la séance à 17 h et commence par excuser l’absence d’Emmanuel Garland, qui devait présenter ce soir Un monument roman de la vallée d’Aure (Hautes-Pyrénées) ; notre confrère a dû se rendre à Londres pour des raisons professionnelles.
Le Secrétaire-adjoint donne lecture du procès-verbal de la séance du 1er mars, rédigé par le Secrétaire général, puis de celui de la séance du 15 mars ; ces comptes rendus sont adoptés, le second après amendements.
La Présidente fait état de la correspondance manuscrite, qui comprend notamment l’annonce de la présentation que M. Michel Hue doit faire le jeudi 7 avril, dans le cadre de la Semaine gersoise organisée à la Maison de Midi-Pyrénées (Toulouse, 1 rue de Rémusat, 4-9 avril), des trois sites d’Eauze, Lectoure et Séviac, sous le titre « Villes et campagnes dans le Gers gallo-romain ».
Guy Ahlsell de Toulza
rend compte des démarches qu’il a entreprises auprès de la Ville de Toulouse en vue
de la dépose de la statue de « Dame Tholose » sommant la colonne de la
place Dupuy, de son remplacement par une copie et de la présentation de l’œuvre
originale en un lieu plus propice à sa conservation. M. Jean-Luc Moudenc, maire de
Toulouse, se montre, dans le courrier qu’il a adressé à notre confrère, tout à
fait favorable à l’opération : « le plus important reste la
préservation de la statue » ; l’intervention, qui devra être entourée
de toutes les précautions nécessaires, s’annonce longue et coûteuse. Les Services
municipaux précisent que « les coûts de restauration seront supportés par le
musée des Augustins ». M. Ahlsell de Toulza note avec satisfaction que
« l’engagement du maire est certain », mais la question de
l’emplacement futur de la statue demeure pendante.
Le Directeur constate
que la conservation des sculptures métalliques est un problème universel et que les
conditions de présentation devraient être conformes à celles qui sont appliquées dans
tous les musées du monde. Daniel Cazes prend l’exemple de la statue équestre de
Marc Aurèle, remplacée sur la place du Capitole de Rome par une copie et dont
l’original a été mis dans une vitrine étanche à hygrométrie constante. Louis Peyrusse remarque
cependant que l’« Homme armé » d’Arles a été récemment replacé,
après restauration, sur son toit d’origine. Concernant « Dame Tholose »,
M. Peyrusse souligne les problèmes liés à la « dérestauration » de
l’intervention du XIXe siècle.
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 298
La Présidente reprend la parole pour présenter la principale communication du jour, intitulée Sculpture funéraire et éléments sculptés médiévaux provenant de la maison de Saint-Jean de Jérusalem (Toulouse), qui sera publiée dans le prochain volume (t. LXVI, 2006) de nos Mémoires.
Le Directeur remercie Mme Pradalier-Schlumberger, puis il apporte des informations complémentaires sur les sculptures gothiques. En 1977, lors de fouilles pratiquées à l’occasion de la restauration du musée des Augustins, furent retrouvées dans des fosses de la galerie orientale du grand cloître les multiples fragments de deux statues polychromes de la fin du Moyen Âge, caractérisées par la qualité du traitement des draperies que portent les personnages représentés : une sainte Barbe, proche par le drapé de la statue présentée pendant la communication, et une autre statue, aujourd’hui dans la réserve du musée, qui semble faire la paire avec celle retrouvée à Saint-Jean. Daniel Cazes rappelle ensuite qu’il a identifié voilà plus de vingt-cinq ans une autre sculpture provenant de l’ancienne église Saint-Jean et que mentionnait Alexandre Du Mège : il s’agit d’un grand relief en pierre polychromé, de la fin du XIVe siècle, figurant une Pietà accompagnée de deux donateurs, qui se trouve aujourd’hui dans la salle capitulaire du musée ; on peut attribuer au même sculpteur un relief plus petit, venant de Saint-Sernin.
Pour la sculpture romane, M. Cazes déplore la perte du chapiteau du portail de l’église Saint-Jean signalé par Du Mège comme représentant Adam et Ève. Après Paul Mesplé, il l’a cherché en vain. Le Directeur évoque l’évolution de la situation du musée des Augustins dans la seconde moitié du XIXe siècle, la marginalisation d’Alexandre Du Mège, la rupture avec sa conception « archéologique » de la présentation des sculptures et l’orientation vers une muséographie sélective tendant à abstraire les œuvres de tout contexte architectural : les éléments lapidaires qui n’étaient plus exposés furent entassés dans le sous-sol du « Temple des Arts », où ils finirent par se mélanger, ou disparaître. Concernant le chrisme qui surmontait le portail de Saint-Jean, M. Cazes ne croit pas qu’il y ait de hiatus chronologique entre le relief et l’inscription.
Patrice Cabau abonde en ce sens. Le chrisme a été taillé en réserve pour mieux représenter une pièce d’orfèvrerie ajourée, et s’il se détache très nettement au centre du champ, c’est parce qu’il est l’élément le plus important de la composition. L’inscription, complète, mais qui occupe seulement la partie supérieure du champ, a été gravée beaucoup moins profondément, selon les modalités propres à l’épigraphie médiévale. On observera que les cercles concentriques gravés qui forment la couronne du chrisme paraissent assurer la transition entre les composantes (« image » et « texte ») et les techniques. Le déséquilibre entre zone supérieure inscrite et surface inférieure vide ne doit pas occulter le souci de symétrie que traduit la disposition des deux vers du distique de part et d’autre de l’axe vertical matérialisé par le double trait qui partage la première ligne en deux moitiés. Cependant, le premier vers occupe trois lignes, et le second quatre. Par ailleurs, l’alignement et le module des lettres ont été définis par le tracé d’une réglure préalable, mais plusieurs lettres entrelacées ou enclavées n’obéissent pas au modèle adopté en général. L’esprit de régularité et symétrie ne relève donc pas ici d’une logique absolument systématique. La différence de traitement du chrisme et de l’inscription peut nous donner l’impression de réalisations distinctes séparées par un long intervalle de temps : Jean Contrasty (Revue historique de Toulouse, 1947) est allé jusqu’à imaginer un écart de plusieurs siècles (VIe / XIIe). Or on ne connaît pas d’exemple de « chrisme roman » (XPS) antérieur au XIe siècle ; comparable à celui de Saint-Sauveur de Toulouse ou à celui de Sainte-Marie de Montsaunès, celui de Saint-Jean doit être postérieur au milieu du XIIe siècle. Quant à l’inscription, elle paraît datable, par le jeu sur la disposition des lettres davantage que d’après leur forme, de la seconde moitié du même siècle. En somme, le monument en question aura été réalisé en un seul temps, au moment de la construction de la nouvelle église Saint-Remi, mentionnée en juin 1190 et placée ensuite sous l’invocation de saint Jean ; telle qu’elle a été conçue, cette œuvre médiévale apparaît comme l’expression d’une pensée cohérente différente de la nôtre – comment expliquer selon le sens moderne de la logique ou de l’esthétique la disposition des légendes du relief des Signes du Bélier et du Lion sculpté pour Saint-Sernin ?
Guy Ahlsell de Toulza, au vu du plan de l’Hôtel Saint-Jean portant « Localisation des opérations archéologiques de 1997 à 2004 », fait remarquer la « modestie » des sondages pratiqués dans la cour, sur l’emplacement du cloître, et demande si des explorations supplémentaires sont prévues. Nelly Pousthomis-Dalle répond par la négative : étant donné, d’une part, le décalage de calendrier entre la programmation budgétaire (2000) et la réalisation des travaux (2003-2004), et, d’autre part, les contingences du chantier de fouilles de la rue Saint-Remézy (près de 2 000 sépultures reconnues), « il n’y a pas eu moyen de faire plus ». Louis Peyrusse en conclut qu’« il reste du travail pour les archéologues de l’avenir ».
SÉANCE DU 12 AVRIL 2005
Présents : Mme Pradalier-Schlumberger, Présidente, MM. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Scellès, Secrétaire général,
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 299
Mme Suau,
Bibliothécaire-Archiviste, MM. Cabau, Secrétaire-adjoint, Latour,
Bibliothécaire-adjoint ; M. Boudartchouk, le Père Montagnes, M. Gilles, membres
titulaires ; Mmes Bayle, Cazals, Guiraud, Jefferson, Stutz, MM. Barber, Geneviève,
Molet, membres correspondants.
Excusés : M. Cazes, Directeur, Mmes Labrousse, Galés, Napoléone, M. Garland.
Invités : Mme Lise Enjalbert, Mlles Laurence Alberghi, Martine Rieg, M. Georges
Cugulières.
Après avoir annoncé le report de la lecture des procès-verbaux en raison d’un ordre du jour très chargé, la Présidente remercie Mme le professeur Lise Enjalbert d’avoir bien voulu répondre à notre invitation en nous présentant ce soir les bâtiments de l’hôpital de La Grave. Michèle Pradalier-Schlumberger évoque la carrière de Mme Lise Enjalbert, auteur de deux ouvrages sur les hôpitaux de Toulouse et par ailleurs Vice-présidente de l’Union des Académies et Sociétés savantes de l’Hôtel d’Assézat et de Clémence- Isaure. La Société Archéologique ne peut qu’être attentive aux aspects patrimoniaux de l’avenir du site de La Grave, dont l’abandon par les hôpitaux de Toulouse est annoncé, et il a paru souhaitable de fonder notre avis sur des informations aussi précises que possible.
Mme Enjalbert se déclare très heureuse de cette occasion qui lui est donnée de nous « montrer » l’hôpital Saint-Joseph de La Grave, que la plupart des Toulousains ne connaissent pas :
« Un dessin pour un parcours de six siècles d’histoire.
TOULOUSE,
SITE DE L'HÔPITAL SAINT-JOSEPH DE LA GRAVE.
Dessin L. Enjalbert.
En rouge sur l'original, la masse des grands bâtiments “carrés” construits entre les XVIe et XIXe siècles, et trois repères pour ceux qui ne connaissent que le dôme, vu de la rive droite de la Garonne :
- les remparts de
Saint-Cyprien, depuis la tour Taillefer (elle aussi bien visible de la rive droite),
jusqu’à la rue Réclusane ; ils sont maintenant bordés par le jardin
Raymond-VI lequel entoure le Musée des Abattoirs d’Urbain Vitry ;
- la Garonne barrée par
la chaussée du Bazacle accrochée à la Grave depuis 1717, et le dessin bleu d’un
aqueduc du XVIIIe siècle, que nous reverrons ;
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 300
- en remontant le fleuve, la longue façade de l’Hôpital depuis la tour Taillefer jusqu’au pont Saint-Pierre. (Il a été emporté cinq fois par la Garonne, et reconstruit au-dessus de l’entrée de l’Hôpital entre 1852 et 1896.)
Entre ces repères, deux domaines différents.
Sur la Garonne, les bâtiments les plus anciens, enfouis sous ceux du XIXe siècle. Dès le XIIIe siècle, la ville, pour éloigner les pestiférés alors nombreux lors des épidémies, pour héberger les pèlerins, les loge dans des bâtiments construits sur la berge du fleuve. (Cette berge était alors loin du fleuve parce que la chaussée s’accrochait près de l’Hôtel-Dieu.) On ne connaît rien de ce bâtiment, sauf les nombreuses questions que posent des gravures beaucoup plus tardives. Ce bâtiment “des pestiférés” ne devait pas être très grand, puisque très souvent il fallait garder les malades dans les tours du rempart voisin et, en 1557, ce sont dix tours qui avaient dû être utilisées.
Les Capitouls décident alors de construire un hôpital pour eux : ce sera l’hôpital Saint-Sébastien, au XVIe siècle. De cet édifice subsiste peut-être l’une de ses grandes salles, que l’on a enfermée dans l’un des côtés de la cour Saint-Joseph : grande salle voûtée d’ogives, découpée en vestiaires, toilettes, ou locaux techniques, que la Garonne a remplie de terre et de cailloux sur la moitié de sa hauteur depuis que la chaussée s’accroche à La Grave.
Après le XVIe siècle, la peste diminue et l’hôpital non utilisé devient misérable. L’influence de Vincent de Paul fait que l’on accepte dans l’hôpital tous ceux que la ville rejette : mendiants, voleurs, malheureux, vieillards, enfants abandonnés, épileptiques et fous... Pas de malades, rien que des réprouvés, pour lesquels cet asile plus ou moins obligé devient Hôpital général.
Pour cette population “renfermée” commence au XVIIe siècle la construction des grandes cours “monacales”. Construction lente, pendant plus de deux siècles, puisqu’elle ne s’achève qu’au XIXe siècle par la cour Saint-Joseph et l’enfermement de la grande salle voûtée. Cette période est aussi celle de l’érection de la chapelle et son dôme : chapelle décidée en 1719, première pierre en 1758, travaux jusqu’en 1835 (Delors et Masbou), première messe en 1845… La chapelle est sans cesse consolidée, la voûte refaite (1934, 1940, 1970). La Révolution a transformé La Grave en “Hôpital de Bienfaisance” et lui a donné les terrains du Couvent des Dames de la Porte.
C’est alors que commence, à La Grave, l’histoire toulousaine de la psychiatrie. On passe des cachots pour fous enchaînés à l’asile pour aliénés, avec Pinel et Dieulafoy qui soignent, et aux “quartiers” des services psychiatriques du professeur Riser. La construction de l’Hôpital de Braqueville, lequel deviendra l’Hôpital Marchant, fait disparaître les aliénés de La Grave.
C’est aussi au XVIIIe siècle que l’on creuse l’aqueduc qui court-circuite la chaussée du Bazacle et fait tourner un moulin à farine au bas des remparts. Le long de ces remparts, à l’extérieur de l’Hôpital, la fontaine des “trois cannelles” alimente, sur la berge en pente douce, des lavoirs, une minoterie et plus tard la fonderie du citoyen Bosc avec son martinet pour écraser le cuivre. Tout cela a été recouvert par le jardin Raimond-VI. Seule subsiste, à la sortie de l’aqueduc, une usine électrique, qui a remplacé le moulin à farine.
Au XIXe siècle, l’Hôpital fait partie des services de soins de Toulouse : maternité avec l’École de sages-femmes, services de spécialités diverses. Le XXe siècle a vu la construction du pavillon Lasserre, trop moderne, mais déjà dépassé et abandonné. En 1925, c’est l’installation de la lutte anti-cancéreuse avec le CRAC, lequel sera agrandi et deviendra l’Institut Claudius-Regaud en 1970.
La maternité a été transférée en 2003 près de l’Hôpital des Enfants à “Paule-de-Viguier”. Restent à La Grave les âges qui y terminent leur vie et quelques consultations : de psychiatrie, d’aide aux sidéens, une “maison médicale”, aide aux sans-abris… L’Institut Claudius-Regaud est désormais la seule zone d’hospitalisation active de tout le site.
Lise Enjalbert »
La Présidente remercie Mme Enjalbert
pour cette présentation très éclairante de l’histoire architecturale de
l’hôpital de La Grave, qu’elle prolongerait volontiers par une visite des
lieux. Mme Enjalbert en accepte le principe en confirmant qu’il est tout à fait
possible de faire librement le tour extérieur des bâtiments, la cour de la maternité et
la cour Sainte-Anne n’étant cependant accessibles qu’à l’occasion
d’une consultation ; il n’est nécessaire d’être accompagné que pour
la visite de la salle voûtée du bâtiment qui longe la Garonne.
Répondant à Guy
Ahlsell de Toulza, Mme Enjalbert indique que les bâtiments de La Grave sont la
propriété des Hôpitaux de Toulouse. Puis, comme Maurice Scellès lui demande quels sont
le rôle et les moyens de la Ville de
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 301
Toulouse, elle précise que le Maire est Président
des Hôpitaux de Toulouse, mais que la seule action que pourrait envisager la Ville serait
l’achat des bâtiments. Mme Enjalbert ajoute que les Hôpitaux de Toulouse sont
propriétaires de nombreux biens fonciers que la difficile situation financière actuelle
oblige à vendre.
Maurice Scellès
voudrait savoir si des dispositions intérieures anciennes sont conservées. Mme Enjalbert
le croit et elle cite la salle voûtée qui longe la Garonne ou encore la magnifique salle
de la pharmacie ; bien sûr les bâtiments ont été sans cesse adaptés aux besoins
de l’hôpital, mais nombre d’informations sur des dispositions disparues
pourraient être apportées par des vestiges aujourd’hui peu compréhensibles.
Maurice Scellès évoque alors le projet d’installation d’un hôtel de luxe qui
a été présenté par la presse, et la pétition lancée par des usagers et des
personnels hospitaliers pour le maintien d’une activité hospitalière sur le site.
Puis il imagine les différentes réaffectations possibles : poursuite d’une
activité médicale ou paramédicale qui aurait l’intérêt de s’inscrire dans
la continuité historique de l’établissement, structure hôtelière qui pourrait par
exemple s’inspirer des paradors espagnols en laissant un accès public aux parties
les plus significatives, installation d’une institution publique… Des solutions
mixtes seraient évidemment possibles. Il importe surtout que l’ensemble fasse
l’objet d’une étude monumentale préalable à tout projet de réaffectation,
que les nécessaires travaux soient menés dans le respect des bâtiments, qu’il
s’agisse de leurs élévations extérieures ou de leurs dispositions intérieures, et
qu’une part importante du site reste accessible au public. Quant à l’histoire
hospitalière du site, Mme Enjalbert pense qu’en effet les bâtiments se suffisent à
eux-mêmes, mais elle redoute une réaffectation qui aurait pour conséquence de les
dénaturer voire de les démolir.
En réponse à une
question de Guy Ahlsell de Toulza, Mme Enjalbert indique que le ministère de la Santé a
diligenté une enquête sur le devenir du site, enquête dont le rapport devrait être
rendu en juin prochain ; l’agent enquêteur n’a toutefois pas pris contact
avec l’Association des Amis de l’Hôtel-Dieu, sans doute parce que celle-ci a
des préoccupations essentiellement historiques. Bernadette Suau pense que
l’Association devrait prendre l’initiative d’un contact avec
l’enquêteur, ce dont convient Mme Enjalbert.
L’ordre du jour appelant trois communications consacrées aux fouilles gallo-romaines du site du Purgatoire à Auterive (Haute-Garonne), la Présidente donne la parole à Louis Latour, qui présente tout d’abord à la Compagnie l’étude des couches récentes, publiée dans ce volume (t. LXV, 2005) de nos Mémoires.
La Présidente remercie Louis Latour. Hélène Guiraud s’étonne de l’attribution à un atelier lyonnais des céramiques dont des lots ont été également retrouvés en Italie et en Bretagne. Louis Latour et Henri Molet précisent que des tampons d’Aetius et de ses ouvriers ont été découverts à Arezzo et sur le site de La Muette, ce qui a permis de prouver que le potier arétin avait ouvert une succursale à Lyon, dont les productions se situent dans les années 20-15 avant notre ère. Hélène Guiraud demande si des lots semblables et susceptibles de jalonner l’itinéraire ont été mis au jour à Nîmes et à Narbonne. Louis Latour dit que les séries les plus semblables actuellement connues se trouvent en Bretagne et en Loire-Atlantique. Vincent Geneviève fait remarquer que les voies de circulation ne sont pas nécessairement les mêmes pour les monnaies et les céramiques ; pour sa part il est également un peu étonné par une éventuelle origine lyonnaise de ces céramiques.
Mlle Laurence Alberghi fait ensuite un exposé sur les amphores d’Auterive. Après avoir rappelé que Mlle Laurence Alberghi réalisait cet inventaire dans le cadre d’une maîtrise d’histoire de l’art et archéologie à l’Université de Toulouse-Le Mirail, la Présidente la remercie de nous avoir fait partager une recherche dont l’achèvement est en cours. Hélène Guiraud évoque les itinéraires qui ont été reconstitués à partir des épaves fouillées en Méditerranée et elle suggère que Narbonne était sans doute le point de passage le plus simple pour Auterive. Mlle Laurence Alberghi confirme que nombre de formes d’amphores identifiées à Auterive sont également connues à Narbonne et dans les estuaires des fleuves côtiers. Maurice Scellès s’interroge sur la réalité de l’enjeu que représente la différenciation entre Toulouse et Auterive par rapport à une circulation commerciale qui concerne une aire aussi vaste. Louis Latour précise les questions que pose la diffusion des amphores à travers l’isthme gaulois, prenant en particulier l’exemple des amphores de type Pascual I bien connues en Tarraconaise et en Languedoc, mais aussi au Pays basque. Auterive a pu être un point de passage et de diffusion vers l’ouest et le sud : on sait que les pèlerins italiens passaient par Auterive et évitaient ainsi un grand détour par Toulouse, la construction du grand pont du Moyen Âge témoignant d’une circulation importante dont il faut se demander si elle peut remonter à l’Antiquité.
Vincent Geneviève présente alors à la Compagnie les résultats de l’étude des monnaies antiques d’Auterive, également publiée dans ce volume (t. LXV, 2005) de nos Mémoires.
Comme la Présidente souligne tout l’intérêt des découvertes effectuées sur les différents sites d’Auterive, Vincent Geneviève confirme à son tour le caractère exceptionnel de la collection de monnaies constituée lors de ces fouilles,
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 302
par la quantité, proche du double de toutes
les monnaies trouvées à Toulouse, et par le nombre peu habituel de questions
qu’elle soulève. Jean-Luc Boudartchouk note que ce sont également de verres de luxe
qui ont été mis au jour et il ajoute que l’on a en effet soupçonné
l’existence d’une petite agglomération sur le site d’Auterive. Louis
Latour rappelle que Georges Fouet pensait qu’il y avait eu un déplacement de
l’occupation antique sur des sites successifs ; puis il fait remarquer que
l’Ariège est guéable à Auterive, ce qui en ferait un site favorable au stockage
des produits d’importation et à leur redistribution vers les Pyrénées. Interpellé
sur les périodes d’utilisation des voies de communication dans cette région, Henri
Molet dit que les transports par voie d’eau sont moins onéreux, mais il ajoute que
si l’Ariège est navigable six à huit mois dans l’année, la remontée en est
difficile.
Répondant à une
question de Patrice Cabau, Louis Latour indique que les puits d’Auterive sont des
puits à offrandes, et non des puits à eau qui n’auraient aucune utilité à une
dizaine de mètres de la rivière. Jean-Luc Boudartchouk fait remarquer que pour Toulouse,
l’hypothèse des puits à eau proposée contre celle des puits à offrandes apparaît
au XXe siècle, peut-être à un moment où l’on ne sait plus ce
qu’est véritablement un puits à eau, ce qui n’était pas encore le cas au XIXe
siècle.
Géraldine Cazals
s’informe des perspectives offertes par les fouilles archéologiques et de leur
éventuel prolongement. Louis Latour explique qu’il n’y a à l’heure
actuelle aucune suite envisagée. Le projet de lotissement près de l’église
Saint-Paul a été abandonné après l’évaluation effectuée par l’I.N.R.A.P.
et l’annonce du coût des fouilles que le promoteur aurait à supporter ; le
problème sera sans doute le même sur le site de Saint-Martin de Luffiac.
La Présidente fait circuler parmi l’assemblée le dépliant de présentation d’un futur Centre international de la broderie d’art. Une association a été créée à Mirepoix pour soutenir le projet de centre qui serait installé dans l’ancien palais épiscopal et pourrait accueillir la collection Fruman, riche de plus de deux cents broderies du XVe au XXe siècle, de qualité exceptionnelle.
SÉANCE DU 3 MAI 2005
Présents : Mme Pradalier-Schlumberger, Présidente,
MM. Coppolani, Directeur honoraire, Cazes, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier,
Scellès, Secrétaire général, Cabau, Secrétaire-adjoint, Latour,
Bibliothécaire-adjoint ; Mmes Cazes, Napoléone, MM. Bordes, Boudartchouk, le Père
Montagnes, Mgr Rocacher, M. Testard, membres titulaires ; Mmes Bayle, Cazals,
Jefferson, MM. Barber, Darles, Garland, Geneviève, Laurière, Molet, membres
correspondants.
Excusés : Mme Suau, Bibliothécaire-Archiviste, Mmes Andrieu, Fournié, Marin, M.
Pradalier.
Invités : MM. Francis Dieulafait, Olivier Gaiffe, Olivier Mazard.
La Présidente informe la Compagnie de la réouverture de l’escalier d’honneur de l’Hôtel d’Assézat, qui est l’accès normal à notre salle des séances, conformément aux accords qui régissent les relations entre les Académies et Sociétés savantes de l’Hôtel d’Assézat et la Fondation Bemberg, et conformément aux prescriptions de la Commission de sécurité.
Le Secrétaire-adjoint donne lecture du procès-verbal de la séance du 29 mars dernier, qui est adopté après deux remarques de la Présidente. Michèle Pradalier-Schlumberger tient en effet à exprimer sa gratitude à Daniel Cazes qui a eu l’amabilité de lui communiquer son dossier sur la Pietà de l’Hôtel Saint-Jean, alors que le dossier qu’il avait constitué au musée des Augustins est aujourd’hui absolument vide ; la conservation actuelle du musée a également été très heureuse de pouvoir ainsi reconstituer la documentation de l’œuvre. Quant à l’analyse du chrisme, Michèle Pradalier-Schlumberger maintient sa position et considère qu’il n’y a pas de concordance entre le décor sculpté et l’inscription.
La Présidente rend compte de la correspondance qui comprend en particulier le programme du colloque annuel de la Fédération historique de Midi-Pyrénées, qui se tiendra à Tarbes les 17-19 juin 2005, sur le thème : Cultures et solidarité dans les Pyrénées centrales et occidentales.
Notre bibliothèque s’enrichit de deux ouvrages :
- Pierre-Yves Melmoux, Languedoc numismatique. Spécial monnaies de
Vieille-Toulouse, Bulletin de l’Amicale
numismatique du Midi, n° 52, janvier 2005 (hommage de l’auteur) ;
- Géraldine Mallet, Cloîtres démontés de Perpignan et du Roussillon (XIIe-XIVe
s.), Éditions des Archives communales de Perpignan, 2000, 392 p. (collection
Perpignan Archives Histoire) (don de Michèle Pradalier-Schlumberger).
La parole est à Jean-Luc Boudartchouk et Henri Molet pour une communication sur Le Capitolium de Toulouse,
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 303
l’église Saint-Pierre et Saint-Géraud et le martyre de l’évêque Saturnin : nouvelles données, publiée dans ce volume (t. LXV, 2005) de nos Mémoires. Jean-Luc Boudartchouk demande à la Compagnie d’excuser Mme Catherine Viers, qui est associée à cette recherche mais n’a pu se libérer ce soir comme cela était prévu.
La Présidente félicite Jean-Luc Boudartchouk et Henri Molet en soulignant tout ce que cette nouvelle communication apporte à leurs travaux antérieurs, qu’il s’agisse de l’église Saint-Géraud qu’ils ont très largement fait réapparaître ou de l’histoire de saint Saturnin. Comme elle avoue avoir beaucoup de mal à imaginer quelle signification donner à ce crâne retrouvé au pied du degré du temple, Jean-Luc Boudartchouk réaffirme sa conviction d’une mise en scène en relation avec le récit du martyre de saint Saturnin. La Présidente remarque par ailleurs que le vocable à saint Pierre est habituel pour les prieurés dépendant de Saint-Géraud d’Aurillac et elle cite le vocable saint Pierre du prieuré de Varen.
Patrice Cabau félicite à son tour nos deux confrères. Il souscrit complètement à l’hypothèse proposée pour la donation à Saint-Géraud d’Aurillac, et il les remercie de cette clarification. Il est aussi tout à fait d’accord pour considérer qu’il est invraisemblable que Saturnin ait été martyrisé en étant attaché au taureau destiné au sacrifice. Daniel Cazes est plus réservé ; il pense qu’il faut sortir du contexte strictement toulousain et resituer ce genre d’événement dans l’histoire romaine. La profanation d’un espace de culte païen ne l’étonne pas et il rappelle des débordements extrêmes que connaît Rome lors de certaines émeutes. Se méfiant de l’hypercritique, dans ce cas en particulier, il serait même tenté de prendre le contre-pied : tel qu’il est raconté par la Passio, le martyre de saint Saturnin correspond assez bien à ce que l’on sait de la civilisation romaine et il n’y a rien d’étonnant dans le fait que l’édit impérial n’ait pas été appliqué strictement. Jean-Luc Boudartchouk se défend de toute tendance à l’hypercritique, qui conduirait d’ailleurs à n’accorder aucun crédit au texte de la Passio, et il signale que les plus récentes publications consacrées aux persécutions sous Dèce ne le retiennent pas. Daniel Cazes rappelle que c’était déjà le point de vue de Paul-Albert Février. Jean-Luc Boudartchouk précise sa pensée en indiquant qu’il croit possible d’identifier les sources qui ont été utilisées au début du Ve siècle ; il est en particulier très probable que l’on dispose alors d’un document indiquant que Saturnin était évêque de Toulouse au moment de la persécution de Dèce. Quitterie Cazes dit qu’il faut également prendre en compte la tradition orale, puis elle fait observer qu’il ne faut pas vouloir chercher dans la Passio le texte d’un historien, alors que l’essentiel est sa charge émotionnelle. Jean-Luc Boudartchouk en convient volontiers et il ajoute qu’au moment où le texte est rédigé, la question qui importe ce n’est pas le temple du Capitole, mais bien sûr saint Saturnin.
Quitterie Cazes et la Présidente demandent des précisions sur les derniers sondages archéologiques. Jean-Luc Boudartchouk et Henri Molet indiquent que les fouilles sont terminées et qu’une surveillance est prévue sur les maisons voisines où le soubassement du temple et la base de l’église pourraient être mieux conservés. M. Mazard donne des précisions sur les deux maisons fouillées et leurs fondations. La discussion se poursuit sur l’église dont la Présidente s’étonne qu’elle ait entièrement disparu, en supposant qu’ait pu jouer le fait qu’elle ne soit pas église paroissiale. Henri Molet explique qu’elle a été une première fois détruite par un incendie et entièrement reconstruite et il ajoute qu’elle est mal-aimée des autres églises toulousaines ; il est sans doute significatif qu’elle soit toujours citée comme église Saint-Géraud, et non avec son double vocable Saint-Pierre-Saint-Géraud.
Au titre des questions diverses, la Présidente et Quitterie Cazes expliquent et commentent le courrier adressé récemment par courriel aux sociétés savantes par le Vice-Président du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques (C.T.H.S.) :
« Madame, Monsieur le Président,
Vous participez à
des travaux du C.T.H.S. et avez certainement été mis au courant des difficultés qui sont
les nôtres depuis quelques années. Après deux ans de réunions, les statuts proposés
au Comité n’ont pas évolué et nous nous heurtons à un refus du ministère
d’accéder à nos demandes légitimes pour la survie du C.T.H.S. :
- le personnel
n’est plus mentionné dans les nouveaux statuts, il n’existe plus de direction
administrative du secrétariat du comité,
- les moyens sont
flous,
- les droits et biens
du comité sont dévolus à l’École nationale des chartes. Qu’en est-il des
ressources propres ?
- les frais de mission
pour les membres bénévoles ne sont plus mentionnés.
Ces statuts
risquent pourtant d’être publiés au Journal Officiel en passant outre les
observations de la commission centrale du Comité et de son Bureau.
À l’heure où la
recherche publique est en danger, où la recherche associative est totalement délaissée,
on veut empêcher un service qui a par ailleurs la même subvention et le même personnel
qu’en 1990 de continuer à organiser
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 304
des congrès ouverts à tous, à publier des
ouvrages de recherche, à maintenir le lien entre les sociétés savantes et la recherche
institutionnelle.
C’est pourquoi
nous demandons à tous ceux qui veulent aider le C.T.H.S. d’intervenir auprès du
ministre de l’Éducation nationale (110 rue de Grenelle 75007 Paris) et auprès du
Président de la République (Palais de l’Élysée, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris) pour empêcher à très court terme le démembrement de ce service. En
écrivant au nom de votre société savante, indiquez le nombre de membres de votre
société, ses domaines d’activité et les liens qui vous unissent au C.T.H.S.
Je vous en remercie par avance
Jean-René Gaborit
Vice président du C.T.H.S.
P.S. Quelques mots d’explication pour accompagner le courriel de Jean-René Gaborit, vice-président du Comité des travaux historiques et scientifiques, qui constitue le point d’orgue à une crise qui depuis deux ans oppose le C.T.H.S. et son ministère de tutelle, le ministère de l’Éducation nationale, pour que chacun saisisse bien les enjeux du conflit.
Fondé en 1834, le C.T.H.S. a d’abord été chargé de publier les Documents inédits sur l’histoire de France, puis de recenser et d’étudier les monuments archéologiques, enfin de concourir au progrès des différents domaines de la science, sur le plan régional et local. Les rapports qui unissent le Comité à la recherche en France peuvent aujourd’hui être appréhendés dans trois directions : le Comité publie des recueils de sources ; il établit le lien entre la recherche universitaire, institutionnelle, et bénévole, par l’intermédiaire du congrès national des sociétés historiques et scientifiques (qui se tient depuis 1861 dans une ville universitaire) ; enfin il publie le résultat de ces recherches. Le C.T.H.S., placé sous l’autorité du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, est formé de neuf sections : Préhistoire et protohistoire ; Histoire et archéologie des civilisations antiques ; Histoire et philologie des civilisations médiévales ; Archéologie et histoire de l’art des civilisations médiévales et modernes ; Histoire du monde moderne, de la Révolution française et des révolutions ; Histoire contemporaine et du temps présent ; Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales ; Sciences, histoire des sciences et des techniques et archéologie industrielle ; Sciences géographiques et de l’Environnement. L’ensemble de ces collections constitue depuis l’origine la plus importante collection d’instruments de travail en sciences humaines édités en France. Il a été chargé depuis 180 ans d’entretenir les liens avec la recherche associative et il en dresse l’annuaire depuis 1860. Actuellement, l’annuaire des sociétés savantes sur le site cths.fr comporte plus de 2100 sociétés représentant 800 000 membres. »
La Présidente propose que le Bureau soit chargé de rédiger la motion de soutien au C.T.H.S. qui sera envoyée au Président de la République et au Ministre de l’Éducation nationale. La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents.
La Compagnie est informée du retrait de la bannière du C.I.R.S. qui se trouvait sur la page « sommaire » de notre site Internet. Après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles avait été accepté le référencement du site de notre Société par cet « organisme », on reconnaît s’être laissé abuser par ce pseudo-Centre International de la Recherche Scientifique qui n’est en fait que le paravent d’une organisation de prosélytisme religieux. Le site Internet, disponible en quatre langues (français, anglais, espagnol et arabe), se présente comme un site d’information sur l’ensemble des domaines scientifiques, sciences exactes et sciences humaines, avec des notes d’actualité, des bibliographies, des listes d’organismes de recherche… Le tout est suffisamment bien fabriqué pour faire illusion à première vue, et il faut un examen plus attentif pour se rendre compte que les brèves d’actualité ne citent jamais aucune source, ou que les bibliographies par discipline ne sont que des bibliographies prétexte, sans aucune valeur. Tout cet appareil pseudo-scientifique n’est là que pour laisser croire à une caution scientifique internationale alors que le site diffuse, exclusivement, un livre consacré au Coran. On constate en outre que ce pseudo-Centre international ne comporte aucune signature identifiable et ne donne aucune information sur ses membres.
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 305
SÉANCE DU 17 MAI 2005
Présents : Mme
Pradalier-Schlumberger, Présidente, MM. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Scellès,
Secrétaire général, Mme Suau, Bibliothécaire-Archiviste, M. Latour,
Bibliothécaire-adjoint ; Mme Napoléone, MM. Bordes, Costa, Gilles, le Père
Montagnes, MM. Prin, Testard, Tollon, membres titulaires ; Mmes Bayle, Czerniak,
membres correspondants.
Excusés : MM. Cabau, Secrétaire-adjoint, Peyrusse.
Invitée : Mlle Martine Rieg.
La Présidente confirme que la dernière séance de l’année aura lieu le 14 juin, puis elle engage ceux qui ne l’ont pas encore fait à s’inscrire pour la journée foraine du 4 juin prochain à Camon et Mirepoix.
Le Secrétaire général donne lecture des procès-verbaux des séances des 12 avril et 3 mai derniers, qui sont adoptés.
La Présidente annonce à la Compagnie le don par Mme Labrousse de vingt-cinq tomes des Fasti archaelogici, collection éditée à Florence par The International Association for Classical Archaeology. Chaque volume constitue un bulletin annuel de l’archéologie classique qui présente et analyse les découvertes de l’année de référence ; la collection offerte comprend vingt-quatre volumes brochés, correspondant aux tomes I, édité en 1948 et couvrant les découvertes de 1946, à XXV, édité en 1974 et couvrant les découvertes de 1970.
Notre bibliothèque s’est également enrichie du dernier ouvrage de Michel Roquebert, Simon de Montfort, bourreau et martyr, s.l., Perrin, 2005, 401 p. (don de l’auteur).
Au nom de notre Société, la Présidente remercie les donateurs.
La parole est à Georges Costa pour une communication sur Le monument d’Henri de Sponde à la cathédrale de Toulouse, publiée dans ce volume (t. LXV, 2005) de nos Mémoires.
La Présidente remercie Georges Costa pour cette communication qui nous apporte, encore une fois, une découverte. Comme elle fait remarquer que le tombeau est œuvre d’architecte plutôt que de sculpteur, Georges Costa souligne qu’en effet l’élément principal est l’inscription, qui est placée dans un cadre architecturé. Bruno Tollon note que Didier Sansonnet est qualifié de tailleur de pierre. Georges Costa le confirme en précisant qu’il est également qualifié d’architecte ou de sculpteur. Puis, Bruno Tollon l’interrogeant sur les modèles internationaux auxquels il a fait allusion, Georges Costa cite des exemples italiens qui sont toujours repris en France dans un esprit plus classique. Bruno Tollon ajoute qu’il est intéressant de disposer d’une date précise pour le motif de lambrequin que l’on trouve aussi chez Levesville et dans certains hôtels toulousains.
La Présidente voudrait avoir des précisions sur le rôle de Didier Sansonnet dans les travaux de Saint-Volusien de Foix. Georges Costa affirme qu’il a été très important et il précise qu’il y a travaillé en exécution d’un devis établi par Souffron et qu'il a reconstruit une partie du clocher de la sacristie.
En s’excusant de devoir quitter la séance pour repartir à Nérac, Georges Costa dit tout le plaisir qu’il a toujours à se retrouver parmi nous.
Au titre des questions diverses, le Secrétaire général indique qu’il a donné le bon à tirer pour le volume 2004 de nos Mémoires, qui devrait être livré au plus tard au début du mois de juillet. Puis il dresse rapidement l’état du projet de sommaire pour le tome de 2005, en soulignant qu’il sera difficile de concilier les demandes de publication et les contraintes financières. Le Bureau aura à se prononcer en choisissant de limiter les articles ou bien d’opter pour une publication en deux volumes en trouvant des financements supplémentaires. Une discussion s’ensuit sur de possibles mécénats.
Avant de lever la séance, la Présidente annonce à la Compagnie la toute récente désignation de Pascal Julien au poste de professeur d’Histoire de l’Art moderne, et de Virginie Czerniak à celui de maître de conférences d’Histoire de l’Art médiéval à l’Université de Toulouse-Le Mirail. Des applaudissements saluent ces deux nominations.
SÉANCE DU 31 MAI 2005
Présents : Mme Pradalier-Schlumberger, Présidente, MM. Cazes, Directeur, Cabau, Secrétaire-adjoint, Mme Suau, Bibliothécaire-Archiviste, M. Latour, Bibliothécaire-adjoint ; Mmes Cazes, Napoléone, Pousthomis-Dalle, Watin-Grandchamp, MM. Bordes, Boudartchouk, Prin, Mgr Rocacher, M. Testard, membres titulaires ; Mmes Andrieu-Hautreux, Bayle, Bellin, Cazals, Fournié, Galés, Jefferson, MM. Barber, Mollet, membres correspondants.
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 306
Excusés : MM. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Scellès, Secrétaire général.
La Présidente ouvre la séance à 17 heures et donne immédiatement la parole à François Bordes pour la principale communication du jour, intitulée Rites et pratiques cérémonielles à Toulouse au bas Moyen Âge et à la Renaissance, publiée dans ce volume (t. LXV, 2005) de nos Mémoires.
Michèle Pradalier-Schlumberger remercie notre confrère pour sa présentation très vivante des cérémonies publiques organisées à Toulouse entre la fin du XIVe siècle et celle du XVIe. Elle relève que, contrairement aux représentations connues pour d’autres villes, les miniatures des Annales figurent les personnages, dont les capitouls, hors de tout cadre urbain ou architectural : faut-il y voir la volonté de magnifier le corps municipal ? François Bordes incline à le croire ; il signale par ailleurs la présence répétée des armes de la Ville, « signe fort » que l’on retrouve sur les présents offerts par les capitouls, les châsses par exemple. Mme Pradalier-Schlumberger s’intéresse ensuite aux « cent vingt pauvres » mentionnés dans les relations des cérémonies comme destinataires d’une aide. M. Bordes dit qu’il s’agit d’une pratique courante à l’occasion des grandes cérémonies, couronnement ou funérailles, et Jeanne Bayle précise que de telles aumônes furent distribuées à Toulouse au XVIe siècle lors de plusieurs obsèques solennelles, celles des archevêques et du duc de Bourgogne. Michelle Fournié évoque à ce propos les « obsèques flamboyantes », puis elle cite la réception faite à Narbonne, en 1415, à l’empereur Sigismond, circonstance exceptionnelle pour laquelle les consuls de Narbonne durent prendre conseil auprès des édiles de Montpellier et de Béziers au sujet du dais. Mme Fournié demande ensuite si les clercs des églises Saint-Étienne et Saint-Sernin étaient présents dans les cortèges. M. Bordes répond que les chanoines ou les moines ne sont pas mentionnés lors des entrées royales, mais qu’une relation d’obsèques note leur participation à la procession ; quant à l’archevêque de Toulouse, il ne figurait pas dans le cortège des entrées royales : il accueillait le souverain à l’entrée de la cathédrale. Daniel Cazes rappelle qu’en Espagne, de nos jours encore, les grandes processions religieuses se déroulent en présence du Corps municipal, qui va et vient de l’Hôtel-de-Ville à la cathédrale et auquel sont liés les aspects profanes des cérémonies : géants, soldats romains… François Bordes précise que la documentation dont on dispose pour les diverses entrées royales et les cérémonies religieuses est relativement inégale : on possède pour la réception de François Ier un registre particulier de délibérations capitulaires réglant tous les détails ; pour les autres cérémonies, on a seulement des relations plus ou moins circonstanciées. Géraldine Cazals relève au sujet de la remise des clefs de la Ville au roi que ce dernier ne les restituait pas immédiatement à la municipalité, puis elle note que les grandes cérémonies fournissaient aux divers corps constitués de la ville des occasions d’exprimer leur antagonisme : telle la querelle opposant en 1547, au lendemain des obsèques de François Ier, les capitouls et les parlementaires quant à la dévolution du velours tendu dans la cathédrale. M. Bordes abonde en ce sens et ajoute que, la tenture disputée étant à la charge de la Ville, les prétentions des gens du Parlement n’étaient pas fondées juridiquement ; par ailleurs, la question de la préséance par rapport à l’autel de la cathédrale constituait fréquemment un sujet de litige entre le Parlement et le capitoulat. Concernant la remise au roi des clefs la Ville, M. Bordes précise qu’en 1533 ces clefs, descendues par « feinte et engin », furent confiées par François Ier au capitaine de sa garde écossaise, et qu’en 1565 Charles IX les donna également au chef de ses gardes. Jean-Luc Boudartchouk s’intéresse aux reproductions faites aux XVIIe et XVIIIe siècles des miniatures des Annales capitulaires depuis disparues et pose le problème de leur fiabilité pour l’étude architecturale de Toulouse à la fin du Moyen Âge : il est clair que la valeur documentaire du décor urbain qui y a été ajouté doit être critiquée.
La parole est ensuite à M. Boudartchouk pour une « Note complémentaire au sujet de l’origine et de la translation des reliques de saint Antonin de Frédelas-Pamiers (1) :
En 2003, nous avions présenté un long dossier documentaire consacré au martyr Antonin de Frédelas-Pamiers (Boudartchouk et al. 2004). Au terme de cette étude, nous avions conclu que ce personnage, loin d’être un martyr historique, avait été forgé à Pamiers dans les années 1100, à partir de reliques en provenance de Saint Antonin-Noble-Val et d’une longue vita composée à l’aide de documents divers : vita corrompue d’Antonin d’Apamée de Syrie, chartes de Saint Antonin-Noble-Val et autres vitae.
Deux questions demeuraient en suspens :
- Quelle était l’origine réelle des reliques que détenait le monastère de Saint-Antonin-Noble-Val, ultérieurement translatées en partie vers Pamiers (2) ? S’agissait-il, comme le pensaient certains Bollandistes, de reliques de l’Antonin de Syrie, célébré le même jour (2 septembre) et dont la vita, on l’a dit,
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 307
a été utilisée pour forger la légende de l’Antonin de Frédelas-Pamiers ? Ou bien ces reliques ne provenaient-elles pas, en réalité, du corps du martyr Antonin de Plaisance, personnage qui entretient des liens hagiographiques avec les deux précédents ? L’exploitation de nouveaux documents permet, pensons-nous, de conforter cette seconde hypothèse.
- Dans quelles circonstances et à quelle date avait eu lieu une translation des reliques d’Antonin, à Pamiers, entre l’abbaye du Mas et l’église du Mas-Vieux, transfert daté auparavant à tort de 887 ? Deux sources indépendantes de l’abbaye de Pamiers, qui n’avaient pas été mises à contribution jusqu’à présent, permettent de situer cette translation dans les années 1100-1120.La question de l’origine des reliques de Frédelas : Apamée ou Plaisance ?
Apamée de Syrie : la vita perdue du martyr Antonin
Il existait bien une vita grecque très ancienne, et sans doute conséquente, du martyr Antonin d’Apamée, mais elle a disparu (Delehaye 1935), sans que l’on connaisse le degré de fidélité des vitae latines qui s’en inspirent et dont certaines nous sont parvenues (Boudartchouk et al. 2003). C’est le martyrologe hiéronymien qui fournit le plus ancien témoignage du culte rendu à Antonin d’Apamée en occident : « In Syria provincia in regione Apamiae, Antonini pueri annorum XX vico Aprocavictu sub Constantio imperatore » (restitution de la notice du martyrologe hiéronymien par H. Delehaye, citée dans Delehaye 1935, p. 227). Puis vient le récit qui a servi de modèle au texte grossièrement interpolé B.H.L. 568 ; ce dernier pourrait être antérieur à l’époque carolingienne. Enfin les textes post-carolingiens et d’époque féodale sont pléthoriques ; ils défigurent peu à peu les sources antérieures (Boudartchouk et al. 2003).
Dessin original à la plume d’un sceau de l’évêque D. Grima (document de 1343), par Jules de Lahondès, joint à une lettre datée du 15 décembre 1904, conservée aux A. D. du Tarn-et-Garonne, cote 3J48. Le registre supérieur représente Antonin à genoux, se préparant à la décollation, devant le billot, face au juge. La partie inférieure figure, sous trois arcs brisés, Antonin au centre tenant la palme du martyre entouré de ses deux compagnons, le prêtre Jean (à gauche ?) et le jeune laïc Almaque (à droite ?).
Pour autant, la restitution du premier récit grec est très délicate, mais des fragments insérés dans d’autres documents orientaux paraissent avoir subsisté. H. Delehaye, dans la remarquable étude qu’il consacre aux saints d’Apamée en 1935, cite un texte qui a trait aux reliques d’Antonin ; celles-ci paraissent déjà éparpillées, suite à la mise en pièces de sa dépouille : « Sancti corpus reppererunt in duas partes divisum. Quod Christiani acceptum in urbem Apameam detulerunt atque in spelunca deposuerunt prope Caprovesan » (extrait du synaxaire arménien, Delehaye 1935, p. 227). Une recension du martyrologe d’Adon (mort en 875, il ne peut donc s’agir que du martyr d’Apamée de Syrie) montre que l’épisode du jet des débris humains dans le fleuve était déjà présent dans le récit grec : « Apud Apamiam, beati Antonii martyris, qui ab infidelibus ob confessione in frustra discertus, et iuxta eadem civitatem in fluvium partes corporis eius proiectae sunt » (Martyrologe d’Adon, 2 septembre, éd. Dubois et Renaud, 1984, p. 296).
Même l’histoire extraordinaire des fragments de corps préservés et rassemblés par le fleuve, qui est une composante importante des vitae d’Antonin de Frédelas-Pamiers peut avoir figuré dans la vie grecque originale d’Antonin d’Apamée. En témoigne la Passion des XLV
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 308
martyrs de Nicopolis en Arménie (B.H.G.2 1216 ; citée par Delehaye 1935, p. 232). À la fin de ce récit, très probablement tributaire de l’hagiographie apaméenne et où prend place un autre martyr Antonin, « le juge fait précipiter leurs os en eau profonde, espérant en être débarrassé à jamais. Mais le fleuve semble veiller à la conservation de ce dépôt sacré ». L’épisode y est décrit dans des termes très proches de la version latine (Delehaye 1935, p. 232). Ceci ne peut guère être expliqué que par une source commune : la vita grecque originale d’Antonin d’Apamée (3).
Pour autant, on ne connaît pas l’histoire de la vénération des reliques d’Antonin d’Apamée ; on ignore même tout de leur nature. Ainsi, dans les années 570, un groupe de pèlerins de Plaisance se rendit dans les lieux saints et l’un d’eux, peut-être nommé Antonin et accompagné d’un Jean (décédé en cours de route), dressa, au retour, la relation détaillée de ce voyage : l’Itinerarium B. Antonini martyris. À partir du IXe siècle au moins, on identifia le pèlerin Antonin de Plaisance au martyr Antonin, entouré de compagnons. Curieusement, alors qu’ils visitent Apamée de Syrie, le récit ne mentionne ni le corps ni le culte de l’Antonin du lieu, pourtant vénéré depuis le début du VIe siècle au moins. C’est d’autant plus surprenant qu’« Antonin de Plaisance », le pèlerin, s’était auparavant rendu sur la tombe d’un autre Antonin martyr (et un de ses compagnons nommé Épimaque), celui d’Alexandrie (Milani 1977, p. 226-228).
À vrai dire, les probabilités d’arrivée de reliques significatives d’Antonin d’Apamée en Gaule du sud à l’époque carolingienne, compte tenu des évènements géopolitiques des deux siècles précédents, paraissent infimes. Nous avions suggéré en 2003 une solution alternative : des reliques distraites du corps d’Antonin de Plaisance.Les reliques d’Antonin de Plaisance
Le martyr Antonin de Plaisance jouit déjà d’une grande renommée à la fin du IVe siècle : une relique est en attestée à Rouen dès 396, grâce au témoignage de Victrice de Rouen : « curat Placientae Antonius [sic] » (Boudartchouk et al. 2003, avec références). Le culte assidu rendu à sa dépouille traverse la fin de l’Antiquité et le haut Moyen Âge (Tononi 1880). Or, ce martyr pourtant célèbre ne semble pas avoir eu de vita antérieurement aux récits fantaisistes de la fin du Moyen Âge et de l’époque moderne. Le seul document ancien dont on dispose est le récit de la révélation, de l’invention et de la translation du corps, sous l’égide de l’évêque saint Savin de Plaisance, qui a pris part au concile d’Aquilée en 381. Ce récit est connu par deux copies du XIe siècle, découvertes et éditées par les Bollandistes (Analecta Bollandiana, t. 10, fasc. 1, 1891, p. 119-120) :
« Revelatio beatissimi episcopi et confessoris Savini et inventio sancti martyris Antonini
In diebus illis cum beatissimus urbis Placentinae Savinus episcopus ieiuniis et orationibus sedule Deo deserviret atque populo sibi commisso caelesti sermone pabulum provideret, subito intempestae noctis silentio per visum quasi vir splendidissimus apparuit ei, et locum, ubi beatissimi martyris Antonini corpus iam olim multis labentibus annis lateret, sicut a persecutoribus trucidatum fuerat, hominibus incognitum tumulo iaceret ostendit. Quin etiam et formam corporis, membra mirifica, annos, nomen et caput abscisum a corpore signavit. Urceum quoque eius sanguine plenum pro testimonio reservatum pandit beatissimo sacerdoti Savino ; et ut ipsum corpus eius ex eodem loco levare deberet et digno loco sepulturae traderet admonuit. Igitur hunc Antoninum martyrem Christi ferunt quodam tempore Placentinae urbis finibus egressum atque orientales pertransisse provincias, multaque in eisdem provinciis eum miracula fecisse [al. vidisse] scriptum repperimus ; denique socium fuisse beati Mauritii martyris et ex eiusdem legionis ordine, qui pro Christo sanguinem fundere meruerunt, attestantur (…). Sic denique sanctus episcopus cum hymnis et canticis spiritalibus turbisque populorum ad locum accessit. Deinde, facta oratione, quasi duarum horarum spatio certatim manibus terram effodiunt, retectumque sanctum corpus aspiciunt et sicut ab episcopo audierant oculis cernunt. Cumque eum manibus tractarent, ad testimonium sancti martyris, gutta sanguinis ex eodem corpore profluxit (…). Levantes itaque sanctum corpus, ad basilicam sancti Victoris episcopi et confessoris elatum detulerunt atque in eius sepulcrum digno condiderunt honore (…). Gesta sunt haec die idus Novembris, regnante D.N.J.C. ».
Plusieurs paramètres de ce récit sont, bien sûr, inquiétants : révélation miraculeuse d’un corps oublié, absence d’éléments précis d’identification… C’est un martyr anonyme que l’on met au jour et l’on est manifestement bien en peine de lui restituer une identité. Le texte pourrait sous-entendre qu’il s’agit d’un
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 309
soldat isolé de la Légion thébaine, mais ce n’est pas affirmé clairement et il peut, on le verra, désigner en réalité un autre groupe de martyrs militaires. En résumé, Antonin était un soldat venu des provinces d’Orient, compagnon d’un martyr Maurice et appartenant à la même « légion » que celui-ci. Arrivé près de Plaisance, il fut décapité. Oublié de tous, son corps fut redécouvert par l’évêque Savin qui, après avoir procédé à sa reconnaissance, le fit translater dans la basilique dédiée à saint Victor, premier évêque de Plaisance. Cette histoire est célébrée le 13 novembre.
Les martyrologes ne sont guère diserts à son sujet et la plupart des martyrologes historiques l’omettent ; le jour du martyre est invariablement le 30 septembre. On citera deux exemples : « In Placentina civitate, natalis sancti Antonini martyris. In Mediolano, translatio corporis sancti Victoris martyris (…°) » (Martyrologe hiéronymien, 30 septembre, éd. Pat. Lat.) ; « Civitate Placentina, sancti Antonini confessoris » (Martyrologe d’Usuard, 30 septembre, éd. Pat. Lat.). Il faut attendre le XIVe siècle pour trouver une véritable (bien que laconique) vita d’Antonin de Plaisance ; on y reconnaîtra sans peine la seule source : le récit de l’invention du corps, simplifié et clarifié. Antonin y est désormais assimilé à un martyr de la légion thébaine :« Antoninus martyr apud placentiam civitatem passus est. Qui unus fuit ex sacra legione thebeorum et socius beati mauricii martyris. Qui de placentinis finibus egressus per orientales provincias pertransivit : et multa miracula fecit. Demum ad urbè suà rediens ab infidelibus tentus et capite cesus glorioso martyrio coronatus est. Cuius corpus ignotum dominus beato Savino ipsius civitatis episcopo revelavit. Apparuit enim et vir splendidus : qui ostendit ei ubi iacebat sancti martyris corpus : qui etiam formam corporis et membra et annos militiae et nomen et caput abscisum signavit : urceum quoque plenum eius sanguine pro testimonio servatum innotuit (…) » (Pietro de Natali, liber octavus, Ch. CXXXIII).
Les reliques d’Antonin, associées à celles de Victor, sont régulièrement mentionnées dans la documentation médiévale et moderne ; mais une reconnaissance approfondie des ossements au XIXe siècle montre que l’essentiel (les 4/5e) du corps a alors disparu et aucune pièce majeure n’est présente, même si le médecin requis note des petits fragments d’os longs, de bassin, de côtes, de crâne et de face (Tononi 1880, p. 185 sq.). Il est donc très probable que des morceaux de choix du corps soient allés enrichir, au fil des temps, les collections de reliques d’autres établissements religieux. Notons que, après les rois lombards, les carolingiens, dont Charlemagne, Louis le Pieux, Lothaire, Louis II en 872, ont accordé de nombreux droits et privilèges à l’église de Plaisance (Tononi 1880). Dans ce contexte, le don de reliques à Saint-Antonin-Noble-Val par l’intermédiaire du pouvoir carolingien n’aurait rien d’étonnant (4).
Le corps d’Antonin de Plaisance était honoré en trois lieux (Tonini 1880) : la basilique Saint-Victor (actuelle église Saint-Antonin) où se trouvait son corps ; l’église S. Maria in Cortina, élevée sur le lieu de la découverte du corps et où se trouvait le tombeau vide du martyr ; la chapelle du village de Travi sur la Trébie, sur le lieu supposé de la décollation d’Antonin, où une relique mineure était conservée.
Tononi, en 1880, signale deux inscriptions dans l’église S. Maria in Cortina. La première rappelle la découverte du corps : « Hic inferius fertur inventum fuisse corpus Sancti Antonini martyris » (datée vers 1100 par Tononi 1880, p. 68-69 ). La seconde, gravée sur du marbre, est plus insolite : « Antoninus Apamius Trabani sub Maximiano passus a Sabino Epo Plac. hinc in Victoris aedem transfertur » (Tononi 1880, p. 71 ). Elle semble dire qu’Antonin était originaire, ou en provenance d’Apamée, et qu’il a été exécuté à Trèbes sous Maximien.Un Antonin d’Apamée à Plaisance ?
A-t-il existé deux traditions au sujet de l’identité d’Antonin de Plaisance, l’une en faisant un martyr de la Légion thébaine, l’autre un soldat d’Apamée ?
Or, il existe bien, dans la littérature hagiographique, un groupe de martyrs militaires d’Apamée, exécutés sous Maximien et commandés par un certain Maurice : la Passion de Maurice et de ses LXX compagnons soldats, célébrés le 21 février, morts dans un marécage près de deux fleuves, dont l’Oronte (B.H.G.2 1230 ; Delehaye 1935, p. 230 sq.).
L’Antonin de Plaisance a bien pu être pris, à l’origine, pour un rescapé isolé du groupe de ce Maurice d’Apamée (5) ; Théodoret mentionne d’ailleurs, côte à côte, « (…) et Antonini, et Mauricii, aliorumque martyrum » (extrait cité dans Delahaye 1935, p. 225). Cette tradition – cette confusion – expliquerait les mentions, dans des documents médiévaux assez tardifs, d’une origine « a Pannoniae oppido » (pour
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 310
Apameae) prêtée au martyr italien (cf. AA.SS, 4 juillet, p. 11). La vita rédigée ultérieurement par Campion n’est qu’une adaptation destinée à Plaisance de la vita « du pape Pascal », elle-même forgée pour Antonin de Frédelas-Pamiers vers 1100 (Boudartchouk et al. 2003). Indubitablement, l’hagiographie apaméenne a bien un lien ancien avec l’Antonin de Plaisance. Pensait-on vénérer un autre Antonin d’Apamée (6)? Certaines leçons du Martyrologe hiéronymien donnent en effet : « in Parisiis (= partibus) Apamiae Antoni et Antonini » ou « in partibus Apamiae, natalis sanctorum Anthoni et Antonini » (cf. AA.SS, 4 juillet, p. 7-8). Une présumée origine apaméenne d’Antonin de Plaisance a pu dicter le choix de la vita grecque d’Antonin de Pamiers pour accompagner les reliques gauloises. En effet, accommodée de quelques traits propres au martyr italien, cette légende fut un support efficace pour le succès du culte des reliques de l’Antonin qui étaient apparues en Gaule au début du IXe siècle. Ce croisement improbable fut une réussite : les restes du martyr de Plaisance et la vie du martyr d’Apamée donnèrent naissance à un nouveau martyr Antonin, inventé vers 1100 avec deux compagnons, Almaque de Toulouse et un prêtre Jean (7).
Le succès des reliques de Frédelas-Pamiers, autour de la mise en place du culte du nouveau martyr Antonin, engendra immanquablement leur translation.
La translation des reliques d’Antonin de Frédelas-Pamiers
Comme nous l’avons montré en 2003, les textes médiévaux tardifs qui rapportent une translation du corps d’Antonin d’une rive à l’autre de l’Ariège, depuis le Mas-Vieux (actuelle église de Cailloup) vers l’abbaye du Mas Saint-Antonin à l’époque carolingienne, sont sans fondement. Pourtant, ces textes sont sans doute les témoignages, déformés à dessein, d’une authentique translation qui eut lieu autour de 1100. Deux textes, indépendants de l’hagiographie locale, nous le prouvent.
La Vita de l’ermite Anastase
Selon sa vita écrite peu après sa mort, Anastase est un moine de Cluny qui mena une vie érémitique, alla en Espagne, puis revint à Cluny avant de repartir vers l’Aquitaine au début des années 1180. Il se lia avec Roger II de Foix, tout en menant toujours une existence marginale, gyrovague et érémitique, dans les Pyrénées ariégeoises. Bientôt enjoint par l’abbé de Cluny de quitter sa solitude, il arriva à Frédelas (qui n’avait donc pas encore pris le nom de Pamiers), lieu également appelé « là où se trouve le Vrai Corps de Saint Antonin ». Le peuple le prie de bien vouloir « redéposer le corps du saint martyr dans un nouveau lieu ». Alors qu’il se prépare à accéder à leur demande, il guérit miraculeusement plusieurs malades qui affluent alors. Sans que l’on sache si la translation fut finalement menée à bien, il poursuit sa route et meurt peu après, non loin de là, à Saint-Martin d’Oydes, un 15 octobre, peut être en 1086. « Egressus itaque eremo, pervenit usque ad locum qui dicitur, ad Verum Corpus Beati Antonini Martyris, qui alio nomine nuncupatur Fredelas, ubi cum rogaretur a populo, ut corpus Beati Martyris in novum locum reponeret, et ad petitionem eorum se praepararet, oblatus est ei infirmus, qui jam longo tempore vexabatur a febribus, ipse vero cum aqua benedicta quam sanctificaverat eum aspersisset, et signum crucis fronti ejus affixisset, ita sanus effectus est, ac si numquam infirmitatem sensisset. De eadem aqua benedicta quoscumque aspersit, a quacumque infirmitate detinebantur, sanitati restituit » (AA.SS. 16 octobre, t. VII, p. 1138, vita par Galtier, ca. 1110-1120, d’après Mabillon).
Ce passage peu connu, qui n’avait jamais été mis à profit dans le débat sur Antonin de Pamiers, apporte des éléments essentiels :
- ca. 1085-1086, le « corps » d’Antonin se trouve bien à l’abbaye du Mas ; on envisage de le « redéposer » dans un « nouveau lieu » ;
- c’est l’« authentique » corps qui se trouve au Mas ; l’importance de cette présence est telle que le rédacteur en fait une appellation à valeur toponymique. On peut s’interroger en revanche sur cette affirmation d’authenticité : l’historicité du martyr ne faisait-elle pas encore l’unanimité ?Une translation après la Croisade
Cette translation, avec l’aval de Roger II, au moment ou plutôt après la visite d’Anastase, eut bien lieu, comme en témoignent les deux chroniques romanes des comtes de Foix, rédigées au XVe siècle à l’aide des archives comtales :
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 311
« Aqueste Mossen Roger, comte de Foix, fec translatar lo cos de Mosseignor Sant Antony de Lezat et portec los osses en son mantel, el meteys, devan touta la processio ecclesiastiqual, al monastier de Lezat. Et apres, en l’an mil CXI, en la quarta de genier, fec translatar lo cos de Sant Volza, que repausava prop del castel de Foix (…) » (Chronique de Arnaud Esquerrier, XVe siècle, éd. Pasquier et Courteault, 1895, p. 16-17).
Cette chronique, la plus ancienne et la plus synthétique, ne mentionne pas Antonin de Pamiers mais Antoine de Lézat, translaté avant 1111.
« Et l’an mil CVII [al. mil CXXII] fec translatar lo cors sant de sant Anthoni de Lesat et lo cors sant de sant Anthoni de Pamias et lo cors sant de sant Volsia de Foix et lo cors de sant Ferriol, et foren portatz à la gleysa de Mongausi (…) » (Chronique de Miégeville, fin du XVe siècle, éd. Pasquier et Courteault, 1895, p. 122).
Plus détaillé, ce passage mentionne clairement la translation de saint Antoine [sic] de Pamiers ; un manuscrit donne l’an 1107, l’autre 1132. Peut-être faut-il retenir la première date, où Roger II était sans doute tout juste revenu de la Croisade après avoir combattu, disent les chroniques, auprès de Godefroi de Bouillon et participé à la prise de Jérusalem (Pasquier et Courteault, 1895) ; on ne peut pas cependant exclure la date la plus tardive, qui placerait l’épisode après le conflit avec l’abbaye du Mas (8).
Quelle était donc la finalité de cette translation ? On peut penser qu’il s’agit de la concrétisation du projet énoncé dans la vita d’Anastase ; le point de départ serait alors l’abbaye du Mas. Quant au point d’arrivée, il s’agit sans doute, comme nous le soupçonnions en 2003, de l’église de Cailloup, appelée à la fin du Moyen Âge « Mas Saint Antonin vieux » dont la construction s’achève justement vers 1110-1120. La translation (d’une partie) des reliques marquerait alors la consécration de cet édifice commémorant (dans l’imaginaire médiéval) à la fois du lieu du martyre et de la sépulture d’Antonin, ainsi que l’emplacement du premier monastère de Frédelas, qu’Antonin passait pour avoir fondé.
Jean-Luc BOUDARTCHOUK »
Bibliographie complémentaire
Aigran 1922a = [Antonin d’Apamée de Syrie], dans Beaudrillart 1922, col. 848-849.
Aigran 1922b = [Antonin de Pamiers], dans Beaudrillart 1922, col. 849-851.
Aigran 1922c = [Antonin de Césarée de Palestine], dans Beaudrillart 1922, col. 851-852.
Beaudrillart 1922 = BEAUDRILLART (A.), dir., Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, fasc. XV-XVI, Paris, 1922 [col. 848-854].
Boudartchouk et al. 2003 = BOUDARTCHOUK (J.-L.), CABAU (P.), CLAEYS (L.), COMELONGUE (M.), « L'invention de saint Antonin de Frédelas-Pamiers », M.S.A.M.F., t. LXIII, 2003, p. 15-58.
Contrasty 1913 = CONTRASTY (J.), Cinq visites « ad limina », XVIe et XVIIe siècles, Paris, 1913 [Rapports de H. de Sponde sur Pamiers en 1630, 1635 et 1639, p. 68 à 108].
Couget 1869 = COUGET (A.), « Comment, au XIIe siècle, le comte de Toulouse et le comte de Foix donnèrent satisfaction aux abbayes qu’ils avaient dépouillées. Quelques mots sur saint Antonin martyr », tiré-à-part du Bull. archéologique du Tarn-et-Garonne, 1869, 14 p.
Delehaye 1935 = DELEHAYE (H.), « Saints et reliquaires d’Apamée », Analecta Bollandiana, t. LIII, fasc. III et IV, p. 225-244.
Dubois et Renaud 1984 = DUBOIS (Dom J.) et Renaud (G.), Le martyrologe d’Adon, ses deux familles, ses trois recensions. Texte et commentaire, Paris, 1984 [p. 296-297].
Fons s.d.= FONS (V.), Quelques précisions sur les origines de la ville de Pamiers, s.d., reprint C. Latour, Nîmes, 1999.
Francia 2000 = FRANCIA (S.), Antolin, dans LEONARDI (C.), RICCARDI (A.) et ZARRI (G.), dir., Diccionario de los Santos, Madrid, 2000, vol. 1, p. 220-223.
Guérin 1876 = GUERIN (P.), Les petits Bollandistes, septième édition, t. XIII, Paris, 1873 [p. 677].
Lecomte 1922 = [Antonin de Meaux en France], dans Beaudrillart 1922, col. 853-854.
Leonardi, Riccardi et Zarri 2000 = LEONARDI (C.), RICCARDI (A.) et ZARRI (G.), dir., Diccionario de los Santos, Madrid, 2000, 2 vol.
Milani 1977 = MILANI (C.), Itinerarium Antonini Placentini. Un viaggio in Terra Santa del 560-570 d. C., Milan, 1977.
Pasquier et Courteault 1895 = PASQUIER (A.) et COURTEAULT, Chroniques romanes des comtes de Foix, composées au XVe siècle par Arnaud Esquerrier et Miégeville et publiées pour la première fois, Foix, Société Ariégeoise des Sciences, Lettres et Arts, 1895.
Pouech 1884 = POUECH (J.-J.) [Anonyme], « Une céramique au sceau de saint Antonin, » L’étoile de l’Ariège, 19 juillet-23 août 1884.
Tononi 1880 = TONONI (D. G.), Notizie intorno la vita e il culto dei santi Antonino martire e Vittore vescovo, Piacenza, 1880.
Wilmart 1922 = [Antonin de Plaisance en Italie], dans Beaudrillart 1922, col. 852-853.
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 312
Documents d’archives
Lahondès, lettre 2 décembre 1904 = LAHONDÈS (J.), Lettre manuscrite datée du 2 décembre 1904, conservée aux A. D. du Tarn-et-Garonne, cote 3J48.
Lahondès, lettre 15 décembre 1904 = LAHONDÈS (J.), Lettre manuscrite datée du 15 décembre 1904, conservée aux A. D. du Tarn-et-Garonne, cote 3J48.
Lahondès, dessin du sceau de D. Grima, 15 décembre 1904 = LAHONDÈS (J.), Dessin original à la plume d’un sceau de l’évêque D. Grima (document de 1343), joint à la lettre datée du 15 décembre 1904, conservée aux A. D. du Tarn-et-Garonne, cote 3J48.
Sources hagiographiques
Inventio corporis Sancti Antonini martyris Placentini, Analecta Bollandiana, t. X, fasc. 1, 1891, p. 119-120. (= B.H.L. 580)
De sanctis martyribus Mauricio, Photino eius filio, Theodoro, Philippo et aliis LXVII militibus, Apameae in Syria II, AA. SS., 21 février, p. 237-242.
De S. Marcello episc. Ac mart. Apameae in Syria, AA.SS, 14 août, p. 151-156.
De sanctis martyribus Nicopolitanis in Armenia. Milione, Decomede, Antonio, Theolo, Cesso, Cagiano, Clirico ; item Susanna, Neciono, Theoto seu Theodoto et Cyrillo, AA.SS, 10 juillet, p. 34.
De S. Anastasio, monacho et eremita, in Gallia, AA.SS, 16 octobre, p. 1125-1140 (= Vita Sancti Anastasii, auctore Galtero, P.L., t. CXLIX, p. 425-434). (= B.H.L. 405).
Passio SS. Mauritii et Thebaerum mm, AA.SS, 22 septembre, p. 342-369.
Notes
1. Remerciements à M. Comelongue, M. Prin, et aux Archives départementales du Tarn-et-Garonne.
2. Des reliques d’Antonin de Frédelas-Pamiers étaient encore présentes dans le Toulousain après les guerres de religion, qui avaient occasionné la destruction de celles de Saint-Antonin-Noble-Val et de Pamiers. On signale le 26 octobre 1702, dans l’église des dominicains de Bruguières, la translation d’une relique de saint Antonin martyr, avec la participation des Pénitents blancs de Castelnau-d’Estretefonds qui en ont dressé la relation (renseignement de M. Prin que je remercie chaleureusement). À Toulouse, on possédait une relique d’Antonin martyr à Saint-Étienne (Guérin 1876). Par ailleurs, les reliques encore conservées (dont un crâne complet) d’Antoine de Lialores (Gers) n’ont aucun lien avec celles de Pamiers.
3. Les résumés de la Passion grecque disparue d’Antonin d’Apamée figurent, de façon inattendue, aux 9 et 10 novembre dans les synaxaires (Delehaye 1935).
4. La « vie du pape Pascal » qui valide l’invention d’Antonin de Frédelas-Pamiers a parfois été attribuée (notamment par Nicolas Bertrand) au pape saint Pascal Ier, qui l’aurait dédiée à Louis-le-Pieux (Francia, 2000, p. 221). Or, cette vie parait bien avoir effectivement une provenance italienne et a même été attribuée par erreur à Antonin de Plaisance (Boudartchouk et al. 2003).
5. Phénomène amplement attesté pour la Légion thébaine.
6. La date du 13 novembre mentionnée dans le récit de l’invention de Plaisance est également celle du natalis, sous Maximin, d’Antonin de Césarée et ses compagnons, dont la vierge Ennatha qui fut plus tard elle aussi considérée comme martyre de Pamiers, sous le nom corrompu de Nathalène (Boudartchouk et al. 2003).
7. Ce dernier pourrait bien avoir été inspiré par le nom du compagnon du pèlerin Antonin de Plaisance.
8. La charte n° 1342 du cartulaire de Moissac mentionne un déplacement des reliques d’Antoine de Lézat, de celles de Ferréol et d’autres, non nommées, à l’occasion d’une assemblée tenue à Toulouse par l’évêque Amélius, peut-être en 1114, le premier novembre.
Michèle Pradalier-Schlumberger remercie Jean-Luc Boudartchouk et lui demande si le lieu vers lequel se fit la translation opérée aux alentours de 1100 correspond à la nouvelle église de Cailloup. M. Boudartchouk répond par l’affirmative, précisant qu’une partie des reliques conservées dans le sarcophage du martyr fut alors transférée vers le lieu supposé de sa mise à mort (ce que suggèrerait l’emploi du verbe reponere). Dominique Watin-Grandchamp signale l’existence à Plaisance (Italie) d’une église fort ancienne dédiée à saint Antonin. M. Boudartchouk dit qu’une église est attestée dès le IVe siècle et qu’on a mention d’une translation du corps du martyr intra muros – peut-être est-ce la tête de cet Antonin de Plaisance qui aurait « migré » à l’époque carolingienne vers Saint-Antonin-Noble-Val ? –, mais on ne possède pas de Vita. Nelly-Pousthomis-Dalle résume la situation : on aurait eu ici un corps sans Vie, et là une Vie sans corps !
La parole est enfin au Secrétaire-adjoint pour la lecture du procès-verbal de la séance du 17 mai, qui est adopté.
Le Directeur intervient pour annoncer l’acquisition faite tout récemment pour le musée Saint-Raymond d’une sculpture antique mise aux enchères à Paris à l’Hôtel Drouot et réputée provenir de la villa romaine de Chiragan (Martres-Tolosane). Le catalogue de la vente signalait cette pièce comme ayant fait partie de l’ancienne collection Chambert, devenue collection Ollivier – laquelle est en cours de dispersion depuis un quart de siècle : divers éléments ont quitté Montauban pour apparaître dans des ventes publiques un peu partout en France et dans le monde (Paris, Enghien, Monte-Carlo, Barcelone, New-York…). Daniel Cazes souligne que, la Ville de Toulouse ayant compris l’intérêt de la sculpture en question, les fonds nécessaires ont été très rapidement débloqués : c’est ainsi que
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 313
notre
consœur Évelyne Ugaglia, conservatrice au musée Saint-Raymond, a pu en faire
l’acquisition vendredi dernier 28 mai. Cette sculpture consiste en la principale
partie du corps d’un satyre que l’on peut identifier comme appartenant au
cortège indien de Bacchus. L’œuvre originale, créée au IVe siècle
avant notre ère par le sculpteur Praxitèle, fut souvent reproduite, notamment au IIe
siècle. La provenance indiquée par le catalogue de vente paraît d’autant plus
plausible que l’architecte Chambert, collectionneur d’antiques, fit partie de la
Commission de la Société archéologique du Midi de la France qui, lors de la campagne de
1840-1848, dirigea la fouille des thermes de la villa de Chiragan ; le produit
de ces fouilles fut donné par la Société archéologique au Musée de Toulouse.
Il
existe dans les collections du musée Saint-Raymond une tête de satyre qui pourrait
correspondre au torse acheté. Du reste, d’autres œuvres de Praxitèle
eurent leurs répliques dans la villa
martraise.
La Présidente adresse
toutes ses félicitations à l’équipe du musée Saint-Raymond pour cette opération
exceptionnelle.
SÉANCE DU 14 JUIN 2005
Présents : Mme
Pradalier-Schlumberger, Présidente, MM. Coppolani, Directeur honoraire, Ahlsell
de Toulza, Trésorier, Scellès, Secrétaire général, Mme Suau, Bibliothécaire-Archiviste,
MM. Cabau, Secrétaire-adjoint, Latour, Bibliothécaire-adjoint ; Mmes
Cazes, Napoléone, Watin-Grandchamp, MM. Bordes, Gilles, le Père Montagnes, M.
Prin, Mgr Rocacher, M. Testard, membres titulaires ; Mmes Bayle, Bellin,
Cazals, Czerniak, Jefferson, MM. Barber, Garland, Stouffs, membres
correspondants.
Excusés : M. Cazes,
Directeur, Mmes Conan, Fraïsse, Galés, Marin, Stutz, M. Pradalier.
Après que la Présidente a informé la Compagnie du changement de programme du jour, le Secrétaire-adjoint donne lecture du procès-verbal de la séance du 31 mai, qui est adopté à l’unanimité après une correction.
La correspondance reçue se limite à l’annonce de l’exposition Faïence et porcelaine au fil de la Garonne. Industrie et art de la table dans le Sud-Ouest au XXe siècle, présentée dans l’ancienne abbaye de Belleperche du 1er juin au 30 septembre 2005.
La parole est à Quitterie Cazes pour des Notes sur l’architecture de l’église abbatiale de Conques :
« L’église abbatiale de Conques présente, en plan, des dispositions à priori relativement simples : une nef à trois vaisseaux de cinq travées, un transept largement saillant sur lequel sont greffées deux absidioles orientées, et un chevet à déambulatoire et trois chapelles rayonnantes. En élévation, les collatéraux de la nef, ceux du transept qui ne sont présents qu’à l’ouest et à l’est, et la travée de chœur sont surmontés de tribunes. Deux tours encadrent la façade occidentale et un lanternon couronne la croisée du transept. On a toujours reconnu dans l’abbatiale un prototype des « églises de pèlerinage », avec une ambiguïté subsistant dans la bibliographie concernant les étapes de la réalisation de son chevet, conçu d’emblée comme tel (1) ou résultat d’une reprise dans le dernier tiers du XIe siècle (2). À y regarder de plus près (3), une série de dispositions très originales caractérise l’édifice, qui en font un monument à la croisée des chemins, mêlant des éléments novateurs et des systèmes architecturaux plus traditionnels.
Au nord et à l’est, l’abbatiale se dégage à grand-peine de la pente du terrain qui a été vigoureusement tranché sur plus d’une dizaine de mètres. À l’extérieur, l’élévation présente une belle homogénéité avec l’utilisation d’un assez grand appareil régulier de grès rouge puis, au-dessus du niveau des chapelles rayonnantes, de calcaire jaune (4). Au sud, les pierres des assises sont parfaitement liées. Au nord, entre la grande chapelle du transept et la première absidiole rayonnante, liée par un mur qui vient doubler celui du déambulatoire, les choses paraissent un peu plus compliquées : il existe, au niveau du socle de la fondation, une nette césure verticale qui a fait que l’on a longtemps cru qu’il s’agissait du témoin principal de l’existence de deux campagnes différentes de construction. Cependant, une observation plus attentive montre qu’il s’agit simplement de phases d’un même chantier. À l’intérieur, l’un des aspects les plus surprenants concerne le caractère très monumental intérieurement donné à toute la ceinture orientale de l’édifice. Les chapelles du transept comme celles du déambulatoire ainsi que l’élévation de ce dernier prennent appui sur un socle haut de près d’1,30 m, formant un ressaut d’une cinquantaine de centimètres, couronné par des blocs moulurés et sculptés. La parfaite continuité des assises permet d’assurer que ce socle est construit en une seule fois.
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 314
abbatiale de Conques, plan du premier niveau avec indication
des accès et répartition des
chapiteaux du chevet. Dessin Q. Cazes.
Au-dessus, sont édifiés ensemble la première travée nord du déambulatoire, les autres travées et l’intérieur des chapelles jusqu’à l’appui des fenêtres ; en même temps, on élève le piédroit sud de la grande chapelle du transept au nord, l’intérieur de celle-ci jusqu’au sommet des arcatures ; le chantier avance de façon symétrique au sud. Ensuite viennent les parties hautes des chapelles du déambulatoire et les segments de mur qui les relient (sauf dans la travée sud, qui vient après), les parties hautes des grandes chapelles du transept et les petites chapelles. On ne peut pas considérer ces deux étapes comme éloignées dans le temps : c’est simplement l’approvisionnement en pierres qui change (grès rouge, puis gris). Le reste du transept est matérialisé par des élévations de l’ordre de deux à quatre mètres (un peu moins pour la nef), l’important étant que tous les éléments de circulation sont en place (base de la tour d’escalier du transept sud et portails, y compris l’entrée monumentale qui, au sud du transept, est masquée par la galerie édifiée par Bégon). Les deux étapes postérieures manifestent un changement conséquent dans les matériaux utilisés (calcaire jaune de Lunel et schiste gris rouge), avec une raréfaction notable des blocs de pierre de taille ; elles mènent la construction jusqu’à la base des tribunes. Les tribunes montrent un contraire un renouveau spectaculaire de la taille de la pierre ; s’y joint un schiste d’une couleur gris vert caractéristique. C’est alors que la partie supérieure du déambulatoire est reconstruite.
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 315
|
La même succession d’étapes de construction se retrouve dans la nef et le massif occidental. Celui-ci, bien qu’implanté dès l’origine, forme une structure à part qui peine à trouver sa cohérence avec le reste de l’édifice. L’essentiel est occupé par deux salles qui, de part et d’autre de l’espace de la nef centrale, voient leur sol établi à peu près à mi-hauteur des collatéraux, tandis que leur voûte prolonge celle des tribunes. On y accède par un escalier droit installé contre le mur gouttereau de la nef ; au sud, une petite porte dans ce mur menait directement au pied de l’escalier ; murée lors de la construction de l’enfeu de Bégon (1087-1107), elle fut remplacée par une ouverture plus monumentale percée dans le mur méridional de la tour sud-ouest. Depuis ces salles hautes, un escalier droit pris dans le mur de façade mène, d’une part aux tribunes (par l’intermédiaire d’une petite coursive en surplomb sur chaque salle), d’autre part, en se prolongeant par un escalier en vis logé dans les angles du massif, à l’étage des cloches. Cette rapide analyse ici résumée (5) permet de proposer quelques nouvelles pistes de recherche. D’une part, il apparaît que le chevet, dans sa disposition actuelle (avec déambulatoire et chapelles rayonnantes et, en même temps, chapelles échelonnées greffées sur les bras du transept), résulte d’un projet unitaire dont une grande part est en place lors de la consécration (entre 1042 et 1051 selon J. Bousquet). Il s’agit d’une variante des chevets qui se |
abbatiale de Conques, vue du côté nord du déambulatoire. Cliché Q. Cazes. |
|
abbatiale de Conques, coupe longitudinale par J.-C. Formigé, avec indication des niveaux de sol des tribunes et des salles occidentales, et des percements et circulation à l’ouest.
|
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 316
développent dans la première moitié du XIe siècle, que ce soit à Tournus (6), dans la vallée de la Loire (7) ou à Saint-Savin-sur-Gartempe (8), pour citer quelques exemples connus. Le socle sur lequel il est établi, couronné d’une sorte de frise sculptée, n’est pas sans rappeler l’ordonnance des podiums antiques. La conséquence est importante aussi en ce qui concerne la sculpture, car l’on doit envisager que chapiteaux à entrelacs et chapiteaux à décor de tiges nouées, certains figurés, du pourtour oriental de l’édifice soient contemporains. Ces sculptures sont nettement réparties dans l’espace (cf. fig.), l’entrelacs étant plus spécifiquement destiné au transept, les autres dans le déambulatoire. Ces derniers, qui sont véritablement originaux, connaissent une évolution propre dans les piles du transept. Cette répartition devait encore avoir un sens au moment où, dans les années 1070-1080, on mettait en pace les chapiteaux des portails occidentaux des croisillons du transept. Conception monumentale, hiérarchie de la sculpture, type des chapiteaux à entrelacs renforcent la comparaison faite depuis longtemps avec Sant Pere de Rodes (9).
abbatiale de Conques, plan au niveau des tribunes
de l’abbatiale de Conques. Dessin Q.
Cazes.
Les tribunes, même si elles ne sont réalisées que vers la fin du XIe siècle, sont certainement prévues d’emblée comme en témoigne l’accès monumental avec l’escalier en vis hors œuvre au sud du transept. Elles ne sont établies que le long des nefs voûtées d’un berceau en plein cintre sur arcs doubleaux : leur rôle est certainement conçu, au départ, comme structurel. Autant leur accès est aisé à l’est, autant il est difficile à l’ouest du transept : on peut peut-être imaginer une utilisation ponctuelle à l’est (pour les chants pendant les offices par exemple).
Le massif occidental pérennise probablement, dans sa conception, la tour qui existait à l’ouest de la première église (10), qui s’inscrit dans la tradition carolingienne. La salle sud, qui conserve les traces d’un Christ bénissant dans l’ébrasement d’une fenêtre, avait peut-être fonction de chapelle pour les moines. Autre élément architectural caractéristique qui s’inscrit dans la tradition carolingienne : la tour d’escalier hors œuvre du transept. Ces modes d’accès se multiplient, depuis la chapelle palatine d’Aix-La Chapelle entre 790 et 805, Centula Saint-Riquier dans les années 790-800 ou, dans l’architecture ottonienne, l’abbatiale de Hildesheim dans le premier tiers du XIe siècle. Plus proche géographiquement, l’église carolingienne de Saint-Guilhem-le-Désert s’achevait à l’ouest par une tour de plan rectangulaire ; l’accès aux étages se faisait par un escalier hélicoïdal pris dans une construction carrée, appliquée au sud de la tour.
À l’aune des réalisations contemporaines, Conques est un chantier exemplaire, réellement très ambitieux : en témoignent les recherches sur le plan et l’élévation, la qualité des élévations en pierre de taille, l’attention portée au décor de la sculpture. Et l’on mesure surtout l’importance des choix architecturaux fait à Conques à cette époque par leur nombreuse descendance, dont le témoignage le plus abouti est sans aucun doute Saint-Sernin de Toulouse.
Quitterie CAZES »
1. M. Aubert avait noté la grande homogénéité des matériaux du chevet, ce qui plaide en faveur d’une unique campagne de construction : « Le mur du déambulatoire et des chapelles rayonnantes, les piles des parties droites du chœur, les chapelles des croisillons, les parties basses des piles du transept […] sont en grès rouge, d’un appareil régulier, assez grand, aux joints de mortier rose bien marqués, apprêtés à la taille oblique du XIe siècle » : M. Aubert, « Conques en Rouergue », Congrès archéologique de France, 100e session, 1937, Paris, 1938, p. 473-474.
2. Pour J.-Cl. Fau, à la mort d’Odolric (1031-1065), l’extrémité orientale – au moins son premier niveau – ainsi que les grandes chapelles du transept sont achevées. Des désordres survenus dans les maçonneries entre 1065 et 1080, mentionnés dans le récit d’un
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 317
miracle, obligent à reprendre une grande partie du chevet. Subsisteraient donc seules du premier chantier les grandes absidioles orientées des bras du transept : J.-Cl. Fau, Rouergue roman, La Pierre-qui-Vire, 1990, p. 93-95. Pour M. Durliat, lorsqu’il analyse la sculpture, « les travaux de la première campagne paraissent avoir débuté dans les grandes absides du transept, s’être poursuivis dans les petites et avoir pris fin dans le déambulatoire, où l’on observe une véritable mutation correspondant probablement au changement de parti de la construction : M. Durliat, De Conques à Compostelle. La sculpture romane de la route de Saint-Jacques, Mont-de-Marsan, CEHAG, 1990, p. 51-52.
3. Cette analyse a été faite à l’occasion de la préparation du film L’abbatiale Sainte-Foy de Conques (Arte-Les Films d’ici) réalisé par Stan Neumann, en liaison avec l’exposition « La France romane au temps des premiers Capétiens » (musée du Louvre, printemps 2005) : j’ai grand plaisir à remercier ici Jean-René Gaborit, à l’origine de ce projet, et Stan Neumann pour les bons moments passés à Conques.
4. Les restaurations importantes effectuées par l’architecte Boissonnade dans les années 1840 semblent avoir reproduit l’appareil ancien d’une manière scrupuleuse : « les nouvelles pierres ont la dimension des anciennes » : rapport de 1840 cité par L. Causse, « Conques : chronique d’une restauration », dans Vivre en Rouergue, n° 61, Hiver 1986, p. 15-16.
5. Ce travail fait l’objet d’un article plus développé à paraître dans Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XXXVIII, 2006.
6. J. Henriet, « Saint-Philibert de Tournus. Histoire. Critique d’authenticité. Étude archéologique du chevet (1009-1019) », Bulletin monumental, 1990, p. 229-316.
7. P. Martin, « Premières expériences de chevets à déambulatoire et chapelles rayonnantes de la Loire moyenne : état de la question », dans Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XXXII, 2001, p. 181-194.
8. Y.-J. Riou, M.-Th. Camus, « L’architecture et son décor sculpté », dans R. Favreau (dir.), Saint-Savin. L’abbaye et ses peintures murales, Poitiers, CPPPC, 1999, p. 46 et suiv.
9. En dernier lieu, I. Lorés i Otzet, « L’église de Sant Pere de Rodes, un exemple de « renaissance » de l’architecture du XIe siècle en Catalogne », dans Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XXXII, 2001, p. 21-38 et El monestir de Sant Pere de Rodes, Barcelona-Girona-Lleida, Memoria Artium, 1, 2002, p. 73 et suiv.
10. On sait, par le récit de l’un des miracles rapportés par Bernard d’Angers, que l’aveugle Guibert, à la fin du Xe siècle, après avoir recouvré la vue, « se hâta de monter l’escalier de la terrasse qui, à l’entrée de l’église, se trouve au-dessus de la chapelle Saint-Michel ».
La Présidente remercie Quitterie Cazes pour cette relecture pierre à pierre du chevet de Conques, qui autorise déjà des conclusions très intéressantes. La démonstration de la continuité de la base du chevet est tout à fait convaincante et les maladresses que montrent les juxtapositions des chapelles s’expliquent bien avec une datation haute. Il est tout à fait vrai par ailleurs que le massif occidental est le parent pauvre des études sur Conques et il est juste de l’inscrire dans la tradition de l’architecture carolingienne.
Emmanuel Garland propose quelques remarques, après avoir dit qu’il a « bu comme du petit lait » l’ensemble de la démonstration, qui l’a convaincu à 99 %. Il observe tout d’abord que celui qui a conçu l’édifice s’est attaché à l’espace intérieur comme aux élévations extérieures. Aucun aménagement souterrain n’a jamais été prévu, alors que l’on disposait de l’espace et des moyens de réaliser une crypte. Quant au massif occidental, Emmanuel Garland exprime son scepticisme sur l’hypothèse d’une chapelle haute dédiée à saint Michel, relevant que le chapiteau qui représente l’archange, et qui lui paraît plutôt maintenir une tradition, ne se trouve pas au meilleur endroit. Pour Quitterie Cazes, l’important est qu’il soit là. Emmanuel Garland poursuit ses observations en rappelant que la tour hors-œuvre du bras sud du transept a un équivalent à Saint-Guilhem-le-Désert avec la petite tour Saint-Martin qui est également hors-œuvre. Puis il attire l’attention sur le petit appareil de la partie basse du bras nord du transept, constitué de blocs très différents. Pour Quitterie Cazes cela doit concerner dans ce cas une dizaine de mètres-cubes, et des observations similaires pourraient être faites au bras sud du transept, ou à la façade occidentale… ces variations devant sans doute être liées à l’approvisionnement du chantier.
Patrice Cabau remercie à son tour Quitterie Cazes pour cette lecture de l’édifice qui permet de saisir la logique de la progression du chantier et il regrette que cela ne soit guère possible pour Saint-Sernin de Toulouse. Pour Olivier Testard, la même analyse peut être appliquée à Saint-Sernin et il se propose d’en faire la démonstration prochainement. Patrice Cabau et Quitterie Cazes veulent bien en convenir tout en réaffirmant que l’exercice est néanmoins plus difficile qu’à Conques.
Dominique Watin-Grandchamp s’intéresse aux encadrements de certaines des baies, à l’appareil du pignon au-dessus de la rose… et se demande s’il n’y aurait pas là matière à changer un peu la chronologie du chantier, qui ne serait pas tout à fait aussi cohérente. Quitterie Cazes affirme que les différences sont assez bien marquées, dans la qualité des pierres, la taille ou la mise en œuvre. Elle ajoute que des informations complémentaires pourraient être données par les marques de tâcherons qu’il faudrait relever.
Patrice Cabau l’interroge sur le mode de couvrement avant 1050. Quitterie Cazes est persuadée que l’on prévoit un édifice entièrement voûté, comme le laisse supposer la tour hors-œuvre devant donner accès aux tribunes. Et comme Patrice Cabau lui demande quelle en était la fonction, elle précise que la fonction des tribunes est architecturale. Emmanuel Garland abonde dans ce sens en indiquant qu’il n’y a jamais trouvé aucune trace d’aménagement de sol, et que l’on marche sur les voûtes d’arêtes ; on ne peut d’ailleurs monter aux tribunes que par l’escalier de la tour hors-œuvre, dont Quitterie Cazes note qu’elle n’était accessible qu’aux moines.
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 318
La parole est à François Bordes pour une présentation du nouveau site Internet des Archives municipales de Toulouse (www.archives.mairie-toulouse.fr).
La Présidente
remercie François Bordes en soulignant que les Archives municipales mettent
ainsi à disposition du public un merveilleux instrument de travail. François
Bordes donne des précisions sur la numérisation de l’inventaire de Roschach.
Maurice
Scellès demande des précisions sur les instruments de recherche disponibles
sur le site et sur l’éventuelle mise en ligne d’images en haute définition.
François Bordes indique qu’il n’est pas prévu pour l’instant de mettre
en ligne des images en haute définition. Quant aux plans de Toulouse, les
Archives municipales ont en projet une édition en fac-similé.
La
discussion se porte ensuite sur l’archivage des documents du site. Après
avoir rappelé que l’archivage sous forme d’édition papier ne permettait
pas la conservation des liens, François Bordes fait observer qu’un site
Internet est un document dynamique, sans cesse modifié, dont le volume croît
de façon arithmétique si l’archivage est réalisé en ligne ; la
solution retenue est donc un archivage sur Cd-rom des versions successives du
site.
Guy Ahlsell
de Toulza exprime sa satisfaction de trouver les plans de Toulouse sur le site
des Archives municipales et souligne tout l’intérêt que présentent déjà
les informations sur les capitouls. François Bordes confirme le projet d’une
édition complète de la transcription des Annales de Toulouse, et annonce à ce propos
que le feuillet qui était en restauration a été retrouvé par l’atelier du
Louvre.
Au titre des questions diverses, le Secrétaire général donne lecture d’une note de Françoise Stutz, empêchée, sur Une plaque-boucle mérovingienne provenant de Montbrun-des-Corbières (Aude) :
« Plaque-boucle non articulée, ajourée.
Alliage cuivreux ; L. aa = 87 mm ; l. bb = 43 mm ; l. cc = 41 mm.
Montbrun-des-Corbières (Aude), près de la chapelle de Colombier.
Collection particulière.
Montbrun-des-Corbières, plaque-boucle, face.
Plaque-boucle non articulée, ajourée, forme bifide avec des lobes semi-circulaires séparés d’un espace. Le contour est mouvementé, animé de deux crochets latéraux. La boucle est rectangulaire. L’ardillon n’est pas conservé. Son crochet pouvait être glissé dans l’ajour circulaire placé sous la boucle (l’ajour fonctionnel). La fixation à la ceinture dépendait de trois œillets placés au revers. La plaque est ornée d’un
Montbrun-des-Corbières, plaque-boucle, face et profil.
Dessin Françoise Stutz.

Montbrun-des-Corbières, plaque-boucle, face et revers.
Clichés Françoise Stutz.
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 319
décor au trait, venu de fonte. Sur certains motifs, en particulier sur la grille, on distingue un trémolo. Les biseaux des contours et des ajours sont épais et très grumeleux, extrêmement boursouflés au revers. Les irrégularités sont prononcées dans les secteurs fermés (entre les crochets et pour les ajours). L’aspect de surface de la plaque est très irrégulier.
L’ajour fonctionnel a été placé très haut, à 1 mm de la boucle. L’observation à la binoculaire a révélé l’absence de trace d’usure, sur la boucle, à la retombée de l’ardillon, à l’avers et au revers de l’ajour fonctionnel.
L’étude de la plaque-boucle complétée d’une observation macrologique permet de déduire une fabrication avec un alliage cuivreux fondu dont le moule a été obtenu par surmoulage direct d’une autre plaque-boucle. C’est ce qu’indique l’absence de retouche du décor (dilution des trémolos des graphismes, aspect grumeleux de surface, bourrelés à l’avers). La torsion du crochet droit pourrait être venue de fonte, par un vrillage du moule avant le séchage complet. Il n’est pas certain que cette plaque-boucle ait été portée compte tenu de la fragilité de l’ajour fonctionnel et de l’absence de traces d’usure.Le décor s’organise selon une symétrie axiale. Les trois ajours oblongs procédaient d’une mise en valeur des motifs. C’est une version schématisée du style animalier provincial où deux animaux s’affrontent symétriquement, avec le corps qui anime le contour des plaques. Ainsi griffons marins (1) et dauphins (2) ont été trouvés sur des plaques non articulées ajourées du bassin méditerranéen.
La plaque-boucle de Montbrun-des-Corbières est morphologiquement (forme et dimensions) très proche d’une plaque-boucle conservée au Musée des Antiquités Nationales (82 x 38 mm) (3). Pour cette dernière, F. Vallet a identifié les sujets comme étant deux oiseaux dont les becs s’enroulent au-dessus des ajours proximaux qui encadrent un visage. Les crochets correspondent à l’extrémité des ailes.
La plaque-boucle de Castelnau-Pégayrols (Aveyron) offre une seconde comparaison intéressante (4). Sur cette plaque, on retrouve aussi les crochets latéraux, les trois ajours et l’extrémité bifide. Les motifs sont ici géométriques, des lignes parallèles doublées de points soulignent les contours. Une croix est inscrite dans chaque lobe de l’extrémité.Outre ces comparaisons directes, de nombreuses versions de plaques-boucles de l’époque mérovingienne présentent les mêmes particularités typologiques avec la morphologie non-articulée, la présence d’ajours et le contour qui épouse la forme de l’animal. Géographiquement proche, la plaque-boucle non articulée de Lagrasse (Aude) (5) est une variante, avec des champs en dépression à la place des ajours. Elle rappelle une série de plaques-boucles ajourées trouvées dans l’Oise et le Val-d’Oise (6) où quatre dauphins affrontés, superposés, sont clairement identifiables. Deux plaques-boucles non articulées ajourées, aux monstres à l’anguipède affrontés, ont été trouvées dans la tombe 49 de Roujan (Hérault) et dans la tombe 244 du Mouraut (Le Vernet, Haute-Garonne) (7). Elles constituent une autre version régionale trouvée entre la Méditerranée et Toulouse.
Pour conclure, la plaque-boucle de Montbrun-des-Corbières reprend de manière schématique le style animalier provincial dont les corps conditionnent la forme des plaques. Il est préférable d’éviter le terme de “type méditerranéen” défini par G. Fingerlin en 1967 (8) tant les versions locales sont nombreuses. Les plaques-boucles non articulées relèvent du type 161 de la chronologie normalisée unifiée (9), elles sont datées du Mérovingien Ancien III (550/60-590/600).
Françoise STUTZ »
1. Espagne, dans H. Zeiss, Die Grabfunde aus dem spanischen Westgotenreich, Berlin et Leipzig, 1934, pl. 15 n° 7.
2. Cimetière de Kalaja Dalmaces en Albanie, dans Archéologie comparée. Catalogue sommaire illustré des collections du Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye, vol. 1, R.M.N., p. 497 n° 35898.
3. Plaque-boucle de la collection Fèbvre au Musée des Antiquités Nationales (MAN-17703), dans H. Gaillard de Sémainville, F. Vallet, « Fibules et plaques-boucles mérovingiennes de la collection Fèbvre conservées au Musée des Antiquités Nationales », dans Antiquités Nationales, n° 11, p. 59 et fig. 1-8, ou encore consultable sur le site Joconde mis en ligne par le Ministère de la Culture.
4. Rémi Azémar, « Place et traitement des morts sur les Causses sud-aveyronnais au haut Moyen Âge », dans Ph. Gruat dir., Croyances et rites en Rouergue des origines à l'an mil, catalogue d'exposition du Musée de Montrozier, juin 1998-octobre 2000 ; Françoise Stutz, Les objets mérovingiens de type septentrional dans la moitié sud de la Gaule, thèse de doctorat, Université Aix-Marseille I (Université de Provence), sous la direction de M. Fixot, 2003, vol. 2, pl. 19, n° 370.
5. Les derniers Romains en Septimanie. IVe-VIIIe s., Catalogue d’exposition du Musée de Lattes, septembre 1987-mai 1988, p. 217, n° 93 ; F. Stutz, op. cit., pl. 19 n° 368.
6. F. Vallet, 1977, « Le mobilier de la nécropole mérovingienne de la nécropole de Jaulzy (Oise) », dans Revue archéologique de l'Oise, t. 10, p. 87, fig. 9-1 à 5.
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 320
7. Fouilles de sauvetage INRAP qui se sont déroulées en février 2005, sous la direction de D. Paya. Les objets trouvés dans les tombes sont en cours d’étude.
8. G. Fingerlin, « Eine Schnalle mediterraneer Form aus dem Reihengräberfeld Gültlingen (LdKrs-Konstanz) », dans Badische Fundberichte, t. 23, 1967, p. 159.
9. R. Legoux, P. Périn, F. Vallet, « Chronologie normalisée du mobilier funéraire mérovingien entre Manche et Lorraine », dans Bulletin de l'Association française d'Archéologie mérovingienne, hors série, 2004, 58 p.
Guy Ahlsell de Toulza évoque alors le site du Hauré, que Mathieu Ferrier nous avait présenté lors d’une communication en séance (M.S.A.M.F., t. LX, 2000), et dont il a appris la dévastation par des prospecteurs utilisant des détecteurs de métaux. Maurice Scellès ajoute que l’on déplore aussi de plus en plus souvent le pillage systématique des sites préhistoriques dont les plus belles pièces lithiques alimentent un marché étonnamment actif.
Maurice Scellès donne ensuite lecture d’un document figurant parmi des fragments de minutes d’actes notariés ou d’exploits d’huissier, des XVIIe et XVIIIe siècles (auxquels se mêle une proclamation imprimée de 1791), qui ont été utilisés pour servir de couverture à un volume du Traité des maladies des femmes de J. Astruc, imprimé en 1770. Les actes citent de nombreux lieux dont Pompiac, Sabaillan… Le document qui nous intéresse se rapporte à des travaux faits en 1736 à un moulin de Labastide-Savès :
« de la ville [………………..] / au lieu de labastide saves, et au logis à la requisiti[on des] / parties, savoir du Sr Alexis merens baill[ to] de la te[rre] / de la bastide, et de blaise Charlas barthelemy B[….] / et arnaud Darollis charpentiers entrepreneurs des ouvr[ages] / contenus au devis fait par bernad jean architecte des / ouvrages du Roy et pierre lalubie no(taire) royal de lisle en do[don] / et que Mr merens fermier ma remis en main, et dans / linstant m étant transporté dans le moulin pour faire la / vérification desd(its) ouvrages du moulin foulon digues et chau[ssées] / apres avoir fait la lecture desd(its) articles contenus au devis / et ayant examiné ic[eluy] i ay trouvé lesd(its) ouvrages faits [et] / parfaits, et ensuite m étant transporté à la maiterie appel[ée] / […………………………….] lecture dud(t) devis jai trouve
[..] au logis, que le Sr Alexis merens me donna le doubl[e] / [d]u devis et relation des reparations de 1736, et du / 24 jour du mois de juin par bernad jean architecte des / ouvrages du Roy, habitant de St Rome, et dans ce temps / habitant de lisle dodon, et pierre lalubie no(taire) royal dud(it) / lisle dodon, et moy d[ C ]sade habitant de Cazaux / qui ay fait lad(ite) verification de la manière qui suit / pour aller faire la verification des ouvrages du moulin / dud(it) labastide saves et du foulon digues et chausées / apres avoir fait lecture dud(it) devis, jay verifié et / examiné le tout, jay trouvé fait et parfait, le tout / conformement aud(it) devis, en foy de quoy ay signé […] »
Le Bibliothécaire-adjoint indique à la Compagnie que la collection de diapositives donnée à notre Société par notre confrère Gabriel Manière compte 610 clichés ; ce sont des photographies déjà anciennes dont la durée de conservation paraît limitée et il a suggéré de les faire numériser. Les informations qu’il a pu recueillir concernant la numérisation des diapositives laissent penser que cela serait possible sans coût excessif.
Louis Latour
rend également compte de la longue conversation téléphonique qu’il a eue
avec M. Surmonne, conservateur en chef à la Bibliothèque municipale de
Toulouse, à propos du projet de mise en réseau des bibliothèques des Académies
et Sociétés savantes de l’Hôtel d’Assézat dans le cadre du réseau des
bibliothèques toulousaines.
La Présidente
annonce encore la proposition du conservateur du musée de
Saint-Bertrand-de-Comminges de faire numériser les photographies appartenant à
notre Société.
La Présidente prononce la clôture de l’année académique 2004-2005 en invitant la Compagnie à partager le verre de l’amitié.
M.S.A.M.F., t. LXV, p. 321
*
Addendum à la note de France Félix-Kerbrat sur La chapelle Notre-Dame de l'église Saint-Exupère de Coupiac (Aveyron) :
« Dans le n° 88 du Bulletin
de Sauvegarde du Rouergue, paru en 2005, consacré à Saint-Exupère de Coupiac,
le texte de F. Félix-Kerbrat, p. 1-27, n'a non seulement pas été relu
par l'auteur mais a été retouché à son insu ; de ce fait il comporte
des erreurs dont il n'est pas responsable.
Une
information donnée par P. Cabau vient d'être confirmée par de toutes récentes
découvertes faites par B. Suau dans des fonds notariés. Elles ont révélé
que, entre 1350 et 1500, l'église de Saint-Exupère était dédiée à la
Vierge et s'appelait Beata Maria de Sancta Superia (écrit aussi Exsuperia).
Sancta Superia (sainte Supérie) est une martyr quercynoise, du VIe
siècle, vénérée dans la région de Cahors. On peut supposer que le
changement de titulaire, voulu sans doute par l'autorité épiscopale, s'est
fait lors de la reconstruction de l'église au XVIe siècle. La
Vierge, à qui on consacre une belle chapelle, aurait été alors évincée par
saint Exupère, tandis que sainte Supérie était tombée dans l'oubli. »
*
© S.A.M.F. 2004-2005. La S.A.M.F. autorise la reproduction de tout ou partie des pages du site sous réserve de la mention des auteurs et de l'origine des documents et à l'exclusion de toute utilisation commerciale ou onéreuse à quelque titre que ce soit.