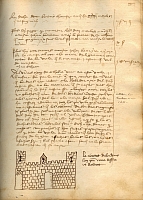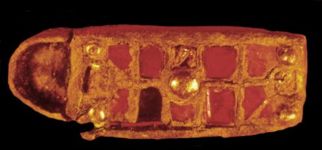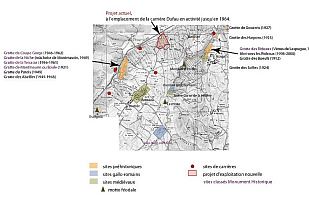|
Mémoires
de la Société Archéologique
du Midi de la France
_____________________________________
Tome LXVIII (2008)
|
BULLETIN DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE
2007-2008
établi par Patrice
CABAU & Maurice SCELLÈS
Les parties non reproduites dans l'édition papier
apparaissent en vert dans cette édition électronique.
Version de pré-publication
SÉANCE DU 5 FÉVRIER 2008
Présents : Mme
Pradalier-Schlumberger, Présidente, MM. Cazes, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier,
Scellès, Secrétaire général, Mme Suau, Bibliothécaire-Archiviste, MM.
Cabau, Secrétaire-adjoint, Latour, Bibliothécaire-adjoint ; Mme Bayle,
MM. Bordes, Gilles, Peyrusse, Roquebert, membres titulaires ; Mmes Barber,
Czerniak, Haruna-Czaplicki, Krispin, MM. Capus, Le Pottier, Surmonne, membres
correspondants.
Excusés : Mmes Cazes,
Fournié, MM. Barber, Garland.
La Présidente
souhaite la bienvenue à Pascal Capus, tout récemment élu membre correspondant
et qui prend séance ce soir.
Le Secrétaire
général et le Secrétaire-adjoint donnent lecture des procès-verbaux des séances
du 23 novembre 2007 et des 8 et 22 janvier derniers, qui sont adoptés.
Daniel Cazes
communique l’avis de décès de Jean Davoisin, ancien conservateur du Musée
Toulouse-Lautrec d’Albi.
La
correspondance comprend les vœux des anciens élèves de l’école vétérinaire
avec l’indication de l’adresse d’une exposition virtuelle consacrée à
Jean-Pierre Laffon, l’architecte de l’ancienne école vétérinaire de
Toulouse.
Quatre mémoires
viennent s’ajouter aux deux premières candidatures reçues pour le concours :
- Benjamin
Marquebielle, Première approche sur l’exploitation des matières dures
animales au mésolithique. L’industrie osseuse des niveaux du mésolithique récent
au Cuzoul de Gramat (Lot), mémoire de master II sous la direction de Mme Aline
Averbouh et de M. Nicolas Valdeyron, Université de Toulouse-Le Mirail, 2007, 99
p.
- Nadia
Cavanhie, Étude archéozoologique et taphonomique des grands carnivores du site
paléolithique moyen du Regourdou
(Montignac, Dordogne), mémoire de master II sous la direction de M. Michel
Barbaza, Université de Toulouse-Le Mirail, 2006-2007, 123 p.
-
Éric Hold, Locus et Ductus. La narration visuelle en pierre. Exemples de
la sculpture romane de Moissac et Toulouse, mémoire de master II sous la
direction de M. Jean-Claude Schmitt, E.H.E.S.S., 2006, 127 p.
- Fabien
Colleoni, Le territoire de la cité d’Auch dans l’Antiquité, doctorat en
Sciences de l’Antiquité sous la direction de M. le professeur Robert
Sablayrolles, Université de Toulouse-Le Mirail, 2007, 5 volumes.
Maurice
Scellès se chargera du rapport sur le mémoire de M. Éric Hold. Une discussion
s’engage sur le fait de savoir si notre Société doit recevoir, pour les
concours, des travaux sur la préhistoire. Louis Latour rappelle qu’Émile
Cartailhac a été l’un de nos grands présidents. Louis Peyrusse pense
qu’ils doivent être écartés, car notre Compagnie n’a pas actuellement de
compétence particulière dans ce domaine.
On fait par
ailleurs remarquer que M.
Fabien Colleoni, qui a été récompensé par le prix du professeur Michel
Labrousse en 2001, ne peut être primé une seconde fois par notre Société.
La parole
est à François Bordes pour une communication brève Sur la découverte
d’un fragment
d’un deuxième exemplaire de la chronique d’Étienne de Gan :
Les recherches dans les fonds
d’archives nous réservent encore bien des surprises, et c’est l’une
d’elles que je voudrais ici vous présenter. Dans le cadre de la
collaboration que Véronique Lamazou-Duplan et moi-même menons autour de l’œuvre
et du personnage de Nicolas Bertrand, j’ai été amené à m’intéresser
à un document conservé aux Archives départementales de la Haute-Garonne,
dans la paradoxale série des « Manuscrits », et dont l’analyse
semblait alléchante : « Fragments du De
Tholosanorum gestis, de Nicolas Bertrand ». Personne, à ma
connaissance, n’avait jusqu’ici ni utilisé ni même mentionné ce texte,
ce qui me paraissait étonnant pour ce qui pouvait s’avérer être la seule
trace d’une version manuscrite de ce livre pionnier de l’historiographie
toulousaine.
En fait, ce feuillet conservé
sous la cote Ms 123 avait trompé la vigilance de l’archiviste qui l’avait
eu entre les mains à l’époque. Il s’agit en effet du fragment d’une
copie de la fameuse dissertation sur l’origine mythique de Toulouse rédigée
en 1452-1453 par le franciscain Étienne de Gan.
Il se présente sous la forme
d’un feuillet de parchemin plié en deux et formant 4 pages de textes.
Celui-ci est écrit à longues lignes régulières et comporte 30 lignes à la
page. On peut noter que la place réservée aux initiales ornées a été réservée,
mais qu’aucune n’a été réalisée. L’écriture paraît être de la
seconde moitié du XVe siècle. Ce feuillet avait servi de
couverture à un registre, peut-être de notaire. La dernière page, couverte
d’opérations et de comptes postérieurs, porte deux fois le nom de « Benedicti »
et la mention « n° 235 », mais les recherches que nous avons
effectuées ne nous ont malheureusement pas permis à ce jour d’identifier
le fonds dont pouvait provenir ce document. Une liste de noms et de folios
portée sur la page 2 permettra peut-être un jour d’en savoir plus.
Jusqu’à maintenant, le
texte d’Étienne de Gan n’était connu que par un seul manuscrit, celui
conservé aux Archives municipales de Toulouse. Il introduit en quelque sorte
le nouveau grand cartulaire de la ville mis en forme en 1538-1539 par le
juriste Guillaume de La Perrière, le
greffier du consistoire Pierre Salamonis et le garde des archives Jean
Balard, et
transcrit, du moins en partie, par Vidal Mène et Guillaume Masaudier (1). Les
14 folios sur lesquels cette narration sur les origines de Toulouse se développe
apparaît en fait comme une œuvre de troisième main. Le premier rédacteur
et auteur se nomme lui-même dans sa dédicace : frater
Stephanus de Gano, magister in
Theologia, sacri ordinis Minorum professor, oriundus civitatis Tholose.
Son manuscrit original a disparu, de même que la copie qui en fut réalisée
le 22 septembre 1453 par un clerc travaillant dans l’ouvroir d’un notaire
de la cour du sénéchal qui nous a laissé des indications précises sur son
travail : Ego Dionisius
Moriceti, clericus solutus, oriundus ville Molleronis, diocesis
Lucronensis, scripsi atque abstraxi et correxi cum originali, me existente in
civitate et villa Tholose, in operatorio magistri Petri Scalerii, notarii
curie criminalis, civili et appellacionum domini senescalli regii videlicet
anno Domini millesimo quater-centesimo quinquagesimo tertio et die XXIIa
mensis septembris. C’est cette copie qui fut transcrite en 1538-1539
lors de la confection du nouveau cartulaire, avec les erreurs inhérentes à
ce genre d’exercice.
|

Fragment
de la Chronique d’Étienne de Gan, A.D. Haute-Garonne, Ms 123. |
Le manuscrit des Archives départementales
correspond en fait à la partie centrale de la dissertation (2). La chance que
nous avons pour comparer ces deux versions en l’absence du texte original
est que cette partie comprend deux longues citations de textes connus :
l’un tiré du Deutéronome (Deut.,
32, 15-25), et l’autre du Carmen
paschale de Sedulius (Carmen paschale, I, 242-281). Les tableaux
ci-dessous font apparaître les principales différences entre les deux
copies, pour lesquelles nous avons souligné les bonnes versions. |
|
Deutéronome
|
|
AD, Ms 123
|
AMT,
AA 5
|
|
Provocaverunt
eum in diis alienis et in
abhominacionibus
ad iracundiam concitaverunt.
Immolaverunt iis
et non Deo, diis quos ignorabant.
Novi recentesque venerunt quos non
coluerunt patres eorum : Deum qui te genuit dereliquisti et
oblitus es Domini creatoris tui. Vidit Dominus et ad iracundiam concitatus
est, quia provocaverunt eum filii sui et filie. (…) Ignis succensus
est in furore meo et ardebit usque ad inferni
novissima. (…) Dentes bestiarum [in]mittam
in eos cum furore trahencium super terram atque serpentium.
|
Provocaverunt eum in diis alienis et in
abominationibus ad iracundiam [concitaverunt].
Immolaverunt ia
et non Deo, diis quos ignorabant.
Novi recentesque noverunt quos non coluerunt
patris eorum. Deum qui te genuit dereliquisti et oblitus es Domini
creatoris tui. Vidit Dominus et ad iracundiam conneatus, est,
quia provocaverunt eum filii sui et filie. (…) Ignis succensus est in
furore meo et ardevit usque]
ad inferni novissima. (…)
Dentes
bestiarum inmittam in eos cum furore trahentium super terram atque stipentium.
|
|
Sedulius:
Carmen paschale
|
|
AD, Ms 123
|
AMT,
AA 5
|
|
Heu miseri qui varia colunt,
qui corde sinistro
Religiosa
sibi sculpunt simulacra suumque
Factorem
fugiunt et que fecere verentur!
Quis
furor est ? que tanta animos demencia ludit
Ut
volucrem turpemque bovem tortumque draconem
Semihominemque
cavem supplex homo (prius) [plenus] adoret ?
Ast
alii solem cecatis mentibus acti
Affirmant
rerum esse patrem, quia rite videtur
Clara(m)
serenatis infundere lumina terris
Et
totum lustrare polum, cum constet ab istis
Motibus
instabilem rapidis discursibus ignem
Officium,
non esse Deum, quique ordine certo
Nunc
oritur, nunc occiduas demissus in (h)oras
Partitur cum nocte vices nec semper ubique [est].
Nec
lumen fuit ille manens in origine mundi
Cum geminum
sine sole diem novus orbis haberet.
Sic lune quoque vota ferunt quam crescere
cernunt
Ac minui, stellisque litant que luce fugantur.
Hic laticem colit, ille larem, sed iungere sacris
Non audent inimica suis, ne lite
propinqua
Aut rogus exiguas desiccet fortior
undas,
Aut validis tenues moriantur fontibus ignes.
Arboreis alius ponit radicibus aras
Instituitque dapes et ramos flebilis orat.
|
Heu misereri qui vana colunt,
qui corde sinistro
Religiosa
sibi sculpunt simulacra suumque
Factorem
fugiunt et que fecere verentur !
Quis
furor est ? que tanta animos demancia ludit,
Ut
volucrem turpemque bovem tortumque drachonem
Sed
hominem
cavem supplex homo (primis) [plenus] adoret ?
Ast
alii solem cecatis mentibus acer
Affirmant
rerum esse patrem, quia rite videtur
Clara(m)
serenatis infundere lunam terris
Et
totum lustrare polum : cum constet ab istis
Motibus
instabilem rapidis discursibus ignem
Officium,
non esse Deum, quique ordine certo (in horas)
Nunc oritur, nunc occiduas demissus [in oras]
Partitur cum nocte vices nec semper ubique [est].
Nec lumen fuit ille manens in origine mundi
Cum geminem
sine sole diem novus orbis habeat.
Sic lune quoque nota ferunt quam ce facte
cernunt
Ac minui, stellisque litant que luce fugantur.
Hic laticem colit, ille larem, sed iungere sacris
Non audent inimica suis, nolite propinqua
Aut rogus exiguas desiccet sortiri undas,
Aut validis tenues moriantur fontibus ignes.
Arboreis alius ponit radicibus aras
Instituitque dapes et ramos flebilis orat.
|
Il apparaît ainsi clairement
que le manuscrit des Archives départementales est beaucoup plus fidèle aux
textes originaux que celui des Archives municipales. Cela s’explique
certainement par le fait que ce document, contrairement à celui du cartulaire
de la ville, était une première copie prise sur l’original.
Il nous reste maintenant à
tenter d’identifier le registre dont il formait la couverture et à
rechercher si d’aventure d’autres volumes comportent des feuillets du même
type.
François BORDES
1. Sur ce cartulaire, coté AA
5, voir entre autres : François Bordes,
« Les cartulaires urbains de Toulouse (XIIIe-XVIe
siècles) », dans Daniel Le
Blévec, dir., Les cartulaires méridionaux, Actes du colloque organisé
à Béziers les 20 et 21 septembre 2002 par le Centre historique de recherches
et d’études médiévales sur la Méditerranée occidentale, Paris, École
des Chartes, 2006, p. 217-238 (p. 228-231), pl. h.-t., et Géraldine Cazals, « Une contribution inédite à
l’historiographie toulousaine : le Catalogue et summaire de la
fundation […] de Tholoze de Guillaume de La Perrière (1539-1540) »,
dans M.S.A.M.F., t. LXV, 2005, p. 139-161.
2. Elle se situe dans le
cartulaire AA 5 du f° 7 ligne 7 au f° 9v ligne 19.
François Bordes présente
ensuite à la Compagnie de Nouveaux éléments sur le
feuillet de 1452-1453 des Annales manuscrites de Toulouse
:
Nous avions présenté il y a
quelques mois une communication sur un feuillet des annales manuscrites de
Toulouse daté par erreur de 1447 et correspondant en fait à l’année
capitulaire 1452-1453 (1). L’interprétation du dessin inachevé qui
l’ornait avait donné lieu à diverses hypothèses, et j’avais avancé à
l’époque que la plus vraisemblable paraissait être qu’il s’agissait
d’une illustration concernant le siège de Bordeaux qui s’était déroulé
à partir de la mi-août 1453, un mois après la bataille de Castillon, et plus
particulièrement la reddition de la ville en octobre de cette même année. Les
arguments que j’avais émis n’avaient, semble-t-il, pas convaincu nos collègues,
qui avaient entre autres mis en doute l’écho qu’un tel fait de guerre avait
pu avoir à Toulouse à l’époque.
Or un nouveau document prouve de
façon claire que cet événement eut un retentissement exceptionnel dans notre
ville et dans toute la région, et vient confirmer ma théorie. Il s’agit
d’un registre de comptabilité de la ville de Millau qui porte, à la date du
19 octobre 1453 le récit circonstancié de l’arrivée dans la cité rouergate
d’un huissier du parlement de Toulouse venu annoncer la reddition de la capitale anglaise de
l’Aquitaine (2). En voici la transcription :
|
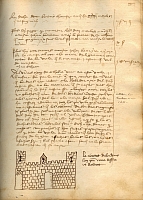
Registre de comptes de la Ville de Millau, A.M. Millau, CC 425, 1er
inv., fol. 23. |
Divenres
a XIX de octhobre, venc en esta viala .I. huchier de parlament, en que contet de
novel que Bordeus era redut a la hobediensia del rey nostre senhor en la maneira
que s’iensec, so es ha saber que lo rey nostre senhor a laisat anar totz los
Englezes que eron dedins Bordeus a vida salva e los autres del loc a la merse
del rey e lur ha cassatz e debatutz totz los privilegis e libertatz e costumas
que los abitans de Bordeux aguesso; item plus si son sosmezes a la voluntat de
tot en tot del rey de tot so que el volia; e d’autra part dono al rey sent
melia escutz e per so per las dichas bonas novela foug dich e hordenat per
messenhors companhos que hom fezes prosesio general per tota la vial e nonremens
que hom fezes fuocz d’alegria e fezes belas las carieyras et fezes far .I. bel
sermo, e fouc fach en la forma e manieyra que si ensec (…). |
Et comme sur notre feuillet des
annales toulousaines, mais de manière plus naïve et symbolique, le scribe a
dessiné au-dessous une représentation de ville fortifiée, accompagnée de
cette légende : « La cieutat de Bordeus l’an presen coma dessus es
declarat ». Nous pouvons donc maintenant avancer avec certitude que le
dessin illustrant le feuillet du premier Livre des histoires de Toulouse de
l’année 1452-1453 correspondait bien à la reddition de Bordeaux à
l’automne 1453.
François BORDES
Notes
1. François
Bordes, « Le feuillet des Annales manuscrites de Toulouse dit de
1447 : nouvelle datation, nouvelle interprétation », dans M.S.A.M.F.,
t. LXVI, 2006, p. 270-273.
2. A.M. Millau, CC 425, 1er
inv., fol. 23; je tiens ici à remercier mon collègue Jacques Frayssenge de
m’avoir fourni un cliché de ce document et de m’avoir autorisé à le
reproduire.
La Présidente
remercie François Bordes de nous avoir fait participer à ces recherches en
cours, et elle ne doute pas que cette découverte dans les comptes de Millau
n’emporte la conviction des sceptiques quant à l’identification de Bordeaux
sur l’enluminure du feuillet de 1453 des Annales de Toulouse.
Après avoir
rappelé qu’il était d’accord avec l’hypothèse de Bordeaux, Patrice
Cabau souligne l’intérêt de la découverte d’un nouveau manuscrit de texte
d’Étienne de Gan. François Bordes dit son intention d’éditer la chronique
dans son entier à l’occasion du colloque international sur la fondation des
villes qui se tiendra à Pau l’année prochaine. Il faudra établir les
erreurs paléographiques de cette copie et confronter les variantes de trois
autres manuscrits ayant utilisé cette source. Il serait bien sûr intéressant
de savoir à quel moment le parchemin a été utilisé dans une reliure et pour
quel registre, peut-être à partir de la liste de noms inscrite en marge d’un
feuillet. Répondant à Jean Le Pottier, François Bordes dit qu’il n’a pas
eu le temps, pour cette communication improvisée, de consulter les registres
d’entrée des archives départementales.
La parole
est à Jeanne Bayle pour une communication sur Bertrand Trille, maître
menuisier toulousain dans la seconde moitié du XVIIIe siècle
:
Bertrand
Trille est le seul menuisier toulousain dont subsistent encore quelques
meubles exactement documentés.
Fils
de François Trille, travailleur, et d’Élisabeth Fanjeau, il est né à
Plagnolle vers 1723 (1). Il a un frère plus âgé qui a quitté le pays et
une sœur, Anne, qui, après la mort de son père, vient s’installer à
Toulouse et s’y marie. L’héritage paternel est très peu important
puisqu’il ne s’élève qu’à 600 livres (2).
On
ignore où Bertrand a fait son apprentissage de menuisier, peut-être à
Plagnolle même, peut-être à Laymont, où un de ses cousins exercera plus
tard ce métier (3). Devenu compagnon, il a sans doute fait son tour de France
comme tous les autres artisans et est revenu à Toulouse terminer sa formation
et devenir maître menuisier en 1748.
Il
épouse à 27 ans, le 21 avril 1750, Bernarde Mouis, âgée de 22 ans, fille
d’un maître charpentier de la rue des Bœufs. Son beau-père, Jean Mouis,
devenu entrepreneur de travaux publics, travaillera à la réalisation de la
façade du Capitole en 1758 (4). Bernarde Mouis apporte une dot relativement
importante de 800 livres, dont 300 livres comptant et le reste à placer en
biens fonds dans les cinq ans (5). Cette disposition sera à l’origine de la
fortune de Bertrand Trille.
Trille
vivra toujours dans le même quartier, celui qui regroupe bon nombre
d’artisans du bois, charpentiers, menuisiers, tourneurs sur bois et
sculpteurs, entre la place Saint-Georges et le rempart Saint-Étienne. Il est
domicilié d’abord rue des Bœufs, puis rue des Pénitents noirs, enfin
place des Pénitents noirs ; mais il reviendra rue des Bœufs à la fin
de sa vie. Depuis la destruction du quartier et l’aménagement de la place
Occitane en 1972, on ne peut localiser ces immeubles que grâce au cadastre de
1680, d’autant que les rues avaient des noms très voisins et d’ailleurs
variables dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle. De la rue
des Bœufs (rue des Biaux) subsiste l’extrémité méridionale, actuelle rue
Paul-Vidal vers la place Saint-Georges ; la maison de Bertrand était sur
le côté oriental de la rue. La place des Pénitents noirs est dite aussi
place des Augustines, dont la chapelle était devenue celle de ces pénitents ;
c’est la place Lucas après 1842 et la maison de Trille y était située au
numéro 8. De la rue des Pénitents noirs, appelée aussi « des
Augustines », « des Unheires » (Oigneurs), « de
Saint-Loup », « du Loup », il reste l’extrémité
occidentale qui porte maintenant le nom de Saint-Jérôme ; la maison de
Trille était sur le côté méridional de la rue, non loin du coin de la
Rispe (6).
Sa
femme Bernarde Mouis paraît avoir eu la langue bien pendue et l’injure
facile car elle est par deux fois l’objet de plaintes devant le sénéchal.
Mais elle a reçu une certaine éducation, elle signe en effet son acte de
mariage et inscrit sur de nombreux actes son nom entier sous la forme « Bernarde
Mouis dite Trille », et elle sait écrire éventuellement quelques mots.
Son mari, qui ne sait pas signer en 1748, a appris à écrire ou du moins à
signer l’année suivante et inscrit son nom et son prénom en lettres
maladroitement formées sur son contrat de mariage. Par la suite il signe
seulement de son nom en lettres très anguleuses comme le sont celles de sa
femme et de sa sœur. Ont-ils appris tous trois chez le même maître d’écriture ?
(7).
Bertrand
Trille meurt sans enfant le 30 juin 1788 et est enterré dans le cimetière de
la paroisse Saint-Étienne. Il avait dicté un premier testament dans sa
maison de campagne, puis revenu en ville, il en fait rédiger un second dix
jours plus tard (8). Il désire se faire inhumer dans le cimetière de la
paroisse où il décèdera mais demande que soit dite chaque année une messe
basse dans l’église des religieux augustins de la place Saint-Georges. Les
legs charitables, quasi obligatoires, sont distribués au bouillon des pauvres
de Saint-Étienne, sa paroisse (1000 livres), et aux orphelines de la ville
(2000 livres) ; s’y ajoutent 1000 livres à la confrérie des pénitents
blancs dont il fait partie. Viennent ensuite les legs aux membres de sa
famille ou à celle de sa femme : à son cousin Fanjeau père, menuisier
à Laymont, 2000 livres, à sa cousine Françoise Trille, épouse de Laurent
Arnès, porte-chaise du vicomte de Bruniquel, à sa parente Anne, veuve de
Charlas, aux nièces de sa femme Angélique, et Anne fille de Benoît Mouis,
1000 livres chacune, enfin à son filleul Bertrand Pigny, sculpteur, 900
livres comme aux deux compagnons menuisiers qui travaillent chez lui, 300
livres à un compagnon sculpteur qu’il emploie et autant à un ancien
compagnon menuisier. Le plus important des legs, 9000 livres, va toutefois au
corps des menuisiers. L’ensemble des legs s’élève à 23000 livres, mais
les propriétés foncières ne sont ni citées, ni estimées dans le
testament. Sa femme est l’héritière universelle et elle acquittera
rapidement les legs, continuant à gérer le patrimoine avec compétence.
Les
spéculations foncières, les prêts d’argent et surtout la vie du corps des
menuisiers sont les principales activités connues de Bertrand Trille, car il
est presque impossible de savoir quelle a été réellement son activité
professionnelle.
Trille
effectue sa première opération immobilière pour se conformer aux clauses de
son contrat de mariage. Il achète fin 1753 trois arpents de terre et vigne à
Croix-Daurade pour 700 livres ; mais ce n’est pas une bonne affaire car
il revend le tout en 1759 pour 490 livres seulement (9).
Mais
en même temps, n’hésitant pas à emprunter, il s’intéresse aux
immeubles locatifs urbains. Il achète ainsi en 1756 une maison à deux corps
de bâtiments rue des Bœufs pour 1700 livres et la fait reconstruire ou
agrandir en 1758 (10).
Avant
d’avoir achevé de la payer, il se rend acquéreur en 1758 de la maison plus
ou moins en ruines dans laquelle il habite alors, place des Pénitents noirs.
Il la fait également reconstruire après s’être entendu avec le sculpteur
Dominique Loubeau à propos d’un mur mitoyen ; puis il la loue en 1762.
C’est cette maison que signale Chalande place Lucas, où figuraient un
compas et une équerre au-dessus de la porte d’entrée (11).
Sur
la place des Pénitents noirs, Trille achète plus tard, en 1776 et 1777, deux
autres maisons qui n’en faisaient qu’une à l’origine, contiguës à la
précédente puisqu’elles ont un puits commun, pour 7650 livres. Ces deux
maisons locatives seront revendues par sa veuve en 1788 et 1789, l’une au
marbrier Jean-Baptiste Charlionnais, futur époux de sa nièce Anne Mouis,
l’autre à un maître charpentier (12).
Entre
temps et changeant de quartier, Trille profite des difficultés financières
de la famille de l’avocat Brun de Rostaing. L’affaire lui a peut-être été
signalée par un membre de cette famille, chanoine de Saint-Étienne, qui
habite au coin de la Rispe, tout près de la place des Pénitents noirs. Il
acquiert donc en 1765 une maison à étages rue Pharaon pour 6500 livres
seulement, mais se charge de payer une partie des dettes du défunt. Pour ce
faire il a emprunté 1200 livres à un maître cordonnier de la place
Saint-Georges, qui a été remboursé en moins d’un an (13).
L’ascension
sociale et l’enrichissement même modeste ne se conçoivent pas au XVIIIe
siècle sans la possession d’une maison de campagne. Trille n’échappe pas
à la tradition. Il achète ainsi en 1769 une maison importante dite le
Castelet, hors de la porte Matabiau au-delà du canal, qui appartenait à
l’avocat Guillaume Thomas, seigneur de Cornebarrieu, et comportait une métairie
de 20 arpents, des étables et dépendances, un jardin redevenu terre
labourable ainsi que des droits divers près du canal, le tout pour la
coquette somme de 10500 livres. Il aménage le domaine en reconstruisant le
puits à roue, en reconstituant le jardin potager, en plantant des mûriers,
dont il se réserve expressément les feuilles. Il y installe des métayers
qui changent fréquemment et contre qui il n’hésite pas à plaider s’ils
négligent de le payer régulièrement. Toutes ces terres sont pratiquement
partagées entre deux fermiers qui doivent s’entendre pour l’usage de
l’eau du puits à bascule et celle du puits à roue. Il agrandit sa propriété
en achetant en 1781 la maison avec jardin de Dupuy d’Almairac. Situées dans
une zone maraîchère, ces terres contribuent à l’approvisionnement de
Trille en lui fournissant de l’ail, des oignons et des échalotes ;
certaines pièces sont cultivées en asperges, d’autres en sainfoin et
d’autres naturellement en froment (14).
Enfin
c’est Bertrand Trille qui représente son beau-frère Laurent Mouis,
chapelier à Londres, pour l’achat et la gestion de la métairie de
Terre-Cabade en 1783, métairie qu’il finit par lui acheter deux ans plus
tard pour 3000 livres (15).
Bertrand
Trille ne se contente pas de spéculer sur les immeubles et d’encaisser des
loyers, il prête de l’argent parfois au denier vingt, taux légal, parfois
avec des intérêts non spécifiés et donc intégrés dans la somme à
rembourser, pouvant être alors à un taux usuraire. Il prête ainsi à divers
membres de sa belle-famille, en particulier à son beau-père pour la
formation de trois de ses fils. Jean Mouis, de charpentier devenu entrepreneur
de travaux publics, manque peut-être alors de liquidités financières. Benoît,
l’aîné de ses fils, devient maître boulanger en 1764, d’où frais de maîtrise ;
Bernard est mis en apprentissage chez le maître tapissier Louis Fraiche de
1764 à 1767 ; quant à Laurent, il avait été mis en apprentissage chez
un maître menuisier de 1758 à 1761 (16). Malgré son attachement à sa
famille, Trille est amené à plaider contre Benoît pour le remboursement de
prêts (l7). Trille prête aussi aux jardiniers qu’il connaît hors de la
porte Matabiau et même à un travailleur de son village natal, qui, incapable
de le rembourser, doit lui vendre un bois (18).
Bertrand
Trille consent également des prêts dans son milieu professionnel, au corps
des maîtres tourneurs 2000 livres en 1774, à celui des menuisiers 250 livres
en 1775, ou même à des maîtres menuisiers comme Pierre Fiatre dit Bosseron
en 1765 ou Martin Fringand en 1771, ainsi qu’à un simple compagnon comme
Bertrand Brunet en 1787 (19).
En
dehors de l’argent, la grande affaire de la vie de Bertrand Trille c’est
le corps des menuisiers. Il en fait partie depuis 1748, date où il est devenu
maître menuisier après avoir exécuté comme chef-d’œuvre un banc à
dossier et coffre sous le siège pour la table des menuisiers dans la chapelle
Sainte-Anne de l’église des Carmes, siège de la confrérie (20). Quelques
années plus tard, en 1751, il est choisi comme quatrième baile, chargé des
services les plus matériels. Il sera baile à plusieurs reprises (1764, 1766,
1769, 1772, 1773, 1776), puis, après la réorganisation des corporations,
garde-juré en 1781, 1782, 1783, 1786 et 1787. Quand il n’occupe pas ces
fonctions, il participe cependant à la direction du corps en étant fréquemment
l’un des maîtres qui parrainent les aspirants à la maîtrise ou qui
examinent les chefs-d’œuvre des compagnons. Il a été aussi adjoint des
bailes dans certaines circonstances, commissaire ou auditeur des comptes. À
ce titre il connaît bien la situation désastreuse du corps des menuisiers,
entraînée par des procès à répétition, et il y remédie par son
testament en lui léguant l’importante somme de 9000 livres destinée spécialement
éteindre les dettes. Il ne demande en retour que deux grandes messes à célébrer
dans l’année de son décès, ce qui le fait qualifier de « notre
bienfaiteur » dans les délibérations des menuisiers (21).
Malgré
son attachement au corps des menuisiers, il n’en respecte pas toujours les
statuts et s’approvisionne parfois en bois en dehors de la répartition
faite par les bailes, aussi est-il l’objet de poursuites en 1757 et 1787
(22).
Trille
emploie dans sa boutique des apprentis à qui il enseigne le métier et des
compagnons qui s’y améliorent. Au cours de ses quarante années d’activité
professionnelle, il a eu au moins huit apprentis dont on connaît les noms,
engagés par contrat notarié pour une durée de 2 à 4 ans. Parmi eux figure
en 1766 un mulâtre de la Guadeloupe Pierre dit Hipolite, présenté par
Timothée Guérin, sans doute son maître. En 1759 quatre apprentis
travaillent en même temps chez lui, ce qui n’est pas autorisé par les
statuts du métier, il est donc condamné à une amende (23).
On
ignore le nom des compagnons qu’il a employés à l’exception de ceux
qu’il cite dans son testament, Bernard Brunet et Jérôme Dupuy dit Carsy,
Montesquieu, son ancien compagnon, et Parachou, le garçon sculpteur (24).
Si
l’on a une idée de l’importance de son atelier, on sait par contre très
peu de choses sur son activité professionnelle. Comme tous les menuisiers,
Trille n’est pas spécialisé en meubles et exécute aussi des portes, des
fenêtres, des lambris ou des chambranles de cheminée. Il a travaillé pour
le président Caulet en 1756 et la facture s’élève à plus de 100 livres,
mais on ignore à quoi elle correspond (25). Les augustins de la place
Saint-Georges se sont adressés à lui pour refaire et réparer des fenêtres
en 1763. Mais des malfaçons ont été constatées par le syndic du couvent
qui a porté plainte. Le chantier était important puisque Trille, par
transaction, abandonne les 250 livres qui lui sont dues et paie en outre les
frais du procès, soit 73 livres (26). L’année suivante, en 1764, il
travaille à la chapelle Notre-Dame érigée contre l’église des pénitents
blancs. Il exécute pour la sacristie « une armoire avec son avant-corps
et un banc à façon d’armoire » et deux portes, le tout pour 62
livres (27).
Enfin,
en 1779, il réalise pour les capitouls 36 chaises en cabriolet pour remplacer
les bancs du Petit consistoire. Elles lui sont payées 216 livres, soit 6
livres pièce, alors que le tapissier Debru reçoit 598 livres pour les
recouvrir d’une moquette assortie à la portière, soit 16 livres chacune.
À cette date les dépenses de la ville sont sous le contrôle de
l’intendant. Aussi les capitouls ont-ils pris une décision d’achat
qu’ils ont communiquée à Montpellier demandant à l’intendant
d’autoriser la dépense. Ces chaises sont destinées à remplacer les bancs
inconfortables alignés contre le mur (28). Mais ce que les capitouls ne
disent pas, c’est qu’aux bancs restés en place ont été ajoutées, en
1729, 24 chaises à la dauphine, payées au menuisier Boune 4 livres 10 sols
pièce et au tapissier Jullien 5 livres 13 sols chacune. On ne précise pas si
elles sont couvertes de tissu ou de maroquin noir comme les deux fauteuils
refaits la même année (29). Certaines de ces chaises existent encore. Jules
Chalande est le premier à les signaler en 1920 et Robert Mesuret en avait
retrouvé trois au musée Saint-Raymond, quelques-unes à la Salle des
Illustres et aux Archives municipales et une dans la collection d’Ernest
Giscaro (30). À l’exception des trois premières, j’ignore actuellement
ce qu’elles sont devenues.
Les
trois chaises du musée Saint-Raymond ne figurent pas sur le catalogue de ce
musée de 1934, mais elles sont enregistrées dans 1’inventaire de 1947 :
elles proviennent du tribunal de police installé dans l’Hôtel-de-ville et
ont été remises au musée Paul-Dupuy en 1961 (31). Deux de ces chaises sont
dans les réserves du musée mais la troisième n’a pas encore été retrouvée.
Les deux chaises conservées sont en mauvais état ; elles étaient
couvertes vers 1960 de basane fauve, remplacée par du skaï marron et brun,
preuve de leur utilisation dans les bureaux il y a peu d’années.

Musée Paul-Dupuy,
une des chaises, ensemble. Cliché
D. Molinier. |

Musée Paul-Dupuy,
une des chaises, détail : marque à la croix pommetée au revers du dossier. Cliché
D. Molinier. |
Les
deux chaises du musée Paul Dupuy mesurent 0,98 m de hauteur et 0,47 m sur
0,58 m pour le siège. Au revers du dossier, sur la traverse horizontale,
elles sont marquées au fer d’une croix pommetée, signe de propriété de
la Ville de Toulouse. Le dossier est légèrement penché en arrière et suit
la forme du siège, comme dans tous les fauteuils ou chaises dits « en
cabriolet ». Les pieds sont très peu galbés. La ceinture du siège est
à peine chantournée. Une moulure peu marquée souligne le tour du dossier et
le devant de la chaise. C’est donc un siège très sobre qu’ont fait faire
les capitouls. Est-ce par goût de la simplicité ou pour suivre la mode ?
Cette austérité est-elle due au faible coût du siège, dont la confection a
été attribuée au moins-disant ?
Enfin,
pour ne rien oublier, je signalerai que Bertrand Trille a peut-être été
aussi marchand de meubles ou intermédiaire entre clients toulousains et
fabricants parisiens. Il se préoccupe en effet en 1775 du retard d’un
voiturier envoyé à Paris et ses correspondants, des maîtres menuisiers
toulousains, l’assurent qu’ils vont s’occuper d’expédier la
marchandise au plus tôt, mais dans une lettre qui ne lui est pas directement
adressée (32). C’est assurément un indice bien ténu de cette activité,
qui reste donc une simple hypothèse.
Telle
est la vie de Bertrand Trille, homme certainement intelligent et actif, aimant
l’argent et ayant su s’enrichir, assez procédurier comme tous ses
contemporains, et, par ailleurs, très attaché au corps des menuisiers. Mais
c’est surtout le seul artisan toulousain dont il subsiste une œuvre
exactement documentée, les chaises du Petit Consistoire (33).
Jeanne BAYLE
Notes
1. Haute-Garonne, arrondissement de Muret, canton de Rieumes.
2. A.D. Haute-Garonne, 3E 10960-II-237. 3E
10843, 702 : Anne Trille épouse le 27 décembre 1757 Jean Henriet, né
à Sedan, et quitte vraisemblablement Toulouse avec son mari car il n’est
pas question d’elle, ni de ses enfants éventuels dans le testament de
Bertrand Trille.
3.
A.D. Haute-Garonne 3E 10874-I-144 et 154. Laymont : Gers, arrondissement
et canton de Lombez.
4.
A.M. Toulouse, CC 2237, p. 62.
5.
A.M. Toulouse, GG 327, 21 avril 1750. A.D. Haute-Garonne, 3E 14147-I-54,
contrat de mariage du 30 mars 1750. La mère de Trille est morte et son père
l’émancipe à cette occasion.
6.
A.M. Toulouse, CC 99, 11e moulon, n° 7 ; CC 100, 13e
moulon, n° 10 et 16e moulon, n° 15 et 16.
7.
A.D. Haute-Garonne, 3E 10847, 455, 28 septembre 1761 et 3E 10860-II-291, 1er
août 1774. Voir de nombreuses signatures dans les registres de maître Arnaud ;
A.D. Haute-Garonne, 3E 10869 et suivants.
8.
A.M. Toulouse, GG 365, 30 juin 1788 ; A.D. Haute-Garonne, 3E 10874-I-144
et 154.
9. A.D. Haute-Garonne, 3E 10960-II-237 et 3E 10845,
429.
10. A.M. Toulouse, CC 99, 11e moulon, n° 7 ;
A.D. Haute-Garonne, 3E 10842, 59 ; 3E 10843, 3 ; 3E 10844, 146, 155 et
269 ; 3E 10845, 120 et 233 ; 3E 10846, 169 ; 3E 10847, 177 ; 3E
10848, 374 ; 3E 10849, 538 et 756.
11.
A.M. Toulouse, CC 100, 13e moulon, n° 10 ; A.D. Haute-Garonne, 3E
5056-I-158 ; 3E 10846, 539 ; 3E 10848, 315 et 218. Jules CHALANDE, Histoire
des rues de Toulouse, reprint Marseille, Laffitte, 1982, 3e
partie, p. 51, n° 8 Place Lucas, avec la date erronée de 1752.
12.
A.M. Toulouse, CC 100, 16e moulon, numéros 15 et 16 ; A.D.
Haute-Garonne, 3E 10862-II-419 ; 3E 10863-I-112 et 264 ; 3E
10865-II-256 ; 3E 10874-II-226 et 321 ; 3E 10875-II-43 ; 3E
10875-I-321 (mariage d’Anne Mouis).
13.
A.M. Toulouse, CC 76, 3e moulon, n° 9 ; A.D. Haute-Garonne,
3E 10851, 617, 618 et 645 ; 3E 10852, 288, 549, 619 et 703.
14.
A.D. Haute-Garonne, 3E 10855-I-76 et 10855-II-68 et 74 ; 3E 10856-II-125
et 173 ; 3E 10857-II-157 ; 3E 10858-II-462 ; 3E 10859-II-2l7 ;
3E 10860-II-113 ; 3E 10862-II-23 ; 3E l0864-I-110 et 306 ; 3E
10865-I-179, 254 et 369 ; 3E 10866-II-484 ; 3E
10867-II-419 ; 3E 10868-I-389 et 10868-II-390 ; 3E 10870-I-198 et
10870-II-287 ; 3E 10871-I-36 et 58 (construction du puits à roue) et
10871-II-8 ; 3E 10875-I-105 et 10875-II-105.
15. A.D. Haute-Garonne, 3E 10869-II-205 ; 3E
10871-II-180 ; 3E 10873-II-123.
16. A.D. Haute-Garonne, 3E 10847, 509 et 3E 10853,
651 (Laurent) ; 3E 10850, 327 et 428 E 10853, et 3651 (Bernard) ; 3E
10851, 327 et 3E 10852, 623 (Benoît).
17. A.D. Haute-Garonne, 3E 10856-II-224 et 347.
18. A.D. Haute-Garonne, 3E 10857-II-1 ; 3E
10858-II-291 ; 3E 10859-II-388. Bisterne de Plagnolle : 3E
10866-I-371 et 3E 10872-I-323.
19. A.D. Haute-Garonne, 3E 10851, 459 (Fiatre) ;
3E 10857-I-125 et 3E 10860-I-100 (Fringand) ; 3E 10873-II-321 (Brunet).
20.
A.M. Toulouse, HH 92, f° 1 ; A.D. Haute-Garonne, 3E 3413, 28 mai 1748.
En 1772 il achète pour 36 livres au corps des menuisiers deux prie-dieu,
chefs-d’œuvre de compagnons aspirant à la maîtrise (1E 1727, 1772-1773).
21.
A.D. Haute-Garonne, 3E 10874-I-144 et 154 ; 1E 1323, 8 juillet et 28
octobre 1788.
22.
A.M. Toulouse, FF 605, 22 août 1757 ; A.D. Haute-Garonne, 1E 1323, 13 décembre
1787.
23. A.D. Haute-Garonne, 3E 10839, 143 ; 3E 10843,
387 et 704 ; 3E 10845, 264 et 377 ; 3E 10849, 84 ; 3E 10852, 580
(Pierre dit Hipolite) 3E 10857-I-321 ; 1E 1757, 1760-1761.
24.
A.D. Haute-Garonne, 3E 10874-I-144 et 154.
25. A.D. Haute-Garonne, 3E 10840, 112.
26. A.D. Haute-Garonne, 3E 10849, 128.
27. A.D. Haute-Garonne, 1E 927, n° 123. La
chapelle des pénitents blancs était à l’extrémité orientale de la rue
des Pénitents noirs.
28.
A.M. Toulouse, BB 59, f° 51 et 53 v° CC 2262, p. 50 ; CC 2812, p. 119 ;
DD 296, p. 315 et 317. La moquette est un tissu à trame et chaîne de lin,
velouté de laine.
29.
A.M. Toulouse, BB 2748, f° 217. Les
deux sofas du Petit Consistoire sont regarnis l’année suivante : cf.
A.M. Toulouse, CC 2199, f° 49.
30.
Jules CHALANDE, « Histoire monumentale de l’hôtel de ville »,
dans Revue historique de Toulouse, 1920, p. 122 ; « Catalogue
du musée Saint-Raymond », dans Bulletin municipal, 1934 et 1935.
31.
Inventaire du musée Saint-Raymond d’après la photocopie conservée au musée
Paul-Dupuy. Fiches de Robert Mesuret au musée Paul-Dupuy. Les renseignements
de Mesuret ont été repris sans indication d’origine dans le fichier des
objets mobiliers du musée Paul-Dupuy dû à Mme Guillevic. Ces
chaises, considérées comme des objets d’usage et non comme des œuvres
d’intérêt esthétique ou historique, ont été utilisées dans les bureaux ;
une fois abîmées, elles ont été jetées. Ainsi s’explique qu’il n’en
existe aucune ni aux Archives municipales, ni à la bibliothèque municipale
de la rue de Périgord. J’en ai retrouvé deux très récemment, le 29 janvier
2008, dans le bureau de Mme Dounot-Sobraquès à l’Hôtel-de-Ville.
32. A.D. Haute-Garonne, 1E 1324, n° 113.
33.
À la suite de cette communication, le musée Paul-Dupuy a récupéré, le 20
mars 2008, les deux chaises Trille du bureau de Mme Dounot-Sobraquès,
l’une d’elles étant la troisième chaise déposée par le musée
Saint-Raymond en 1961 et non retrouvée dans les réserves, l’autre
provenant sans doute de la salle des Illustres.
La Présidente
remercie Jeanne Bayle pour cette brillante reconstitution de tout un pan de vie
Toulouse au XVIIIe siècle, et en particulier du quartier
Saint-Georges. C’est également la découverte de ces chaises de Bertrand
Treille qui mérite toutes nos félicitations.
Guy Ahlsell
de Toulza fait remarquer que ces chaises sont fort peu à la mode pour avoir été
fabriquées en 1779. Jeanne Bayle en convient tout en faisant à son tour
remarquer qu’elles ne peuvent être de 1734 : le moindre prix en est
peut-être l’explication. On peut également supposer que leur dessin était
mieux adapté au reste du mobilier.
Guy Ahlsell
de Toulza dit qu’il serait intéressant de récupérer les deux chaises qui se
trouvent encore dans le bureau d'un maire-adjoint. Jeanne Bayle refait
l’historique des déplacements de certaines de ces chaises, de l’Hôtel-de-Ville
au Musée Saint-Raymond de 1946 en passant par l’Hôtel de police. Daniel
Cazes précise que ce que l’on appelle l’inventaire de 1946 est en fait le récolement
réalisé par Paul Mesplé avant la nouvelle répartition des œuvres entre les
différents musées de Toulouse. Quant à la collection de E. Giscard dans
laquelle se serait trouvée une chaise, il pense qu’il s’agit plus
probablement de la collection de E. Giscaro, qui était l’ancien conservateur
du musée du Vieux-Toulouse. François Bordes souligne que l’on est sans doute
loin d’avoir fait le tour de tous les locaux de la Ville de Toulouse où
pourrait se trouver du mobilier ancien ; Daniel Cazes rappelle qu’il y a
eu cependant depuis les années 1980 une volonté municipale de faire procéder
au récolement de tous les dépôts d’œuvres appartenant aux musées de la
Ville de Toulouse dans tous les bâtiments publics.
Louis
Peyrusse voudrait revenir sur des points de l’histoire sociale. Il lui semble,
en se remémorant la thèse de Jean Sentou, que la fortune de 23000 livres, à
laquelle s’ajoutent des terres et des maisons, qui est celle de Bertrand
Trille est tout à fait exceptionnelle pour un artisan de la seconde moitié du
XVIIIe siècle. Le prix des chaises semblent bien indiquer qu’il ne
la tient pas de son activité de menuisier : n’est-elle pas due plutôt
à une activité parallèle de banquier et de marchand de biens ? Jeanne
Bayle confirme qu’il prête de l’argent à des taux usuraires, et précise
qu’il doit aussi une part de sa fortune à son beau-père, entrepreneur de
travaux publics.
Bernadette
Suau l’ayant interrogée sur les registres de la confrérie des pénitents
blancs, Jeanne Bayle indique qu’elle n’y a pas trouvé B. Trille, et que
d’ailleurs les pénitents blancs n’apparaissent que dans son testament.
Guy Ahlsell
de Toulza voudrait savoir s’il existe des études sur le mobilier toulousain.
Jeanne Bayle cite le nom de Hache pour le XVIIe siècle, et ajoute que des ébénistes
sont connus à Toulouse jusque vers 1720. C’est ensuite le vide jusqu’en
1750, où l’on a affaire à des ébénistes venus d’Allemagne ou de pays
voisins. Jeanne Bayle dit avoir en cours une grosse recherche sur le mobilier
toulousain du XVIIIe siècle, qui la conduira à nous parler des métiers,
ou encore à nous décrire ce qui existait alors. Mais il lui sera quasiment
impossible de nous montrer du mobilier toulousain, excepté les quatre chaises
et peut-être le médailler de Paul-Dupuy. La prudence est en effet requise
alors que les meubles fabriqués à Toulouse ne sont pas estampillés, la réglementation
de Louis XV étant strictement parisienne. Sans marque ni style particulier, il
est bien difficile d’identifier les productions toulousaines. Bernadette Suau
note encore que les baux à besogne pour le mobilier deviennent rares à cette
époque, la pratique allant plutôt vers des conventions sous seing privé.
Au titre des
questions diverses, Daniel Cazes rapporte avoir été informé par M. Jean-René
Gaborit, ancien conservateur au Louvre, de la vente à New-York d’un ensemble
lapidaire réputé provenir du Sud-ouest. L’information a également été
reprise par La Dépêche du Midi, qui donne des photographies. Le lot mis
en vente comprend quatre piliers de cloître du XIVe siècle, avec
bases et chapiteaux, ainsi que quatre couples de colonnes avec des bases et des
chapiteaux plus ou moins assortis, et un chapiteau isolé. En y regardant à
deux fois, on se rend compte que l’ensemble n’est donc pas si homogène que
ça. L’un des chapiteaux porte des armoiries avec, pour partie, les ocelles
des comtes de Comminges, et Daniel Cazes s’est souvenu l’avoir vu dans les
collections de photographies de notre Société, sur un positif de projection au
monogramme de Lahondès, avec pour légende : « chapiteau maison
Lieux ».
Guy Ahlsell
de Toulza indique que notre confrère Jacques Lapart nous a aussi signalé la
vente de ces pièces. Jean Le Pottier confirme que l’histoire a été au départ
mal orientée, et que la piste de Saraman, qui a été un temps proposée, était
une mauvaise piste. La maison Lieux se trouvait à Saint-Gaudens ou à
Saint-Martory et nos collègues de la Société des Études du Comminges y
verraient des pièces provenant de Bonnefont. Ayant reconnu les mortiers des
Montaut dans les armoiries reproduites sur un chapiteau, Patrice Cabau pense
qu’il ne fait pas de doute qu’il s’agissait d’un édifice située dans
la vallée de la Garonne.
Jean Le
Pottier conclut en indiquant que l’ensemble a été acquis par un milliardaire
américain, et que ces sculptures resteront donc aux États-Unis.
SÉANCE DU 4
MARS 2008
Présents : Mme
Pradalier-Schlumberger, Présidente, MM. Cazes, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier,
Cabau, Secrétaire-adjoint, Latour, Bibliothécaire-adjoint ; Mmes Bayle,
Napoléone, MM. Boudartchouk, Garland, Gilles, Roquebert, membres titulaires ;
Mmes Barber, de Barrau, Fronton-Wessel, Haruna-Czaplicki, Krispin, MM. Balagna,
Capus, Le Pottier, Mattalia, Pousthomis, Surmonne, membres correspondants.
Excusés : Mme Suau,
Bibliothécaire-Archiviste, M. Scellès, Secrétaire général, Mme Cazes.
La Présidente
ouvre la séance à 17 heures et fait part de la correspondance reçue par la
Société.
Puis elle
lit les rapports sur le concours de 2008 rédigés par Maurice Scellès
(candidature d’Éric Hold) et Michel Barbaza (candidature de Benjamin
Marquebielle). (Le mémoire de Mlle Nadia Cavanhie a été écarté car jugé trop éloigné des préoccupations de notre Société.) Elle
demande ensuite des compléments d’information à Daniel Cazes, qui les
fournit, sur le travail d’Éric Hold. Elle donne la parole à Jean-Luc
Boudartchouk qui lit son rapport sur la candidature d’Alexis Corrochano.
Enfin, Michèle Pradalier-Schlumberger lit son rapport sur le travail de
recherche d’Anaïs Charrier. Après un appel à avis et discussion sur tous
ces rapports, la Présidente suggère de décerner le prix Ourgaud à Anaïs
Charrier et le prix de Champreux à Alexis Corrochano, Guy Ahlsell de Toulza
proposant en outre une médaille d’argent pour Benjamin Marquebielle. Une
discussion s’engage alors sur le montant des deux prix et il est décidé,
pour cette année, de les porter tous les deux à la somme de 400 euros.
Jean-Luc Boudartchouk est enfin désigné comme rapporteur général du concours
pour la séance publique du 15 mars.
La Présidente
donne ensuite la parole à Christophe Balagna pour la communication inscrite à
l’ordre du jour : Les éléments lapidaires de l’ancien cloître
de Maubourguet (Hautes-Pyrénées) :
Au
nord de Tarbes, dans la plaine bigourdane, la petite ville de Maubourguet
abrite une remarquable église romane dédiée à la Vierge, à l’origine à
saint Martin, construite sur un site occupé depuis l’Antiquité. En
1983-1984, l’église a fait l’objet d’une minutieuse campagne de
fouilles archéologiques qui a permis de mieux comprendre l’histoire et l’évolution
des monuments qui se sont succédé sur cet emplacement depuis l’époque paléochrétienne
(1). Quelques années plus tôt, en 1978, le retour dans la commune de pièces
lapidaires essentiellement des bases, colonnettes et chapiteaux de marbre
avait conduit les chercheurs à les attribuer à l’ancien cloître roman de
la communauté bénédictine. Aujourd’hui, une étude précise des pièces
conservées renouvelle les hypothèses anciennes et met en lumière
l’influence structurelle et décorative des salles capitulaires
cisterciennes du Midi de la France.
Une
histoire mal connue
L’église
paroissiale actuelle est le seul vestige du prieuré bénédictin Saint-Martin
de Celle fondé au milieu du XIe siècle par des moines venus
d’Alet (Aude), dont il fut une dépendance jusqu’à la Révolution. Dom
Estiennot, dans le tome second des Antiquités
bénédictines de Gascogne (2), rédigé en 1680, relate que cette
fondation s’est faite sous les auspices d’Héraclius, évêque de Tarbes
(1035-1064) et de Bernard, comte de Bigorre. Le prieuré bigourdan est encore
cité comme une possession d’Alet à deux reprises, en 1119 et en 1668. Cet
établissement religieux devint bientôt le centre d’un bourg qui donna
naissance à la ville de Maubourguet au XIIe siècle.
À
partir du XIVe siècle, le prieuré est confronté à de nombreuses
vicissitudes : durant la guerre de Cent Ans, les bâtiments furent occupés
par les anglais qui y construisirent tours et remparts pour se protéger. Si,
au XVe siècle quelques moines étaient encore présents, ceux-ci
subirent, au siècle suivant, la sécularisation de leur établissement, l’église
devint paroissiale. Enfin, en octobre 1569, l’église et les bâtiments des
religieux furent dévastés par les protestants (3). À la fin du XVIIe
siècle, un presbytère pour les prêtres de la paroisse fut reconstruit dans
les bâtiments détruits. Quant à l’église, délaissée durant la Révolution,
elle fut progressivement restaurée aux XIXe et XXe siècles
(4).

MAUBOURGUET, fonds
lapidaire, une partie des éléments conservés. Cliché C. Balagna. |

MAUBOURGUET, fonds
lapidaire, une base double. Cliché C. Balagna. |

MAUBOURGUET, fonds
lapidaire, un chapiteau double. Cliché C. Balagna. |

COLLECTION PRIVÉE, un des
deux chapiteaux simples provenant du prieuré de Maubourguet. Cliché
C. Balagna. |

FLARAN, ancienne
abbatiale, portail nord, chapiteau de gauche. Cliché C. Balagna. |

FLARAN, ancienne abbaye,
la façade principale de la salle capitulaire. Cliché C. Balagna. |
Avant
le prieuré roman
Divers
éléments ont conduit à l’hypothèse d’un édifice déjà existant au
moment de l’arrivée des moines d’Alet au XIe siècle : le
toponyme Celle, le vocable de saint
Martin et surtout la présence de nombreux remplois antiques, colonnes de
marbre, bases moulurées, fragments d’architecture et de sculpture, ainsi
que quelques pièces, moins nombreuses, datant probablement de l’époque
carolingienne, principalement des chapiteaux et des colonnes de marbre et des
bases en calcaire (5).
Les
fouilles menées sur place entre 1983 et 1985 ont, à la fois, confirmé ces
hypothèses et permis également de préciser un certain nombre de faits :
le site de Saint-Martin de Celle a bel et bien été romanisé, probablement
sous la forme d’une villa, et de plus il était au cœur d’un vicus
placé au carrefour de nombreuses routes, dont certaines furent plus tard intégrées
à la via tolosana menant à
Compostelle. Ensuite, sur cet emplacement, a été édifiée une église paléochrétienne
en rapport avec une nécropole connue par la découverte de sépultures situées
sous le chœur actuel de l’église. Ce premier monument cultuel était très
simple, constitué d’une nef rectangulaire terminée par une abside
polygonale, forme que l’on rencontre dans la région à la basilique du Plan
à Saint-Bertrand de Comminges et sur le site de la
Gravette, à l’Isle-Jourdain (7).
Plus tard, sans doute à l’époque carolingienne, cette petite église a été
agrandie vers l’est et le chevet pentagonal est devenu semi-circulaire. Il
fut aussi agrémenté d’un transept. Ces découvertes, ainsi que le toponyme
Celle, permettent d’envisager
l’existence, à cette époque, peut-être aux IXe-Xe
siècles, d’une petite communauté monastique.
Une
église construite en deux campagnes
Dans
le dernier quart du XIe siècle, les moines venus d’Alet
reconstruisent le chevet tripartite et le transept saillant toujours en place,
rattachés à l’ouest à une nef à vaisseau unique modifiée postérieurement.
La construction, charpentée, est constituée d’assises de galets roulés
noyés au mortier. Néanmoins, à l’extérieur et à l’intérieur du
choeur, on note une certaine qualité décorative, par l’intermédiaire
d’un appareil réticulé et de colonnes surmontées de chapiteaux. Cette
partie de l’édifice est un témoin précieux des manières de construire et
de décorer dans cette région du midi de la France dans la deuxième moitié
du XIe siècle, avant les changements structurels et esthétiques
des années 1100 (8).
Au
XIIe siècle, de nombreuses modifications concernent
essentiellement le couvrement de l’église et son extension vers l’ouest.
Comme cela se fait ailleurs au même moment (9), l’abside est raidie à
l’intérieur de l’hémicycle par une arcature aveugle qui reçoit en
partie le poids de la voûte en cul-de-four. On voûta également le transept
marqué aux angles de la croisée par d’importants supports construits pour
supporter le poids d’une imposante tour-lanterne. Comme dans la campagne précédente,
les éléments de remploi sont particulièrement nombreux. La nef à vaisseau
unique, conservée et agrandie, comporte désormais trois vaisseaux et elle
est aussi plus longue. Sa largeur accrue a pour conséquence la disparition de
la saillie du transept. Cette campagne de construction et d’embellissement,
appartenant à la première moitié du XIIe siècle, se termine par
le percement d’un élégant portail en avant-corps, au sud de la nef.
Des
éléments lapidaires d’influence cistercienne
Où
se trouvaient les bâtiments monastiques ? Si la question a été posée
par plusieurs auteurs, force est de constater qu’aucun d’entre eux n’a
pu donner de réponse sûre, les plaçant au nord ou au sud (10), sans pouvoir
apporter de preuve véritable du fait de l’absence de vestiges, de sondages
archéologiques probants et de textes. Le travail acharné de Sylvain Doussau
a heureusement permis de répondre définitivement à ce problème de
localisation (11). En effet, en dépouillant les archives de Maubourguet, il y
a découvert une délibération municipale datée du 19 juin 1684 dans
laquelle il est question des bâtiments des moines. En effet, on y mentionne,
au sujet des travaux de reconstruction du presbytère, que les matériaux des
ruines de l’ancien pourront servir « sans pourtant toucher aux masures
du cloître qui est au septentrion de ladite église ». Plus loin, on
parle aussi des « masures de l’ancien cloître ».
Nous
avons vu plus haut que les protestants avaient saccagé le monastère en 1569.
Si l’on reprend le texte de dom Estiennot, on apprend que « les
novateurs l’ont ruiné de telle façon qu’il n’en reste que des décombres ».
Plus loin, il ajoute que « les seigneurs de Labatut-de-Rivière se sont
emparés des colonnes de marbre du cloître et d’autres morceaux précieux
et les ont employés à la construction de leur château mais le fleuve Adour
paraît les revendiquer car, éloigné autrefois de ce château, non seulement
maintenant il le baigne, mais encore il le ronge et le réduit ».
Depuis
le printemps 1978, une partie de ces éléments lapidaires est revenue à
Maubourguet (12). La propriétaire du château de Labatut a cédé à la
commune voisine les vestiges que ses ancêtres, vicomtes de Rivière-Basse,
avaient récupérés, semble-t-il, dans le cloître. Les pièces sont
actuellement conservées dans le petit musée archéologique local, tout près
de l’endroit où le seigneur de Labatut les enleva aux bâtiments
monastiques (13).
En
fait, tout n’est pas revenu puisqu’on trouve dans l’église paroissiale
de Labatut, ancienne chapelle du château, deux séries de colonnes jumelles,
avec socles, bases et chapiteaux, disposées de chaque côté de la porte
d’entrée de la sacristie, percée dans le mur nord de l’église (14).
Enfin, chez un particulier, habitant entre Tarbes et Maubourguet, on trouve
deux colonnes simples, avec leurs socles, bases et chapiteaux, remployées en
tant que supports de cheminée (15). En ce qui concerne les pièces conservées
à Maubourguet, les plus nombreuses, elles se répartissent en 5 groupes de
colonnes doubles avec leurs socles, bases et chapiteaux (16).
On
peut donc aujourd’hui s’appuyer sur un ensemble conséquent d’éléments
lapidaires, sept colonnes, bases et chapiteaux doubles et deux colonnes, bases
et chapiteaux simples. Les matériaux sont homogènes : les colonnettes
sont en marbre des Pyrénées centrales tandis que les socles, les bases et
les chapiteaux sont en calcaire gréseux (17). On peut d’ores et déjà
noter un élément intéressant : ces deux matériaux sont également présents
dans l’architecture cistercienne méridionale dans laquelle on favorise,
dans la deuxième moitié du XIIe siècle et dans la première
moitié du siècle suivant, l’emploi du marbre dans les cloîtres, salles
capitulaires, sacristies, … . Les communautés cisterciennes de Bigorre, de
Gascogne centrale et de Comminges l’attestent (18).
On
notera la présence de trois chapiteaux doubles engagés (deux à Maubourguet
et un à Labatut) et de 6 chapiteaux adossés, dont quatre doubles et deux
simples. Ils peuvent donc avoir appartenu au cloître de la communauté bénédictine.
Les abaques de trois chapiteaux doubles ont été mutilés, de façon régulière,
sur deux des quatre angles, les enlèvements ayant la forme d’une encoche
carrée. Quelle est la raison de cette amputation ? Difficile à dire. On
peut voir que ces découpures ont abîmé le décor et qu’elles sont donc
postérieures à la sculpture des corbeilles. S’agit-il de la preuve d’un
repentir dans la mise en œuvre des blocs dans la structure architecturale ?
Est-ce le résultat d’une opération permettant d’engager les chapiteaux
dans des supports maçonnés ? Est-ce une trace des opérations de démontage
et de remontage des blocs après les exactions causées par les protestants ?
Nous en sommes réduits à de simples hypothèses (19). Terminons en disant
que les socles rectangulaires correspondant à ces chapiteaux présentent la même
particularité. Les bases sont très homogènes. Doubles ou simples, elles
sont moulurées de deux tores d’inégales dimensions, séparés par une
scotie et agrémentés tous les deux d’un filet plus ou moins marqué. En
cela, elles sont absolument semblables à celles du cloître de l’ancienne
abbaye de Berdoues (20). En revanche, elles varient entre elles quant au
traitement des angles : les bases doubles de Maubourguet et celles,
simples, situées de chaque côté de la « cheminée », ne
comportent, de prime abord, aucun décor, aucune griffe d’angle. Pourtant,
en procédant à un examen minutieux, on peut s’apercevoir que les boules
ont existé avant d’être mutilées, cassées, peut-être de manière déterminée
ou accidentelle, ou sciées volontairement. Celles de l’église de Labatut,
au contraire, ont préservé leurs griffes circulaires en forme de motif
floral stylisé, s’enroulant sur lui-même.
Il
faut ici noter trois choses : tout d’abord, le motif des bases de
Labatut est assez proche de celui qui apparaît sur certaines bases des
colonnes situées à l’intérieur de l’église de Maubourguet, notamment
dans les ébrasements des fenêtres des bras nord et sud du transept, percées
sans doute dans la deuxième moitié du XIIe siècle ou dans les
premières années du siècle suivant. Ensuite, la présence de griffes
d’angle renvoie bien évidemment à la sculpture cistercienne, comme
l’attestent de nombreux exemples (21). Enfin, cette décoration est aussi
visible sur des bases provenant de l’ancien monastère prémontré de la
Case-Dieu, à Beaumarchès, dans le Gers, et aujourd’hui remployées sur la
façade occidentale de l’église paroissiale de Marciac, dans ce même département.
Cet édifice prestigieux aujourd’hui disparu a bénéficié, autour des années
1200, de l’influence de la sculpture cistercienne (22).
Les
chapiteaux constituent bien sûr la partie la plus intéressante de ce fonds
lapidaire. Ils comportent un astragale torique, une corbeille tronconique, un
abaque rectangulaire et leurs dimensions correspondent à celles des bases
placées au-dessous, autant de caractéristiques qui sont aussi celles de la
sculpture cistercienne de la fin de l’époque romane (23). Le décor est également
d’influence cistercienne : des feuilles lisses, hautes et larges
occupent toute la corbeille. Elles sont parfois marquées par une double
nervure médiane et se terminent, en enroulement en forme de volutes au
milieu, en palmettes ou coquilles renversées aux angles, en palmettes ou
coquilles renversées aux angles et au milieu, comme sur des chapiteaux de
Berdoues (24), de Flaran (25) ou de la Case-Dieu. Ailleurs, les feuilles
lisses à double nervure occupent toute la corbeille et ne comportent aucun
artifice décoratif particulier. C’est encore une fois un schéma de
composition qui irrigue toute la sculpture prégothique cistercienne (27). Ces
deux déclinaisons concernent les cinq chapiteaux doubles de Maubourguet. Les
deux chapiteaux doubles de l’église de Labatut sont plus complexes :
les corbeilles y sont habillées de feuilles larges, à l’intérieur
desquelles des palmettes ou des demi-palmettes renversées habillent de grands
cœurs. C’est encore une fois un motif apprécié dans les monuments de
l’ordre de Cîteaux bien que la présence de la palmette largement ouverte
renvoie à la sculpture romane traditionnelle.
Les
deux chapiteaux simples sont plus originaux : le premier est orné de
feuilles étroites naissant de l’astragale et formant un grand x incurvé.
Ces feuilles semblables à des bandes laissent aux angles des espaces lisses
et nus. À l’intérieur des feuilles, on trouve des folioles minces taillées
en creux leur donnant l’aspect de feuilles de fougère, motif que l’on
rencontre également chez les moines blancs et ceux qui s’inspirent de leur
vocabulaire ornemental (28). Le deuxième reprend le modèle précédent tout
en multipliant les bases qui s’entrecroisent et en remplaçant les folioles
par des brins d’entrelacs. Ce motif curieux, qu’on pourrait croire étranger
à la sculpture cistercienne et un rappel de formes plus anciennes remontant
à l’époque carolingienne ou au début de l’époque romane (29), est néanmoins
présent sur les deux chapiteaux du portail nord de l’ancienne église
abbatiale de Flaran, dans le Gers, lequel met en relation l’église avec la
galerie orientale du cloître (30). Nous sommes donc encore et toujours dans
un fort contexte cistercien, bien qu’il soit possible que dans le cas de
Maubourguet, on ait affaire à des sculpteurs qui s’inspirent aussi de
formes artistiques locales, parfois datées.
Où
étaient ces vestiges ? Si, à première vue, on peut les rattacher à la
structure d’un cloître des années 1200, d’inspiration cistercienne,
l’examen minutieux des dimensions des éléments conservés et les
comparaisons que l’on peut faire, interdisent cette attribution. En effet,
les colonnes, mesurant 72 cm de haut, sont trop courtes pour avoir été posées
sur le mur-bahut séparant le préau du cloître. En comparant ces dimensions
avec celles des colonnes de certains cloîtres méridionaux, on observe une
grande différence car ces supports mesurent environ entre 110 et 140 cm de
haut (31). En même temps, il est vrai que la présence de colonnes doubles et
de colonnes simples évoquent les grands cloîtres du Midi construits tout au
long du XIIe siècle, à Moissac, la Daurade, Saint-Lizier…
Enfin, écartons un autre emplacement, l’intérieur de la salle elle-même,
correspondant aux colonnes séparant les travées les unes des autres et placées
au centre de la pièce, à la retombée des voûtes d’ogives, comme c’est
le cas à Flaran, l’Escaladieu ou même à la cathédrale d’Auch, dont la
salle capitulaire du XIIIe siècle a subi l’influence de modèles
cisterciens (32). En effet, ces colonnes mesurent généralement autour de
120/130 cm de haut et sont d’un plus fort diamètre (33).
En
fait les dimensions des colonnes de Maubourguet, 72 cm de haut pour 14 à 14,5
cm de diamètre, correspondent plutôt aux normes des supports flanquant les
baies d’une façade d’entrée de salle capitulaire : 73 cm à
l’Escaladieu, 63 cm de haut à Alet (34), 78 cm à Saint-Martory pour les
vestiges provenant de Bonnefont (35)… À Flaran, les dimensions sont presque
exactement les mêmes : 72 cm de haut et 14 cm de diamètre. Si on émet
l’hypothèse que la façade occidentale de la salle capitulaire de Flaran a
pu servir de modèle, on peut alors imaginer l’élévation et la structure
de la façade d’entrée de la salle capitulaire de Maubourguet :
l’emprise de la façade sur la galerie (orientale ?) du cloître
correspondrait à trois grandes baies en plein cintre dont celle du centre
servirait de portail d’entrée, sachant que les supports, de mêmes
dimensions, reposent sur un mur élevé. Les supports accueillant les rouleaux
intérieurs et les archivoltes pourraient être des colonnettes doubles,
accompagnées de bases et de chapiteaux doubles (36). Quant aux autres
rouleaux, ils seraient accueillis par des éléments simples. Ainsi, les neuf
groupes d’éléments lapidaires, sept doubles et deux simples, pourraient
tout à fait appartenir à ce type de structure monumentale.
Conclusion
Les
pièces lapidaires aujourd’hui conservées à Maubourguet, comme celles de
l’église de Labatut et celles remployées dans une cheminée privée font
partie d’un ensemble cohérent et homogène qui a pu appartenir à la façade
de la salle capitulaire de l’ancien prieuré bénédictin de
Saint-Martin-de-Celle. L’analyse des dimensions, de la mouluration et du décor
montre que nous sommes en présence d’un ensemble réalisé
vraisemblablement dans le premier quart ou la première moitié du XIIIe
siècle, au moment où les grandes abbayes cisterciennes méridionales édifient
et embellissent leurs bâtiments monastiques. C’est alors que les moines de
Maubourguet construisent ou reconstruisent leur salle capitulaire en faisant référence
au modèle cistercien régional qui représente peut-être aussi
l’expression du goût commun au XIIIe siècle.
Quelles
en sont les principales caractéristiques ? L’attachement au marbre pyrénéen,
utilisé principalement pour les colonnettes qui mettent en valeur la
structure et l’élévation de la façade ; le souci d’utiliser le
calcaire pour les éléments structurels et décoratifs tels que les bases et
les chapiteaux, offrant aussi la possibilité de jouer sur les oppositions de
polychromie ; la prédilection pour une sculpture austère et dépouillée,
à la fois éloignée des formes décoratives antérieures mais aussi proche
des formes gothiques à venir.
La
question qu’il faut alors se poser est celle-ci : avons-nous affaire à
des ateliers de tailleurs de pierre et de sculpteurs travaillant de façon
quasi-industrielle pour la commande artistique du temps de façon générale
ou s’agit-il d’artistes œuvrant essentiellement pour les abbayes
cisterciennes, tout en proposant leur production à d’autres communautés,
lesquelles, pour des raisons diverses, bénéficient de l’influence
cistercienne ? On voit alors, pour les deux parties, tous les avantages
liés à la standardisation, confinant presque à la monotonie, des éléments
d’architecture et de sculpture.
Christophe BALAGNA
Notes
1. Je remercie vivement
Monsieur Sylvain Doussau, à l’origine, entre autres, de la redécouverte de
l’église de Maubourguet, de m’avoir permis de travailler sur ce fonds
lapidaire. Son aide, ses conseils et sa parfaite connaissance de l’église
m’ont été très précieux. À ce sujet, lire la remarquable synthèse de
ces travaux : S. Doussau, « Recherches archéologiques sur le site
et l’église du prieuré Saint-Martin-de-Celle de Maubourguet », dans A.M.M.,
t. 6, 1988, p. 65-89. Quelques années auparavant, l’auteur avait écrit une
monographie de l’église, L’église
de Maubourguet, histoire et archéologie, Lourdes, 1979.
2. Le manuscrit est conservé à la B.N.F., ms. lat. 12752, f° 8 et 354. Cf.
Paul Mesplé, « L’église de Maubourguet », dans Gens
et choses de Bigorre, Actes du XIIe Congrès d’études régionales
de la Fédération des Sociétés Académiques et Savantes de Languedoc-Pyrénées-Gascogne,
1967, p. 57-74 et S. Doussau, « Recherches archéologiques sur le site
et l’église…», p. 65. On trouvera chez Mesplé le rappel de la brève
historiographie dont le monument a bénéficié. Enfin, on consultera aussi la
notice de l’abbé Jean Cabanot, « Sainte-Marie de Maubourguet »,
dans Gascogne romane, 1978, p.
55-60.
3. Dom Estiennot écrit : « les
novateurs l’ont ruiné de telle façon qu’il n’en subsiste que des décombres ».
Cf. P. Mesplé, « L’église de Maubourguet », p. 58.
4. L’actuelle église paroissiale de Maubourguet est inscrite à
l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis févier 1927.
5. Cf. S. Doussau, « Recherches archéologiques sur le site et
l’église… », p. 66-70.
6. Idem, p. 82-83.
7. Au sujet de l’apparition des premiers monuments de culte chrétien dans
la région, on lira avec profit Marie-Geneviève Colin, Christianisation
et peuplement des campagnes entre Garonne et Pyrénées, IVe-Xe
siècles, supplément n° 5 à A.M.M.,
Carcassonne, 2008.
8. Au sujet de la place de l’église dans l’art régional de la fin du XIe
siècle, cf. J. Cabanot, Gascogne romane
et Les débuts de la sculpture
romane dans le Sud-Ouest de la France, Paris, 1987.
9. C. Balagna, « L’église romane de Croute à Lasserrade (Gers) :
un édifice inachevé de Gascogne centrale autour de 1125 », dans A.M.M., t. 26, 2008, p. 59-91.
10. C’est notamment le cas de P. Mesplé, « L’église de Maubourguet »,
p. 65.
11. Cf. S. Doussau, L’église de
Maubourguet, histoire et archéologie, p. 16.
12. Le récit de ce retour a fait l’objet d’un article de S. Doussau :
Nouvelle République des Pyrénées, jeudi 10 août 1978.
13. On peut voir sur l’abaque de l’un des chapiteaux la date de « mars
1602 ». On a alors proposé d’y voir, à juste titre, la date du
transfert opéré par le seigneur de Labatut dans ses terres.
14. Scellées dans le mur nord de l’église, ces pièces s’y trouvent
encore. En voici les dimensions principales : l’abaque des deux
chapiteaux doubles mesure 52 cm de long sur 34 cm de large sur 3 cm de haut ;
mêmes dimensions en longueur et largeur pour les socles ; les bases
mesurent 16 cm de haut ; les colonnes mesurent 72 cm de haut pour environ
14 cm de diamètre ; les chapiteaux (corbeille et abaque) mesurent 26 cm
de haut et l’astragale torique mesure 2 cm d’épaisseur.
15. Les dimensions de ces divers éléments sont : l’abaque des deux
chapiteaux mesure 33 cm de long sur 23 cm de large ; mêmes dimensions en
longueur et 23,5 cm de large pour les socles ; les bases mesurent 16 cm
de haut ; les colonnes mesurent 72 cm de haut pour environ 14 cm de diamètre ;
les chapiteaux (corbeille, abaque et astragale) mesurent 26 cm de haut.
16. Les dimensions de ces pièces sont identiques : les colonnes mesurent
toutes 72 cm de haut pour un diamètre oscillant entre 14 et 14,5 cm ;
les socles mesurent 52 cm de long sur 34 cm de large et 6 cm de haut ;
les bases mesurent 16 cm de haut ; l’abaque des chapiteaux mesure 52 cm
de long sur 34 cm de large et 6 cm de haut ; les chapiteaux
(corbeille et abaque) mesurent entre 26 et 27 cm de haut et l’astragale
torique mesure 2 cm d’épaisseur.
17. On a relevé sur certaines corbeilles, notamment à Maubourguet, des
traces de peinture ocre jaune. S’il est difficile d’en dire plus, il est
possible d’envisager que ce décor soit contemporain de l’époque médiévale
et qu’il participe à la mise en valeur des chapiteaux par rapport aux
colonnes.
18. Cf. C. Balagna, L’architecture gothique religieuse en Gascogne
centrale, thèse Nouveau régime, Université de Toulouse-Le Mirail, 2000,
t. 1, p. 56-104 et Les éléments sculptés du
fonds lapidaire de l’ancienne abbaye cistercienne de Berdoues (Gers) :
critique d’authenticité, étude technique et stylistique,
rapport remis à la DRAC Midi-Pyrénées, novembre 2006, 50 p.
19. Il faudrait se pencher plus avant sur cette question qui me paraît
très importante. En effet, si ces encoches sont le résultat d’une
adaptation des pièces sculptées à la structure architecturale devant les
recevoir, cela voudrait dire que nous avons affaire à des chapiteaux doubles
fabriqués en série, hors site, donc en loge, en atelier, peut-être à
proximité de la carrière, sans que le sculpteur sache véritablement quel
emplacement va recevoir son chapiteau, peut-être même sans savoir dans quel
édifice il sera. Cela renforcerait l’hypothèse selon laquelle on aurait
affaire à des œuvres systématiquement mises en forme pour des monuments
divers, sans liens entre eux, et non pour des communautés exclusivement
cisterciennes. Enfin, cela pourrait également expliquer le caractère très
standardisé des socles, bases, colonnettes et chapiteaux, dans les dimensions
et dans la mouluration.
20. C. Balagna, Les éléments
sculptés du fonds lapidaire de l’ancienne abbaye cistercienne de
Berdoues… », p. 11-13.
21. Même si ces griffes sont généralement de simples boules, comme
dans les abbayes de Berdoues et de Flaran.
22. Cf. C. Balagna, « À la redécouverte d’un important édifice médiéval
de Gascogne centrale : l’ancienne abbaye de La Case-Dieu (Gers) »,
dans M.S.A.M.F., t. LXIV, 2004, p. 63-78. Il faut signaler également que
l’architecture cistercienne, notamment l’élévation intérieure du
vaisseau central de l’ancienne abbatiale de Flaran, a pu servir de modèle
pour la construction de l’église de la Case-Dieu.
23. Sur les caractéristiques de la sculpture des monuments de l’ordre de Cîteaux
dans le midi, cf. C. Balagna, « Les chapiteaux de Grandselve et la
sculpture cistercienne méridionale », dans Grandselve, l’abbaye
retrouvée, ouvrage collectif, 2006, p. 105-108.
24. Cf. C. Balagna, L’architecture gothique religieuse en Gascogne
centrale, p. 92-97 et « Les éléments sculptés du fonds lapidaire
de l’ancienne abbaye cistercienne de Berdoues… ».
25. Cf. C. Balagna, L’architecture gothique religieuse en Gascogne
centrale, p. 92-97 et aussi Marcel Durliat, L’abbaye
de Flaran, éd. Sud-Ouest, 1989.
26. Cf. C. Balagna, « Quelques chapiteaux romans et gothiques de
l’ancienne abbaye de La Case-Dieu (Gers) », dans Actes
de la 21e Journée des Archéologues Gersois (Vic-Fezensac 1999),
Auch, 2000, p. 100-133 ; « Nouvelles découvertes de vestiges
sculptés provenant de l’ancien monastère de La Case-Dieu (Gers) »,
dans Actes de la 25e Journée
des Archéologues Gersois (La Romieu 2003), Auch, 2004, p. 78-91 ;
« À la redécouverte d’un important édifice médiéval de Gascogne
centrale : l’ancienne abbaye de La Case-Dieu (Gers) ».
27. Cf. C. Balagna, Les éléments
sculptés du fonds lapidaire de l’ancienne abbaye cistercienne de
Berdoues… ».
28. C’est notamment le cas sur des chapiteaux de la Case-Dieu.
29. En effet, ce motif d’inspiration carolingienne se voit sur des
chapiteaux situés à l’intérieur de l’église de Maubourguet, plus
particulièrement à l’entrée des deux absidioles orientées, pouvant
appartenir à la fin du XIe siècle. Cf. S. Doussau, L’église
de Maubourguet, histoire et archéologie, et J. Cabanot, « Sainte-Marie
de Maubourguet », p. 55-60. On peut également citer l’église
Saint-Mamet de Peyrusse-Grande, proche de Maubourguet mais située dans le département
voisin du Gers, dans laquelle on a fait aussi une large place à
l’entrelacs, cf. M. Durliat, « L’église de Peyrusse-Grande »,
dans Congrès Archéologique de France, 1970, Paris, 1970, p. 43-54 et J.
Cabanot, « Saint-Mamet de Peyrusse-Grande», dans Gascogne romane, p. 49-52.
30. D’autres chapiteaux, à l’intérieur de l’église, reprennent ce schéma
décoratif.
31. 111 cm à Berdoues, 142 cm à l’Escaladieu, par exemple.
32. Cf. C. Balagna, L’architecture gothique religieuse, p. 98-101.
33. Parmi les pièces revenues du château de Labatut, il faut signaler la présence
de trois bases cylindriques sur socle carré conçues pour accueillir des
colonnes de 23 cm de diamètre. Il serait intéressant, el les comparant à
d’autres, de tenter de définir quel a pu être leur emplacement au sein du
prieuré.
34. Pour un diamètre de 16 cm.
35. Cf. E. Duméril et P. Lespinasse, « Une abbaye cistercienne du
Comminges, Bonnefont », dans Revue
de Comminges, 1926, p. 1-69, pl. 18 et B. Jolibert, « Bonnefont,
petite-fille de Cîteaux », dans Revue
de Comminges, 1987, p. 477-494.
36. Si on prend l’exemple de Flaran, cela
donne 3 baies et 4 séries d’éléments doubles. Là aussi, les dimensions
des bases et des chapiteaux, leur mouluration, leur décor, associent de façon
étroite Flaran et Maubourguet…
Michèle
Pradalier-Schlumberger remercie l’orateur et pense qu’il a raison dans sa
proposition d’attribution de ces éléments à une salle capitulaire. Elle est
aussi d’accord avec leur datation dans le premier tiers du XIIIe siècle,
avant les premières manifestations des caractères pleinement gothiques de la
sculpture. Emmanuel Garland se demande s’il ne faudrait pas aussi penser à
des enfeus (voir par exemple Bonnefont) qui présentaient également des
colonnettes aussi courtes. Contrairement à ce qui a été dit par Christophe
Balagna, il croit ces sculptures très proches les unes des autres, produites
par des ateliers régionaux, sans référence particulière au monde cistercien.
Elles témoignent selon lui plutôt d’une mode locale, répondant aussi par sa
simplicité à des contraintes économiques. Christophe Balagna pense qu’il
s’agit bien d’une production en série. Daniel Cazes croit aussi à une économie
de moyens correspondant à un goût largement suivi, le tout favorisant la
multiplication et la fabrication en série.
Guy Ahlsell
de Toulza souhaite revoir les photographies des chapiteaux intégrés à une
cheminée et émet de forts doutes sur leur ancienneté. Il est surpris par
leurs arêtes vives, leur manque d’usure, et croit plutôt à des œuvres du
XIXe siècle, ce que semble bien confirmer la pierre identique et
taillée de la même façon des piédroits de la cheminée. Il semble bien
s’agir de copies modernes des chapiteaux anciens réutilisés au château de
Labatut et non de ces derniers. C’est aussi le point de vue d’Anne-Laure
Napoléone. Guy Ahlsell de Toulza et Christophe Balagna ont ensuite un échange
sur ce que l’on pourrait déduire plus précisément des nombres de bases,
colonnes et chapiteaux, et de leurs associations. Au sujet de l’abbaye de
Bonnefont, évoquée par Christophe Balagna et Emmanuel Garland, Daniel Cazes
demande des informations sur le devenir des éléments lapidaires anciennement
remployés dans la façade de la gendarmerie de Saint-Martory et qui sont
actuellement en dépôt chez un entrepreneur de maçonnerie : étant donné
les difficultés actuellement traversées par les vestiges et le site de
l’ancienne abbaye cistercienne, ne serait-il pas avisé de les mettre en dépôt
conservatoire dans un musée ? Au moins dans l’attente de la connaissance
du nouveau statut de propriété de Bonnefont ? Emmanuel Garland donne à
la Société des précisions sur les problèmes posés actuellement par
l’abbaye de Bonnefont.
SÉANCE DU 18
MARS 2008
Présents : MM. Ahlsell de
Toulza, Trésorier, Scellès, Secrétaire général, Mme Suau, Bibliothécaire-Archiviste,
MM. Cabau, Secrétaire-adjoint, Latour, Bibliothécaire-adjoint ; Mmes
Bayle, Napoléone, MM. Boudartchouk, Garland, Gilles, Roquebert, membres
titulaires ; Mmes Barber, de Barrau, Fronton-Wessel, Haruna-Czaplicki,
Krispin, MM. Balagna, Capus, Le Pottier, Mattalia, Pousthomis, Surmonne, Veyssière,
membres correspondants.
Excusés : Mme
Pradalier-Schlumberger, Présidente, M. Cazes, Directeur, Mme Cazes.
En
l’absence de la Présidente et du Directeur, tous deux empêchés, le Trésorier
préside la séance. Guy Ahlsell
de Toulza présente à la Compagnie le fascicule du règlement intérieur adopté
le 29 mars 2007, qui a été distribué à tous les membres présents et qui
sera désormais remis à chaque nouveau membre de notre Société.
Le Secrétaire
général donne lecture du procès-verbal de la séance du 4 mars, rédigé par
le Directeur. Il propose de préciser certains points relatifs aux concours :
les amendements seront présentés lors d’une prochaine séance et
l’adoption du procès-verbal est de ce fait reportée.
La parole
est à Philippe Gardes pour la communication du jour : Touget (Gers),
une agglomération protohistorique et antique, publiée dans ce volume
(t. LXVIII, 2008) de nos Mémoires.
Guy Ahlsell
de Toulza remercie Philippe Gardes pour cette communication passionnante. Sa
première question concerne le jeune homme au lièvre, un thème sur lequel il
se rappelle avoir vu autrefois une publication. Philippe Gardes précise que
cette sculpture a été trouvée sur le site dans les années 1880, et qu’elle
est aujourd’hui conservée au Musée des Antiquités nationales de
Saint-Germain-en-Laye. De fait cette sculpture est un unicum iconographique. Hélène
Guiraud rappelle que dans le monde grec, le lièvre pouvait être une évocation
de l’homosexualité, mais qu’il n’est pas sûr que cette même
signification puisse être attribuée à cette œuvre romaine. Les intailles
figurent fréquemment des chasseurs avec chien et lièvre, mais dans des
relations différentes, et Hélène Guiraud note en outre que la coiffure est
plutôt celle d’un adolescent. Guy Ahlsell de Toulza évoque alors l’enfant
au chat de Bordeaux.
Sa deuxième
question concerne le déplacement de l’agglomération sur la hauteur :
faut-il le dater des IVe-Ve siècles ? Bernadette
Suau, quant à elle, voudrait savoir si l’appellation de « prieuré »
doit être entendue au sens strict et de quelle époque datent les murs conservés.
Philippe Gardes dit que les maçonneries les plus anciennes pourraient être du
XIe siècle et il précise que le prieuré dépendait de Saint-Orens d’Auch.
Répondant
à une question de Dominique Watin-Grandchamp, Philippe Gardes rappelle qu’il
conclut pour sa part à l’existence d’une agglomération sur le site de
Touget, et non pas d’une simple villa. Le maintien d’une occupation
aux VIe-IXe siècles n’est pas à exclure totalement,
car les vestiges de cette période peuvent être difficilement identifiables.
Jean-Luc Boudartchouk annonce qu’il prolongera l’exposé de Philippe Gardes
l’année prochaine, en nous présentant l’évolution du site au cours du
Moyen Âge.
Guy Ahlsell
de Toulza voudrait savoir si l’épisode de la pelle mécanique a provoqué une
prise de conscience : de fait, le maire a seulement voulu connaître
quelles pouvaient être les suites judiciaires, alors même qu’il avait
sollicité des conférences et qu’il est par ailleurs chargé de la culture au
Conseil général du Gers.
Après avoir
souhaité revoir la carte des lieux, Hélène Guiraud demande si une voie
existait entre les deux nécropoles. Philippe Gardes indique que le chemin
actuel est semble-t-il ancien, mais il s’empresse d’ajouter que Touget est
situé en dehors des grandes voies romaines. Jean-Luc Boudartchouk l’interroge
alors sur la place du Touget dans ce réseau secondaire entre Auch et Toulouse.
Philippe Gardes regrette d’être ainsi obligé à dévoiler une hypothèse
hasardeuse, qui conduirait à peut-être reconnaître Touget dans un Hungunverro
mentionné dans l’itinéraire de Auch à Jérusalem, mais cela n’est certes
pas avéré…
Guy Ahlsell
de Toulza prend donc rendez-vous pour une suite l’année prochaine, avec une
étude de l’évolution du site de Touget pendant le Moyen Âge.
Au titre des
questions diverses, Jean-Luc Boudartchouk présente Deux objets issus des fouilles de l’ancien hôpital
militaire Larrey. À propos de la construction et de l’occupation du probable
palais des rois goths de Toulouse :
Les
fouilles préventives menées en 1988 à Toulouse sur le site de l’ancien hôpital
militaire Larrey par Raphaël de Filippo et son équipe ont amené la découverte
d’un complexe monumental de la basse Antiquité tout à fait inattendu, qui
se développe entre la rive de la Garonne et l’enceinte du premier siècle.
Il n’a malheureusement pas été conservé. Rapidement, le fouilleur a émis
l’hypothèse que ce « grand bâtiment » puisse être une partie
du palais des rois goths de Toulouse ; hypothèse confortée depuis et
admise par l’ensemble des chercheurs. Lors de ces fouilles de grande
ampleur, deux objets particulièrement signifiants ont été mis au jour ;
ils figurent sur des clichés inclus dans le rapport d’opération de 1989
(1).
Ces deux objets sont porteurs
de données chrono-culturelles de première importance pour l’histoire du
« grand bâtiment » de Larrey. Le premier est une terminaison de
lanière de cingulum (ceinturon à
plaques métalliques décorées porté par les militaires et certains
fonctionnaires romains des IVe-Ve siècles) ; la
datation de cet objet confirme pleinement l’hypothèse du fouilleur relative
l’époque de la construction de l’édifice. Le second est une garniture
cloisonnée à décor de grenats dont l’appartenance au domaine culturel des
Germains orientaux ne fait guère de doute, alors que sa datation estimée, le
milieu ou la seconde moitié du Ve siècle, le place dans la période
d’apogée du royaume des Goths de Toulouse.
Dater la construction du « grand
bâtiment » de Larrey : l’apport d’une terminaison de lanière
de cingulum.
L’objet (cliché dans de
Filippo 1989, pl. h.t.) a été découvert « pris dans le mortier des
fondations d’un mur du bâtiment » (de Filippo 1996, p. 27). Il
s’agit d’une terminaison de lanière de cingulum,
qui fournit donc un précieux terminus
ante quem non à l’édifice. De facture assez sommaire, il est décoré
de neuf ocelles qui occupent la partie centrale de l’extrémité distale
circulaire. La partie proximale, échancrée, possède des bords rectilignes ;
son extrémité est dégradée.
Cet élément appartient à
une série d’objets très caractéristiques, précédemment étudiés dans
le cadre de plusieurs typologies en langue allemande. Le type présent à
Larrey est appelé « Schreibenförmige » par Bullinger (1969),
puis « Punzverzierte Schreibenriemenzungen » par Böhme (1974),
enfin « Schreibenförmige Riemenzungen, Form C, Typ D » par Sommer
(1984). L’on pourrait hasarder, pour le qualifier en français, quelque
chose comme « terminaison de lanière en forme de bourse » (2).
Plusieurs dizaines d’objets assez similaires ont été répertoriés dans le
cadre des travaux cités ci-dessus. La plupart sont localisés, très souvent
en contexte militaire, dans la zone « Rhin et Danube », soit en
Germanie I et II, en Belgique I et II, en Maxima
Sequanorum, dans les Alpes Poeninae
et Graiae, plus quelques-uns en Germanie libre (Böhme 1974, Karte 18).
Parmi les parallèles les plus proches, on peut citer les exemplaires de
Krefeld-Gellep (Böhme 1974, Taf. 81), Tongres (Böhme 1974, Taf. 106 ;
Bullinger 1969 Taf. XV), Vieuxville (Böhme 1974, Taf. 110 ; Sommer 1983,
Taf. 59), Muri (Sommer 1983, Taf. 77). Ce type est diffusé jusqu’en Espagne
du nord, à Hornillos del Camino (Aurrecoechea Fernàndez 2001, p. 140). En Gaule méridionale,
on connaît quelques rares exemplaires dans le sud-est (3). Les caractéristiques
typologiques de l’objet de Larrey permettent de le situer chronologiquement
dans les « Stufe II » (ca. 380-ca.420) ou « Stufe III »
(400-450) de Böhme, ainsi que dans le « Gruppe 3 » de Sommer (ca.
407-ca. 450). Le faire sommaire de l’objet pourrait indiquer une production
artisanale et/ou locale.
Une présence militaire à
Toulouse au Bas-Empire tombe sous le sens, ne serait-ce que pour assurer la
garde de l’immense enceinte. Dans ce domaine, on peut citer l’épitaphe, hélas
lacunaire, d’un protector, soldat
d’élite enseveli dans le quartier Saint-Roch après quinze ans de service
(Labrousse 1968, p. 467). L’élément de cingulum
de Larrey constitue l’un des témoignages les plus tardifs de la présence
de l’armée impériale en Gaule du Sud-Ouest ; présence qui,
justement, prend fin selon nous avec l’installation des Goths dès 413
(Boudartchouk 2009).
|

Terminaison
de lanière de cingulum (alliage cuivreux) mis au jour dans la maçonnerie
du probable palais des rois goths. Premier tiers du Ve siècle. D’après
cliché figurant dans de Filippo 1989, pl. h.t. |
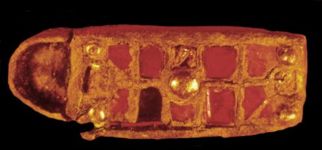
Élément de garniture (alliage
cuivreux, argent, grenats). Milieu - seconde moitié du Ve siècle.
D’après cliché figurant dans de
Filippo 1989, pl. h.t. |
La question de la présence gothe
à Larrey : l’apport d’un élément de garniture d’arme ou d’équipement
La garniture (cliché dans de
Filippo 1989, pl. h.t.) a été découverte « au pied du mur de courtine
de l’enceinte [du premier siècle], au début de la fouille, pratiquement au
décapage, dans un endroit très perturbé par les nombreuses fosses dépotoir
médiévales creusées en sape dans le soubassement de l’enceinte. Elle
n’a donc pas été trouvée dans un contexte de son époque » (de
Filippo in litteris, 16.01.2008).
Il s’agit probablement
d’une garniture d’arme, peut-être une épée (élément de garde,
d’applique de fourreau, ou de bouterolle ce qui correspondrait à la forme générale
de l’objet ?) ; on ne peut toutefois exclure qu’il s’agisse
d’une applique décorative. Le décor subsistant consiste en un « cloisonné
large » de grenats tabulaires (10, dont 8 subsistants) et hémisphériques
(trois à l’origine, dont un subsistant au centre) disposés de manière symétrique
(les grenats hémisphériques formant une ligne axiale) sur un boîtier en
alliage cuivreux. Quatre rivets hémisphériques d’argent disposés aux
angles déterminent la découpe des grenats tabulaires attenants.
Nous n’avons pu établir de
parallèles pertinents entre l’objet toulousain et le monde mérovingien, à
l’exception – toutes proportions gardées ! – de certains éléments
de la tombe de Childéric. Les quelques convergences que nous avons cru déceler
avec des objets bien étudiés sont relatives au monde germanique oriental
et/ou nomade. En Gaule, on rappellera le décor cloisonné des armes de rang
princier mises au jour à Pouan (Peigné-Delacour,
1860). L’identité culturelle du guerrier qui y fut inhumé, Hun ou Goth,
fait débat : Lebedynsky, 2001 ;
Bona 2002 ; L’or des
princes barbares, 2000 ; Attila und die Hunnen, 2007). La chronologie
de la tombe est également discutée par les mêmes auteurs ; une
fourchette large (et consensuelle) la situe entre le milieu et la seconde
moitié du Ve siècle (4).
Si l’on étend les
comparaisons à l’Europe méridionale, centrale et orientale de la seconde
moitié du Ve siècle, on peut évoquer certaines riches sépultures
des Goths de Crimée (I Goti, p.
124, 129), ou des pièces du trésor de Domagnano en domaine ostrogothique (I Goti, p. 194 et sq.).
Pour l’Espagne wisigothique, on peut citer certains objets à décoration
cloisonnée « large » parmi les plus anciens du nord de
l’Espagne, fibules ou plaques-boucles (I
Goti, p. 301 et sq.).
La
structure de l’objet toulousain, l’agencement du décor et les types de
grenats associés incitent à le dater antérieurement au VIe siècle
et à le rattacher aux techniques comme aux répertoires décoratifs développés
au sein des différentes cultures gothes du Ve siècle. L’objet
de Larrey est, à notre connaissance, un unicum ;
si l’étude comparative technique et stylistique permet sans doute de le
dater raisonnablement de la seconde moitié du Ve siècle, sa
fonctionnalité demeure non assurée. Quoi qu’il en soit, sa présence, même
en contexte remanié, dans l’enceinte du palais des rois goths, fait sens.
Il s’agit de l’un des rares objets témoignant de la présence des Goths
dans la ville de Toulouse au Ve siècle (Boudartchouk, 2009).
Jean-Luc BOUDARTCHOUK
avec la participation de Raphaël de FILIPPO
Notes
1. La présente étude préliminaire a été réalisée
par Jean-Luc Boudartchouk d’après ces clichés, ainsi que grâce aux
renseignements inédits sur le contexte de découverte de ces deux objets
fournis par Raphaël de Filippo. Remerciements à MM. Marty et Sévègnes,
S.R.A. de Midi-Pyrénées.
2. Une terminaison de lanière de ce type pourrait, selon
nous, être représentée dans la partie occidentale de la Notitia Dignitatum (bouclier des Geminiacenses), document que l’on peut dater de ca. 430.
3. Dans les environs de
Toulouse et sur le territoire de la cité, les terminaisons de lanière de cingulum
que nous connaissons ne présentent pas d’affinités typologiques avec
l’objet de Larrey ; elles sont certainement plus anciennes, comme celle
de Lespugue-Abri Sous-les-Rideaux (cf. dessin de M. Jarry dans D.R.A.C.
Midi-Pyrénées, Service Régional de l’Archéologie, Bilan
scientifique 1998, p. 91).
4. La tombe, apparemment isolée, a été mise en
relation par Peigné-Delacour avec la bataille des Champs Catalauniques qui
s’est déroulée à proximité, en 451. L’auteur a cru y reconnaître la dépouille
du roi goth Théodoric II, mort au combat. Cette identification est
aujourd’hui abandonnée, pour autant, le défunt portait un anneau gravé
d’un nom germanique oriental, HEVA.
Bibliographie
L’armée romaine et les chefs barbares du IIIe au VIIe
siècle. Textes réunis par Françoise Vallet et Michel Kazanski,
Association française d’Archéologie Mérovingienne - Société des Amis du
Musée des Antiquités Nationales, Condé-sur-Noireau, 1993, 473 p.
Attila und die Hunnen,
Historisches Museum der Pflatz Speyer, éd. Theiss,
2007, 392 p.
Aurrecoechea
Fernàndez (Joaquin), Los cinturones romanos en la Hispania del bajo imperio, Montagnac,
éd. Monique Mergoil, 2001, 261 p.
Bienaimé (Jean),
Le trésor de Pouan au musée de Troyes,
Sainte-Savine, 1993, 22 p.
Böhme
(Hörst-Wolfgang) Germanische
Grabfunde des 4. bis 5. Jahrunderts, Munich, 1974, 2 vol.
Bona
(Istvàn), Les Huns. Le grand
Empire barbare d’Europe, IVe-Ve siècles (traduit
du hongrois par Katalin Escher), Paris, éd. Errance, 2002, 240 p.
Boudartchouk
(Jean-Luc), « Toulouse, de la ville wisigothique à la ville franque »,
dans Toulouse une métropole méridionale :
vingt siècles de vie urbaine, Actes du 58e congrès de la fédération
historique de Midi-Pyrénées, Toulouse, 2009, t. 1 p. 31-47.
Bullinger
(Hermann), Spätantike Gürtelbeschläge. Typen, Herstellung, Trageweise und
datierung, Brugge, De Tempel éd, 1969, 2 vol., 111 p. et 62-LXIX pl.
Filippo
(de) (Raphaël), Ancien hôpital
militaire Larrey. Toulouse. Sauvetage programmé. Rapport de fouilles préliminaire,
1989, vol. I, 155 p., pl.,
fig. ; vol. II, 237 p., pl., fig.
Filippo
(de) (Raphaël), « Le grand bâtiment du site de Larrey : la
question palatiale », dans Aquitania,
XIV (1996), p. 23-29.
Filippo
(de) (Raphaël), « Le grand bâtiment du site de Larrey : la
question palatiale », dans Pailler (Jean-Marie) (dir.), Tolosa. Nouvelles recherches sur Toulouse et son territoire dans
l’Antiquité, collection École française de Rome 281, Toulouse, 2002, p. 445-450.
I Goti, Milan, 1994, éd. Electa, 399 p.
Kazanski
(Michel), Les Goths, Paris,
éd. Errance, 1991, 148 p.
Labrousse
(Michel) Toulouse antique des origines à l'établissement des Wisigoths,
Paris, Ecole Française de Rome (Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes
et de Rome ; 212), 1968, 644 p., IX pl.
Lebedynsky
(Iaroslav), Armes et guerriers
barbares au temps des grandes invasions, IVe au VIe siècle
après J.-C., Paris, éd. Errance, 2001, 224 p.
Menéndez Pidal (Ramón) (dir.), Historia de España, tomo III. España visigoda, Madrid, 1980,
cuarta edición, 877 p.
Museu regional de Beja, Núcleo Visigótico,
1993, 107 p.
L’or
des princes barbares. Du Caucase à la Gaule, Ve siècle après
J.-C., Catalogue de l’exposition du Musée des Antiquités nationales,
château de Saint-Germain-en–Laye, 26 septembre 2000-8 janvier 2001,
Poitiers, diff. Seuil, 2000, 224 p.
Palol
(de)(Pedro), Ripoll (Gisela), Les
Goths. Ostrogoths et Wisigoths en Occident, Madrid, éd. Seuil, 1990, 323
p.
Peigné-Delacour (Achille),
Recherches sur le lieu de la bataille
d’Attila en 451, Paris, 1860.
Peigné-Delacour (Achille),
Supplément aux recherches sur le lieu
de la bataille d’Attila en 451, Troyes, 1866.
Sommer
(Markus), Die Gürtel und Gürtelbeschläge des 4 und 5
Jahrhunderts in Römischen Reich, Bonn, 1984.
Maurice
Scellès s’étonne que l’on qualifie de « fouilles anciennes »
des fouilles réalisées à la fin des années 1980, et il se dit surpris que
l’on ne soit pas en mesure de retrouver ces objets, et plus encore que la pièce
d’orfèvrerie à grenats n’ait pas été déposée dans un musée,
alors même que le Musée Saint-Raymond recevait un colloque international et
organisait une exposition sur ce thème.
Jean-Luc
Boudartchouk et Henri Molet expliquent qu’à Toulouse l’archéologie en était
en effet à ce stade à la fin des années 1980. Les modalités
d’enregistrement et de conditionnement des objets archéologiques étaient
bien différentes d’aujourd’hui. Hélène Guiraud rappelle que l’objectif
assigné aux fouilles du site de Larrey était évidemment celui de la fouille
du rempart romain.
Répondant
à une question de Frédéric Veyssière, Jean-Luc Boudartchouk confirme qu’il
s’agit bien de grenats et non de verre, qui ne sera utilisé que plus tard et
pas pour ce genre d’objet.
Patrice
Cabau apporte quelques informations sur la restauration du rempart le long du
boulevard Duportal. Toute la partie bordant le site de l’Université est
terminée et l’on vient de commencer celle de la cité administrative. On est
donc assuré d’avoir au final un ensemble à peu près cohérent et l’on ne
peut que se féliciter que la face externe du rempart retrouve ainsi une
certaine apparence. En remarquant que l’investigation scientifique a été
plus que minimale, Guy Ahlsell de Toulza conclut à un bilan plutôt positif, ou
tout au moins un satisfecit de raison.
SÉANCE DU 1er AVRIL 2008
Présents : Mme
Pradalier-Schlumberger, Présidente, M. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Mme Suau,
Bibliothécaire-Archiviste, MM. Latour, Bibliothécaire-adjoint, Scellès, Secrétaire
général, Cabau, Secrétaire-adjoint ; Mmes Watin-Grandchamp, Cazes, le Père
Montagnes, MM. Bordes, Roquebert, Testard, membres titulaires ; Mmes
Barber, Guiraud, Haruna-Czaplicki, MM. Lassure, Macé, Mattalia, membres
correspondants.
Excusés : M. Cazes,
Directeur ; Mme Cazes, membre titulaire.
Invités : Mlle Émilie
Nadal, M. Czaplicki.
La Présidente
ouvre la séance à 17 heures. Louis Latour
communique une demande d’information reçue par courriel, émanée d’un étudiant
parisien, concernant la « réutilisation de structures mégalithiques pré
et protohistoriques au Moyen-Âge en France ». Puis il annonce le décès
de Roger Armengaud, dont les obsèques ont été célébrées le jeudi 27 mars
dernier à Cintegabelle. Cet érudit fut lauréat de notre Société ; le
manuscrit intégral de son travail sur l’abbaye de Boulbonne se trouve déposé
aux Archives départementales de la Haute-Garonne (série J).
Michèle
Pradalier-Schlumberger rend compte ensuite de la correspondance manuscrite et
imprimée :
- une
invitation reçue de M. Jean-Pierre Amalric à assister à la journée d’étude
que la Fédération historique de Midi-Pyrénées organise le 7 juin 2008 au château
de Laréole ;
- le rapport
soumis en novembre 2007 par M. Bernard Voinchet, Architecte en Chef des
Monuments Historiques, en vue de la poursuite de la restauration du théâtre
antique de Saint-Bertrand-de-Comminges ;
- le
catalogue de l’exposition « Enquêtes en sous-sol / en quête du Passé »
consacrée à l’archéologie en Tarn-et-Garonne (Montauban, 2008).
Nous avons également reçu un message électronique envoyé
par M. René Souriac, Président de la Société des Études du Comminges, faisant
état du projet catastrophique de l’ouverture d’une carrière industrielle à
Montmaurin. La Présidente propose que notre Société soutienne la motion
présentée par la Société des Études du Comminges :
Motion.
Pour
la sauvegarde de l'intégrité d’un site naturel et archéologique majeur :
les
gorges de la Seygouade et de la Save à Montmaurin-Lespugue
Les
gorges de la Save à Lespugue et celles de la Seygouade à Montmaurin sont un
des hauts lieux du patrimoine archéologique européen: la « mâchoire de
Montmaurin » datée de 600 000 ans est un des plus vieux restes humains de
la France. Avec la « Vénus de Lespugue » (paléolithique supérieur)
elle figure dans tous les ouvrages mondiaux d'archéologie comme document de référence
pour la connaissance de l'histoire de l'évolution humaine.
L'intérêt
des lieux ne se limite pas au site de Coupe-Gorge et à la grotte des Rideaux :
l'environnement immédiat, à savoir le petit interfluve de 3 kilomètres sur 1
kilomètre qui s'étire entre Save et Seygouade est composé du même calcaire
que les sites préhistoriques et est donc potentiellement riche en restes préhistoriques.
On y trouve, de plus, des sites médiévaux et l'ensemble est à proximité immédiate
de la villa gallo-romaine de Montmaurin.
Ce
site interfluve est, de plus, classé en ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique,
faunistique et floristique) pour l'originalité et la rareté de certaines
composantes de sa couverture végétale, et aussi en raison de la présence
d’espèces rares en de tels lieux comme la genette.
Le
projet de création d'une carrière industrielle impliquerait la destruction
d'un milieu contenant des vestiges précieux pour la connaissance de l'histoire
de l'évolution humaine. Cette carrière détruirait également un environnement
naturel dont la qualité patrimoniale du site a absolument besoin : elle le
défigurerait irrémédiablement. Son exploitation
est donc incompatible avec la nécessaire protection de cet ensemble
unique qui, du Pithécanthrope à l'Homme moderne, fait partie du patrimoine de
l'Humanité.
Les
promoteurs de cette motion forment au contraire le vœu qu’en lieu et place
d’une carrière, soit mis en œuvre un projet de développement culturel,
patrimonial et touristique dont les retombées économiques pourront être de
grande importance pour cette zone.
Société
des Études du Comminges (Saint Gaudens)
Nature Comminges (Saint Gaudens)
Société Méridionale de Spéléologie et de Préhistoire (Toulouse)
Coordination Environnementale Comminges (8 associations)
Avec
le soutien de :
André Clottes, Conservateur Général du patrimoine, Paris ; Henri
de Lumley, Directeur de l'Institut de Paléontologie Humaine, Paris ; Michel
Girard, Palynologue. C.N.R.S. Paris
; Bruno
Maureille, CNRS. Laboratoire d'anthropologie, Bordeaux,
Josette
Renault-Miskovsky ; Palynologue, Institut de Paléontologie Humaine, Paris.
Afin d'éclairer le lecteur, nous y joignons la Note sur le péril
que pourrait constituer la mise en œuvre d’un projet de carrière à haut
rendement sur la commune de Montmaurin, adressée à notre Société par
notre consœur Agnès Marin :
Depuis
quelques mois, l’association Adaq-Vie Save-Gesse (association de défense et
de l’amélioration de la qualité de vie en vallées de Save et de Gesse)
tente d’alerter les citoyens, l’administration et la communauté
scientifique sur le péril que pourrait constituer la mise en œuvre d’un
projet de carrière à haut rendement sur la commune de Montmaurin.
Mise en
contact avec plusieurs de ses membres, une visite du site m’a convaincue
sans peine de la légitimité de leur inquiétude et de leur protestation à
l’égard de ce projet. Je me permets donc de vous adresser cette note,
accompagnée de quelques documents iconographiques, qui, en complément du
courrier communiqué à ce propos par Stéphane Fargeot (membre Adacq-Vie) au
début du mois d’avril dernier, vous permettra, je l’espère, d’évaluer
au mieux l’envergure du gâchis annoncé et de prendre les mesures les mieux
adaptées pour contribuer à en éviter l’accomplissement.
Le
contexte
Au cœur
du Nébouzan en Haute-Garonne, le village de Montmaurin est une bastide fondée
au début du XIVe siècle, peut-être sur un lieu d’occupation préexistante
(1). Il se situe à 380 m d’altitude, sur le plateau triangulaire de
calcaire crétacé dominant les gorges de la Seygouage à l’ouest et de la
Save à l’est. Sa notoriété est toujours principalement liée à la villa
gallo-romaine découverte dès la fin du XIXe siècle (2), et
fouillée de manière méthodique de 1947 à 1962 par Georges Fouet. Ses
vestiges classés Monument Historique depuis 1949, et actuellement gérés par
Monum, continuent d’attirer de nombreux touristes et spécialistes
internationaux, au mépris des autres nombreux sites archéologiques du
secteur, ignorés faute de mise en valeur.
Présence
abondante de l’eau, configuration géologique à dominante karstique propice
à la formation de grottes naturelles et d’abris sous roche, richesse
naturelle du terroir, faibles altitudes et reliefs collinaires démultipliant
les types de biotopes, comptent parmi les nombreux facteurs favorables à
l’installation humaine : du paléolithique inférieur au bas Moyen Âge,
la quasi-totalité des périodes préhistoriques et historiques est représentée
par une trentaine de sites répertoriés à ce jour sur la commune de
Montmaurin, et la partie limitrophe de la commune de Lespugue.
Le
nouveau projet de carrière
L’ouverture
d’une carrière de calcaire assortie de l’installation d’une usine de
criblage concassage a fait l’objet d’une enquête publique au printemps
2008. Cette exploitation serait implantée en bordure des gorges de la
Seygouade, sur le plateau dit « bois de la Hage », en référence
à la hêtraie qui le recouvre actuellement. Elle vise un débit annuel de 200 000
tonnes de matériaux par an, moyennant la mise en œuvre de charges explosives
de 2000 kilos. L’installation couvrira 8 hectares, et prévoit
l’extraction du calcaire sur une surface d’environ 5 hectares
, pendant une durée de trente ans, selon les termes de la convention signée
en février entre la municipalité de Montmaurin et la S.A.R.L. « Dragage
Garonnais », implantée de longue date sur le territoire de la commune.
Il s’agit non d’une création, mais de la réouverture d’une carrière
exploitée jusqu’en 1964, dont on aperçoit le front de taille depuis la
route départementale D633.
Au vu du
potentiel archéologique que présente cette zone d’exploitation, et conformément
à la procédure réglementaire, un arrêté de prescription de diagnostic
archéologique a été émis par le conservateur régional de l’archéologie,
en date du 17 janvier 2008. Des informations officieuses suggèrent
que le montage de l’opération de diagnostic confié à l’I.N.R.A.P. est
en cours, et on sait par ailleurs que l’entreprise « Dragage Garonnais »
est sur le point de commencer le défrichage des parties concernées, en dépit
des vives protestations émises par l’U.M.I.N.A.T.E. (Union Midi-Pyrénées
Nature et Environnement) qui rappelle que la zone concernée est classée
Z.N.I.E.F.F. type 1 (zone naturelle d’intérêt écologique, et faunistique
et floristique) (3).
Les
dommages déjà subis par l’exploitation intensive du calcaire local
De fait,
ce projet de carrière implique une nouvelle atteinte à l’intégrité du
territoire de la commune de Montmaurin, d’une richesse naturelle et
culturelle exceptionnelle qui n’a déjà que trop souffert des déprédations
irréversibles que provoque l’exploitation industrielle du calcaire.
Rappelons à ce titre que ce nouveau lieu d’exploitation est suscité par le
non renouvellement d’une concession établie à moins d’un kilomètre plus
au sud, le long du rebord ouest des gorges de la Seygouade (carrière
Coupe-Gorge). L’abandon forcé de ce site en activité depuis l’après-guerre,
à l’emplacement d’une zone où se concentre pourtant un nombre important
de gisements préhistoriques des plus fameux, dont quatre classés depuis 1949
(4), aurait été suscitée par le Service des Monuments Historiques, selon le
témoignage de Monsieur Gaspin, maire de Montmaurin, rapporté dans un article
de La Dépêche du Midi du 14 mars dernier. Quiconque s’aventure
aujourd’hui sur cette aire d’exploitation où la végétation reprend ses
droits, peut évaluer l’impact de cette industrie, et le paysage de désolation
qu’elle laisse impunément après son passage.
Quant aux
destructions inévitables de gisements, le témoignage de Josette Renault Miskovsky (5) et Michel Girard (6) est à ce titre édifiant.
Ces chercheurs rapportent, qu’en 1969, « lors de la préparation de la
visite du Congrès international de l’Union internationale des sciences préhistoriques
et protohistoriques, Messieurs Louis Méroc (alors Directeur de la
circonscription archéologique de Midi-Pyrénées), Georges Simonet (assistant
à cette circonscription), Jacques Aubinel, Christian Servelle et Michel
Girard, avaient assisté, atterrés, aux tirs de mine qui détruisaient irrémédiablement
la zone entourant l’ensemble des grottes préhistoriques. Plusieurs petites
cavernes emplies d’ossement avaient d’ailleurs été éventrées sous nos
yeux par ces explosions sans que l’on puisse intervenir ni pouvoir collecter
quoi que ce soit » (7).
Si à Montmaurin, comme en bien d’autres
endroits, c’est précisément l’ouverture de carrières qui a permis la
mise au jour de vestiges d’une valeur documentaire insoupçonnée (8), ces découvertes
fortuites appartiennent à une époque révolue où les techniques
d’exploitation étaient infiniment moins puissantes et où la vigilance et
la perspicacité des archéologues amateurs œuvraient encore sur le terrain.
À l’opposé oriental du secteur d’interfluve,
les gorges de la Save, tout aussi riches de gisements importants, et au
calcaire tout aussi convoité par les carriers depuis le début du XXe
siècle, a également subi des destructions liées à l’exploitation des
carrières, tel celle de « l’abri de la Save », reconnu en 1911.
Le site
directement menacé par la nouvelle carrière : le site du château de
Roquebrune
Le secteur
concerné par l’exploitation est situé au nord-ouest du village actuel, sur
la rive est de la Seygouade, à moins d’un kilomètre au nord de
l’ancienne exploitation des « Dragages Garonnais » interrompue
depuis juillet 2007. Il est désigné par diverses appellations :
mentionné sur la carte IGN sous le terme de « bois de la Hage »
et, plus au nord, lieu-dit « Roquebrune », on l’appelle aussi
localement « Coume Day Hourquat et Causere » ou carrière Dufau,
du nom de l’entreprise qui en avait commencé l’exploitation. L’arrêté
de diagnostic du S.R.A. cite le toponyme de « Le Castet », que
nous n’avons retrouvé nulle part mentionné, mais qui a le mérite d’être
explicite. Paradoxalement, la présentation du site qu’en fait ce texte ne
fait allusion qu’à « des indices d’occupation historique sur le
rebord du plateau, communiqués récemment et qui demandent à être confirmés ».
Cette
implantation est pourtant incontestable, même si elle est à ce jour peu
connue. La maîtrise de Frédérique Gellis, Inventaire historique et archéologique
des mottes castrales et des fortifications de terre du canton de
Boulogne-sur-Gesse (31), soutenue en 1999 à l’Université de Toulouse
(9), rappelle l’existence en ce lieu d’un château médiéval dit « de
Roquebrune » dont les ruines avaient été observées par l’abbé
Couret, qui en fit une courte description au début du XXe siècle,
et confirmée par Georges Fouet en 1974, témoignages malheureusement dépourvus
de documentation iconographique. Les pans de murs les plus accessibles qui
subsistent encore, situés en partie centrale de la zone d’exploitation, ont
été relevés il y a quelques semaines par Stéphane Fargeot, membre de
l’association Adacq-Vie (10).
L’étude
de l’histoire médiévale du terroir de Montmaurin demeure toujours délaissée,
peut-être occultée par le prestige des sites préhistoriques et antiques qui
en ont fait la renommée. L’état de la bibliographie concernant cette période
le montre bien. À notre connaissance, hormis une évocation de Montmaurin à
la fin du Moyen Âge et sous l’Ancien Régime (11), il n’existe aucune
monographie approfondie concernant la genèse et l’évolution de
l’occupation du sol après la période antique. Les sept pages consacrées
à la commune dans le travail d’inventaire thématique de Frédérique
Gellis constituent donc un précieux état de la question (12) : le
caractère elliptique de l’esquisse historique fait d’autant mieux
ressortir l’absence d’élaboration claire des problématiques, inhérente
à la pauvreté des sources et aux lacunes de la recherche de terrain.
Les données
concernant le château de Roquebrune, identifiable aux vestiges menacés par
la carrière, sont très succinctes. L’édifice était déjà trop en ruine
au XVIIIe siècle pour figurer sur la carte de Cassini, et la dernière
mention recensée s’y rapportant ne remonte qu’à 1343. Il a pu relever du
fief très peu documenté des seigneurs de Mirepoix, qui semblait commander
une partie des terroirs dits de la Hage, Roquebrune et Bacuran (13). Ce fief
était dans la mouvance des domaines commingeois avant 1270, et intégra la châtellenie
fuxéenne de Saint-Plancard à partir du dernier tiers du XIIIe siècle,
seigneurie à l’origine de la création de la bastide de Montmaurin. Des
prospections récentes ont mis en évidence l’intensité de l’occupation médiévale
du site, et la possible existence d’un village associé, probablement
abandonné au profit des bastides de Montmaurin et Blajan au cours du XIVe
siècle.
Ces
vestiges, voués à la destruction si le projet de carrière se concrétisait,
sont donc probablement d’une grande importance pour la compréhension de
l’évolution de l’habitat groupé du secteur, antérieur à la création
de la bastide. Il faudrait pouvoir les mettre en relation avec les quatre
autres sites médiévaux attestés à ce jour, hors la bastide, soit :
- la
motte de Mirepoix d’en-bas, postée sur un petit éperon bordant le
ravin formé par le creusement des gorges de la Save, très endommagé, avec
fossé et enclos oblong associé. Positionnée en face de la place forte
importante de Lespugue, et en contrebas du château de Roquebrune, ce tertre
avait capacité de surveiller les allées et venues sur la Save et sur le
chemin important qui parcourait le plateau de Bacuran. Des indices ténus qui
demanderaient confirmation, suggèrent à Frédérique Gellis que cette
fortification était un pôle auxiliaire du castrum de Roquebrune.
Sur le
seul territoire de la commune, deux autres fortifications de terre, longtemps
assimilés à des tumuli, oppidum, ou camps romains, ont pu être
identifiés à des mottes féodales de grandes envergures par Frédérique
Gellis, mais qu’aucune source ne documente :
- celle
du lieu-dit La Motte, aujourd’hui en partie détruite, de 70, 90 et 30 m
de côté, qui comportait des fossés, un retranchement couronné d’un
parapet, et qui commandait l’entrée des gorges de la Save.
- la
motte d’Esclignac, également fossoyée, et défendue par un rempart de
45 m de long, 5 m de large, et 2,50 m de haut, et probablement accostée
d’un enclos attenant (lieu-dit Clot de la Penne). Des prospections ont révélé
un matériel abondant (sondages anciens), mais la structure a été en partie
détruite par une exploitation agricole.
Enfin,
l’implantation religieuse représenté par l’ancienne église
paroissiale Notre-Dame de la Hillière, située à l’entrée
des gorges de la Save, ne semble pas avoir attiré d’habitat en dépit d’une remarquable pérennité
d’occupation : fondée à proximité d’une fontaine probablement vénérée
dès la protohistoire, lieu de pèlerinage important au cours du Moyen Âge,
le sanctuaire chrétien a succédé à des thermes gallo-romains, accompagnés
d’un petit temple de plan basilical peut-être voué à la déesse Tutela
et d’un marché couvert, ensemble détruit vers le milieu du IVe
siècle, comme la villa. Deux temples furent ensuite reconstruits, l’un
hexagonal et l’autre basilical (la datation de ces structures n’est pas précisée).
Des sépultures mérovingiennes retrouvées au cours des fouilles des thermes
montrent que le site continua d’être occupé durant le Haut Moyen Âge.
Puis, trois églises se succédèrent à l’emplacement de la chapelle
actuelle, dont la construction est moderne pour l’essentiel.
L’énumération
de ces sites repérés, qui demeurent très insuffisamment étudiés et qui
demanderaient à être replacés dans le contexte plus large de l’histoire
mouvementée des comtés de Foix et d’Armagnac, laisse pressentir une
complexité que l’indigence des sources ne facilite pas à appréhender.
Toutefois, la densité et la fragmentation des points d’ancrage de
l’occupation médiévale du territoire de la commune suggèrent un riche
potentiel de recherche pour le Moyen Âge, pour lequel le site du « Castet »,
directement menacé, constitue probablement un maillon important. Quand bien même
une opération de fouille serait programmée à l’issue d’un diagnostic
qui ne saurait être négatif (14), l’ampleur et la complexité des
recherches que ce site susciterait dans une perspective scientifique digne de
ce nom, et par là, le coût qu’une telle opération pourrait engendrer,
sont des arguments qui pourraient peut-être suffire à dissuader l’aménageur
de poursuivre son projet d’implantation : encore aurait-il fallu que
cette donnée du territoire visé par l’aménagement ait été perçue
d’emblée par les divers services de l’administration.
Un
contexte géomorphologique propice aux gisements d’époque préhistorique
Nous
l’avons déjà évoqué, le secteur d’interfluve Seygouade-Save constitue
en outre un foyer d’une richesse peu commune pour la recherche préhistorique.
Une trentaine de sites y ont été repérés depuis la fin du XIXe
siècle, qui témoignent d’une intensité et d’une continuité
remarquables de l’occupation humaine depuis le paléolithique inférieur. On
ne retient trop souvent que la mâchoire à caractère néandertalien de la
grotte de « la Niche » trouvée par un archéologue amateur, Raoul
Cammas, peu de temps après l’ouverture de la carrière « Coupe-Gorge »
bordant l’entrée des gorges de la Seygouade, à peine
1 km
au sud de la carrière qu’on se propose d’exploiter de nouveau. Confiée
à Louis Méroc, alors Directeur des Antiquités préhistoriques, puis à
Henri de Lumelay, cette mandibule, conservée aujourd’hui au Musée de
l’Homme, a longtemps été considérée comme un des plus anciens fossiles
humains trouvés sur le territoire français avec celui de Tautavel (15).
Cette découverte a immédiatement entraîné, dès 1949, le classement du
site, et de trois autres grottes situées à proximité (16), en un secteur où
se concentrait plus d’une dizaine de gisements aux séquences parfois très
étendues, et le plus souvent multiples : Coupe-Gorge, pour ne citer que
cette cavité fameuse fouillée par Louis Méroc, contient trois niveaux
d’occupation :
la couche supérieure est Néolithique, superposée à un niveau peu épais
Aurignacien et Magdalénien, lui-même recouvrant une couche de 6 m d'épaisseur
correspondant à la fin de l'Acheuléen et au début du Moustérien.
Ces sites, dont certains avaient déjà été repérés et fouillés dans
les années 1920, ont livré un matériel lithique extrêmement abondant et
diversifié, mais aussi un riche ensemble de fossiles animaux du Würm (ursidés,
cervidés, canidés, machairodus -chat-tigre aux dents de sabre-, rhinocéros
mercki…), ensemble conservé à l’Institut du Quaternaire à Bordeaux où
il a été étudié (17). À la fin des années 1990, des études
palynologiques ont en outre pu être mises en corrélation avec tous ces
stades d’occupation, complétant les connaissances du climat, du paléo-environnement
et de leurs évolutions et affinant l’appréhension du cadre de vie de ces
populations (18).
À l’opposé oriental du site menacé, la même densité d’occupation a pu être
constatée, tout le long des gorges de la Save, avec une particulière
concentration de gisements du paléolithique supérieur, fouillés surtout
dans les années 1920 par René de Saint-Périer ; la Vénus de Lespugue
reste sa découverte la plus connue et prestigieuse, qui ne doit pas
dissimuler l’importance des collections de production lithique (solutréennes,
gravettiennes, aurignaciennes) qu’il a réunies, et qui continuent d’être
étudiées (19).
Pour étayer
de manière constructive l’opposition au projet de carrière, Isaure
Gratacos, ethnologue membre de l’association Adaq-Vie et Daniel Quettier de
la société méridionale de Spéléologie et de préhistoire ont pratiqué ce
printemps une prospection géomorphologique de l’interfluve Save-Seygouade
(20), qui montre que l’emprise prévue de la future carrière couvre un
ensemble karstifié en tous points identique à celui qui caractérise les
grottes et abris de Coupe-Gorge, ce qui ne saurait surprendre puisque ce
nouveau site s’attaque aux mêmes couches de calcaire Danien, à des
altitudes identiques et façonné par le même système hydrologique. Le front
de l’ancienne carrière abandonnée présente une coupe d’où il est aisé
d’observer les résultats des mêmes phénomènes de glissement de sédiments
propre aux formations karstiques, et qui rendent particulièrement délicats
les investigations rigoureuses qu’impose une recherche archéologique
scientifique. Or, comme le souligne Louis Raymond, membre de la Société préhistorique
française, « l’extrême densité déjà reconnue sur cette zone réduite
de l’interfluve révèle qu’il y a eu, à cet endroit privilégié, des
conditions particulières qui ont attiré les hommes pendant toutes les époques
de la préhistoire. Si beaucoup de gisements ont été découverts, il est
illusoire de croire qu’il n’en existe plus à découvrir » (21).
Enfin, comme le fait aussi remarquer pertinemment Louis Raymond, il faut
souligner que les sites préhistoriques de Montmaurin et Lespugue ont été
fouillés pour la plupart il y a plus de 50 ans : les sites restés
intacts et inédits sont autant de réserves où les archéologues du futur
pourront mettre en œuvre des techniques d’investigation et d’analyse à même
de compléter utilement le matériel déjà collecté dans des conditions qui
ne répondent plus aux exigences de précision de la recherche actuelle.

Le site de la carrière de Coupe-Gorge.
|

Localisation et emprise de la carrière projetée. |
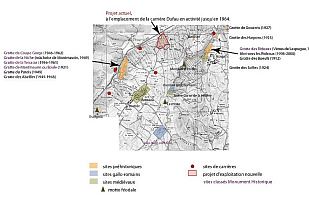
Répartition des principaux sites connus à ce jour sur la commune
de Montmaurin et la partie limitrophe de la commune de Lespugue.
|

Colline du Bois de la Hage depuis l'ouest, et front de taille de
l'ancienne carrière Dufau d'où repartirait l'exploitation
prévue.
|
Des
craintes peuvent donc être légitimement formulées quand à la pertinence
des méthodes d’investigation préconisées selon la procédure normale,
soit une phase de diagnostic : quelque puisse être le soin avec lequel
elle sera menée (22), on peut douter qu’elle soit en mesure d’écarter
tout risque de découvertes fortuites en cours d’exploitation, voire de
destruction de nouveaux sites majeurs sans même que quiconque s’en aperçoive.
À ce propos, l’intensité de l’occupation d’époque paléolithique supérieur
permet à Louis Raymond d’évoquer la possibilité de l’existence de
grottes ornées dont les accès ont pu être obstrués naturellement comme
c’est très souvent le cas, et qu’il serait désastreux de voir éventrées
par un tir de mine... Au vu de la complexité du contexte géomorphologique et
de l’étendue des périodes susceptibles d’être représentées par des
vestiges de nature très diverse, le risque est grand que l’opération de
fouilles qui devrait logiquement être prescrite après le diagnostic se
heurte à un degré de complexité qui nécessiteraient des besoins
logistiques, scientifiques et humains d’un coût et d’une durée démesurés
pour un tel aménagement. Au-delà des arguments humanistes en faveur de la défense
du patrimoine culturel et naturel, c’est là probablement un atout de poids
pour la sauvegarde de ce site et de son intégrité. Il conviendrait de le
souligner avant que les travaux de défrichements qui vont commencer de le dénaturer
ne soient entrepris…
Le dilemme
auquel est confrontée la commune de Montmaurin est donc simple :
Soit,
comme le propose la maire du village, elle s’engage à perpétuer une
tradition d’origine bien récente à l’aune des vestiges immémoriaux
qu’elle conserve, et qui, selon ses propres termes, voue le territoire de la
commune depuis l’après guerre à l’exploitation industrielle de ses bans
calcaires très convoités, au détriment du cadre de vie et de la
conservation d’un patrimoine d’une richesse méprisée à force
d’ignorance.
Soit,
comme l’envisage l’association Adaq-Vie soutenue par des citoyens locaux
de plus en plus nombreux, de mettre à profit cette crise salutaire pour enfin
entreprendre, en concertation avec les municipalités voisines et l’aide des
services territoriaux, une réflexion globale sur les possibilités de protéger
et mettre en valeur ce patrimoine culturel et naturel trop longtemps délaissé.
Dans cette perspective, une procédure de classement au patrimoine mondial est
sérieusement envisagée, accompagnée d’un travail intense de communication
et de sensibilisation des citoyens, dont le devoir est de se réapproprier la
connaissance et la maîtrise du devenir des richesses de son terroir.
Agnès MARIN, archéologue, membre correspondant
1.
Frédérique GELLIS, Inventaire historique et archéologique des mottes
castrales et des fortifications de terre du canton de Boulogne-sur-Gesse (31),
mémoire de maîtrise dirigée par Sylvie Faravel, Université de Toulouse-Le
Mirail, 1999, vol. 1, p. 154-155.
2.
Pour l’anecdote, rappelons que c’est en séance de la Société archéologique
du Midi de la France qu’a été révélé un des premiers témoignages de sa
découverte par le préhistorien Louis Lartet après une visite des lieux que
commençait à dégager l’abbé Couret, en juin 1880.
3.
«Le site est recouvert d’une chênaie et hêtraie qui abrite des espèces
rares, lys martagon, aspérule odorante, des zones de pelouse sèche propices
au développement d’une flore spécifique, dont certaines variétés rares
d’orchidées (orchis singe, orchis militaire et ophris araignée), et enfin,
une faune spécifique aux zones préservées : oiseaux rupicoles tel le
cincle plongeur, escargots de Bourgogne, colonies de chiroptère dans les
grottes, auxquels il faut ajouter la présence d’espèces devenues rares en
plaine, telle que la genette. Informations tirées de la lettre adressée
par Rémy Martin, président de l’U.M.I.N.A.T.E., au commissaire enquêteur
le 16 avril 2008.
4.
Grottes dite « de la Niche» où fut trouvée la mâchoire néanderthalienne
en 1949, grotte de « Coupe-Gorge », « La Terrasse »,
et « Montmaurin » ou « Boule ».
5.
Palynologue, Directeur de Recherche émérite au
Centre National de la Recherche Scientifique, Département de Préhistoire du
Muséum National Histoire Naturelle. Institut de Paléontologie Humaine,
Paris.
6.
Palynologue. Chercheur associé au Centre d’Études :
Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge, Centre National de la Recherche
Scientifique, Valbonne (Alpes-Maritimes).
7.
Extrait de la lettre de soutien que ces chercheurs ont adressé à
l’association Adaq-Vie Save-Gesse.
8.
C’est précisément dans ce contexte que la mâchoire de Montmaurin a été
découverte, par Raoul Cammas en 1949, les fouilles du gisement ayant été
confiée ensuite à Louis Méroc. De même pour les gisements de la vallée de
la Save, pour l’essentiel explorés et étudiés par le docteur René de
Saint-Périer dans les années 1920-1930, inventeur de la Vénus de Lespugue.
9.
Travail mené sous la direction conjointe de Sylvie Faravel et Gérard Pradalié,
qui nous a confirmé la véracité du témoignage de son étudiante, vérifiée
sur le terrain.
10.
Intégré au dossier « Montmaurin » conçu par la Société études
recherches du Nébouzan, 40 p., printemps 2008.
11. G.-P. SOUVERVILLE, « Montmaurin, du bas Moyen-Âge à l’Ancien Régime »,
Revue du Nébouzan, 1997, p. 80-94.
12.
Voir aussi Frédérique GELLIS, « Les mottes castrales du canton de
Boulogne sur Gesse », Archéo en Savès, 17, 2000, p. 86-90.
13.
La mention la plus ancienne relative au toponyme de Roquebrune remonte à la
fin du XIIe siècle, dans un acte faisant état d’un don d’une
partie de la forêt de Roquebrune par Enderande, seigneur de l’Isle-Toupière,
à l’abbaye cistercienne voisine de Nizors, don renouvelé et accru au début
du XIIIe siècle par un descendant.
14.
On s’étonne que l’arrêté de diagnostic prescrive une équipe
d’intervention constituée d’un paléolithicien secondé étroitement par
un sédimentologue/karstologue, reléguant à un rôle de participation un médiéviste
associé (arrêté de prescription, p. 3).
15.
Les études récentes en ont considérablement rajeuni l’âge, le fossile
ayant été reclassé de la catégorie des pré-néandertaliens anciens (400 000
à 300 000 ans) au néandertalien ancien, environ 130 000 ans.
16.
Grottes de « Coupe-Gorge », « La Terrasse », et
« Montmaurin » ou « Boule ».
17.
J.-L.
GUADELLI, « Quelques données sur
la faune de Coupe-Gorge à Montmaurin (Haute-Garonne, France) », Société
des amis du Musée national de préhistoire et de la recherche archéologique,
Les Eyzies de Tayac-Sireuil, 1990, n° 2, p. 107-126.
18.
J. RENAULT-MISKOVSKY, M. GIRARD, J. GAUDEY, « Palynologie des grottes de
Montmaurin (Haute-Garonne) et du versant nord pyrénéen : corrélations
interséquencielles du pléistocène moyen à l’holocène », (la
Niche, le Coupe-Gorge, les Abeilles, le Putois IV), Colloque Q2 N° 2,
Orléans, France (29/04/1997), 1998, vol. 9, n° 3 (106
p.) (1 p.1/4) et M.
GIRARD, J. GAUDEY, J. RENAULT-MISKOVSKY,
« Analyse pollinique du remplissage de la Grotte des Abeilles
(Montmaurin, Haute-Garonne) », Bulletin de la Société préhistorique
de l'Ariège, 1997, vol. 52, p. 137-146.
19.
P. FOUCHET, C. SAN JUAN, « Les industries solutréennes de l’abri des
Harpons et de la grotte des Rideaux à Lespugue. Collection Perier des musées
de Lespugue et de Saint-Gaudens », Bulletin de la société préhistorique
de l’Ariège, vol. 55, 2000, p. 27-33.
20.
I. GRATACOS, D. QUETTIER, L’interfluve ave-Seygouade, un haut lieu de
l’histoire de l’humanité, étude de terrain réalisée en mars avril
2008, Adaq-Vie, Save-Gesse, 13 p.
21.
Lettre de Louis Raymond, membre de la Société préhistorique française
depuis 1958, adressée au commissaire enquêteur le 7 avril 2008.
22.
Voir « principes méthodologiques » dans l’arrêté de
prescription, p. 2 et 3.
La parole
est à notre Hiromi Haruna-Czaplicki pour la communication du jour :
La décoration des livres de Bernard de Castanet et l’enluminure
toulousaine vers 1300, publiée dans ce volume (t. LXVIII,
2008) de nos Mémoires.
La Présidente
remercie Mme Haruna-Czaplicki pour sa présentation très synthétique de ce
groupe de manuscrits, puis elle fait appel aux questions.
Lisa Barber
s’intéresse à la palette utilisée par le ou les enlumineurs. Hiromi
Haruna-Czaplicki souligne l’importance primordiale des couleurs, mais elle
indique les difficultés rencontrées pour les étudier : on ne dispose pas
simultanément de plusieurs manuscrits que l’on voudrait comparer, et certains
ouvrages doivent être examinés d’après des reproductions photographiques.
François
Bordes note que le corpus analysé, déjà assez large, pourrait s’enrichir du
Livre blanc de Toulouse, réalisé à partir de 1295 par l’école
d’enluminure toulousaine.
Dominique
Watin-Grandchamp s’étonne que la commande ait eu lieu du temps de l’épiscopat
de Bernard de Castanet à Albi (1276-1308). François Bordes et Bernadette Suau
rappellent le caractère itinérant de l’école toulousaine, qui se déplaçait
chez les grands commanditaires. Mme Haruna-Czaplicki insiste sur le fait qu’il
n’y avait pas de rivalité entre Toulouse et Albi, mais une complémentarité,
comme entre Toulouse et Avignon.
Maurice
Scellès voudrait en savoir davantage sur la composition et l’organisation de
l’atelier toulousain d’enluminure. Hiromi Haruna-Czaplicki répond qu’il
est évidemment très difficile de connaître la structure de ce groupe. On peut
observer que les manuscrits décorés appartiennent à différents domaines :
littéraire, juridique, liturgique…
M. Scellès
demande si l’on possède des statuts de métier pour les enlumineurs
toulousains. M. Bordes dit ne pas en connaître avant la fin du XVe
siècle. Guy Ahlsell de Toulza précise qu’il y avait une douzaine
d’enlumineurs à Paris à la fin du règne de Philippe le Bel.
Pour
terminer, Mme Haruna-Czaplicki, se fondant sur l’origine des manuscrits qui
ont servi de source pour les copies de plusieurs textes, l’abbaye de Moissac,
déclare s’intéresser particulièrement aux liens qui ont pu exister entre
Bernard de Castanet et les abbés de Moissac Bertrand de Montaigut (1260-1295)
ou Guillaume de Durfort (1295-1306).
Le Secrétaire
général donne lecture d’un amendement au procès-verbal de la séance du 4
mars, amendement qui est accepté. Il lit ensuite le compte
rendu de la séance du 5 février, adopté également.
Au titre des
questions diverses, Mme Watin-Grandchamp montre une série de diapositives représentant
les chapiteaux romans qui ornent l’arc triomphal de l’église de Peyregoux,
au nord de Castres. Ces deux pièces lui posent problème et elle désirerait
connaître l’opinion des spécialistes. De l’échange de vues qui s’ensuit
entre Michèle Pradalier-Schlumberger, Maurice Scellès, Guy Ahlsell de Toulza
et Jean-Michel Lassure, il ressort que ces chapiteaux, taillés dans un beau
calcaire, sont de « belles œuvres » procédant de l’interprétation
des grands modèles (Saint-Sernin…) et qu’elles furent réalisées
certainement dans la seconde moitié du XIIe
siècle.
À propos de
sculpture romane, M. Ahlsell de Toulza signale la présence à Berne, à la
Fondation Abegg, de deux chapiteaux provenant de l’ancienne cathédrale
d’Albi.
SÉANCE DU 29
AVRIL 2008
Présents : Mme
Pradalier-Schlumberger, Présidente, MM. Cazes, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier,
Scellès, Secrétaire général, Mme Suau, Bibliothécaire-Archiviste, MM.
Cabau, Secrétaire-adjoint, Latour, Bibliothécaire-adjoint ; Mmes Bayle,
Cazes, Napoléone, MM. Bordes, Boudartchouk, Lassure, le Père Montagnes, MM.
Roquebert, Testard, membres titulaires ; Mmes Barber, de Barrau, Guiraud,
Haruna-Czaplicki, MM. Capus, Darles, Geneviève, Laurière, Molet, Veyssière,
membres correspondants.
Excusés : Mme Cazes, MM.
Barber, Peyrusse, Pradalier, Surmonne.
Invitée : Mme Catherine Viers.
La Présidente
rend compte de la correspondance. C’est tout d’abord notre confrère
Christian Darles qui nous invite à assister, le samedi 17 mai prochain, à la
soutenance de sa thèse de doctorat sur Les fortifications antiques de Shabwa
(Hadhramaut, Yémen) : analyse structurelle et approches comparatives.
La Présidente lui présente, par avance, les plus cordiales félicitations de
notre Compagnie.
L’Académie des Jeux Floraux nous invite à sa séance publique du 3 mai, au
cours de laquelle sera primé Maurice Prin pour son livre sur les Jacobins.
Mme Maria
Alessandra Billota nous adresse le numéro de L’Art de l’enluminure
dans lequel elle a fait paraître un article sur un manuscrit du début du XIVe
siècle, reconstitué à partir de feuillets dispersés dans différentes
collections en Europe et aux États-Unis. La Présidente donne la parole à
Hiromi Haruna-Czaplicki, qui après avoir résumé les avancées permises par
une trentaine d’années de recherche, se félicite que l’on puisse
aujourd’hui attribuer ce manuscrit du décret de Gratien à un atelier
toulousain du début du XIVe siècle.
À la
demande de la Présidente, le Secrétaire général fait état d’une
proposition de déstockage des volumes anciens des Bulletins, avec leur mise en
vente au prix d’un euro pièce aux membres de notre Société. Le principe en
est accepté par la Compagnie.
La parole
est à Frédéric Veyssière pour une communication sur L’occupation
antique du Barricou à Beauzelle (Haute-Garonne) :
Cette intervention (1)
s’inscrit dans le cadre des opérations d’archéologies préventives liées
aux aménagements de la ZAC Andromède sur les communes de Blagnac et de
Beauzelle (Haute-Garonne) (2).
Le site antique du
Barricou se situe sur la basse terrasse en rive droite de la Garonne. Un décapage
de 2,3 hectares a permis d’observer en détail la topographie de la grave et
les différences d’épaisseur de la couverture limoneuse. La variation
d’altitude du toit de la terrasse caillouteuse est un dispositif tout à
fait classique dans ce contexte des terrasses alluviales. En effet, la mise en
place de cette formation graveleuse se réalise pendant l’avant-dernière période
froide du Quaternaire. À cette époque, du fait de l’action des processus périglaciaires
mais aussi d’une relative pauvreté de la végétation, les grands cours
d’eau sont surchargés en sédiments. Dans ce contexte, le cours d’eau se
divise souvent en plusieurs chenaux (réseau hydrographique en tresse) encadrés
par des digues naturelles ou des dunes hydrauliques. À chaque crue, certains
chenaux sont abandonnés au profit de zones légèrement déprimées au pied
des levées. À leur tour, ces zones sont rapidement colmatées par une
nouvelle accumulation de galets.
Depuis le
début de l’Holocène, la présence d’une couverture végétale sur des
morphologies légèrement ondulées, aux pentes généralement très faibles,
a entravé l’action de l’érosion. Ainsi, les dépressions de la grave ont
constitué des points bas topographiques jusque dans les périodes récentes,
la couverture limoneuse mimant, dans une moindre mesure, le toit de la
terrasse. La topographie de la basse terrasse était donc plus différenciée
qu’actuellement et apparaissait comme une succession de levées de grave et
de dépressions allongées. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle,
les défrichements massifs et l’apparition de l’agriculture mécanisée
ont eu pour effet de niveler les paysages en rabotant les points haut de la
grave et en colmatant les dépressions.
La
position des vestiges découverts sur le site du Barricou découle directement
de l’existence d’une paléotopographie. Ainsi, l’essentiel des
structures occupent le point haut de la grave, certainement plus sain que les
zones humides qui l’entourent. Cependant, la faible épaisseur de la
couverture limoneuse dans ces secteurs n’a pas favorisé la protection des
structures archéologiques. La mise en culture et les nombreux labours ont eu
pour effet de « raboter » progressivement le point haut du relief
et ainsi de détruire une partie des vestiges. On n’y retrouve donc
essentiellement que des structures en creux qui matérialisent bien
l’importance du décapage dans ces parties.
Dans le
bas-fond, où les conditions de préservation sont pourtant meilleures, on
trouve nettement moins de vestiges archéologiques. Pourtant, l’accumulation
de près d’un mètre de couverture limoneuse est favorable à la
fossilisation des structures. Cette constatation tend donc à montrer qu’il
s’agit d’un secteur manifestement moins fréquenté, certainement du fait
de la présence d’eau, plus ou moins sub-affleurante, une grande partie de
l’année. Plusieurs fossés découverts dans ce secteur matérialisent bien
les problèmes de drainage rencontrés dans ce point bas.
Ainsi, malgré l’érosion
partielle des structures situées sur les points hauts, on peut affirmer que
la répartition des vestiges de ce site ne relève pas d’une conservation
différentielle des vestiges mais plutôt d’un choix lors de l’occupation
de ce secteur. La conservation différentielle des vestiges archéologiques
est manifestement liée à l’existence d’ondulations du toit de la
terrasse.
Outre la récolte
d’éléments d’industrie lithique préhistorique (Acheuléen supérieur,
paléolithique moyen et Néolithique ?), trois phases d’occupations
d’époques distinctes on été mise en évidence : Bronze final/premier
âge du Fer, second âge du Fer et gallo-romain.
La première
occupation du site est donc attribuée à l’extrême fin de l’âge du
Bronze, à la charnière avec le premier âge du Fer. Il s’agit d’un puits
de 2,40 m de profondeur isolée dans la partie occidentale du site, qui a livré
un abondant mobilier céramique constituée de 102 éléments typologiques
appartenant à un minimum de 54 récipients différents : urnes, jarres,
plats tronconiques, coupes et jattes. Ce mobilier est original et varié
d’un point de vue morphologique comme décoratif, et illustre les
productions des communautés protohistoriques du Toulousain, au contact des
mondes languedocien et atlantique, vers le milieu du VIIIe siècle
avant notre ère.
L’occupation
gauloise, un peu plus conséquente, est située entre la fin du IIe
siècle av. J.-C. et le début du Ier siècle av. J.-C. Elle est
caractérisée par quatre petites fosses et une structure complexe regroupant
un puits (2,20 m de profondeur) associé à deux petits fours domestiques et
à une fosse. Cette dernière a livré du mobilier céramique abondant :
vases ovoïdes, coupes, plats et écuelle ainsi que des amphores Dressel 1A.
L’occupation
gallo-romaine est marquée par deux phases séparées par un hiatus de près
de deux siècles. La première se situe à la fin de la période flavienne et
dans la première partie de la période des Antonins, c’est-à-dire entre la
fin du Ier siècle et la première moitié du IIe siècle
ap. J.-C. La seconde concerne la toute fin du IVe siècle et la
première moitié du Ve siècle ap. J.-C.
L’organisation
spatiale des bâtiments et des structures diverses de cette importante
occupation rurale du Haut-Empire semble s’articuler autour du schéma
d’une villa, c’est-à-dire d’un domaine agricole avec un secteur
résidentiel d’une part, et un secteur d’exploitation d’autre part.
La villa
semble donc s’organiser selon un axe orienté est-ouest. L’aile orientale
est occupée par la pars rustica avec une grange (3) et un « pressoir
à vis ». Une serpette à vendanger précise cette activité viticole.
Puis dans le prolongement occidental, se trouvent la pars urbana avec
un bassin d’agrément ou piscine ainsi qu’un bâtiment avec une salle
chauffée par un système d’hypocauste avec son fossé d’évacuation des
eaux, jouxtant une aire en galets aménagés. Enfin dans l’aile
septentrionale, au-delà de cette aire en galets aménagés, la pars urbana
se poursuit avec un bâtiment complexe sur poteaux et sol de galets, où la
nature du mobilier céramique et métallique permet de déceler une forte
activité domestique. Une structure mal définie semble isolée au milieu
d’un espace encadré par les bâtiments à vocation résidentielle. Un
chemin bordé de fossés, orienté sud-nord, permettait d’accéder à la villa
par le sud, laissant sur le côté occidental une aire de stockage. Ce chemin
passe également à proximité d’un ensemble funéraire (4) daté également
de la deuxième moitié du Ier siècle et de la fin du IIe
siècle ap. J.-C. Il est vraisemblable que cet ensemble funéraire de Grand
Noble 3 soit à rattacher à la villa du Barricou. Deux puits à eau,
constitué d’une entablure en bois soutenue par un blocage de gros galets,
et supportant un muraillement en briques et fragments de tegulae, ainsi
qu’un certain nombre de fossés de drainage, complètent cette organisation.

BEAUZELLE, LE BARRICOU, grenier sur sablières basses du Bas- Empire. Cliché Frédéric
Veyssière, Inrap.
|

BEAUZELLE, LE BARRICOU, entablure en chêne d'un
puits du Bas- Empire. Cliché Frédéric
Veyssière, Inrap.
|
Les bâtiments
de ce domaine agricole occupent la partie sommitale nord-ouest du site. Le
secteur sud légèrement en contrebas est une zone humide, dépourvue de
structures archéologiques hormis des fossés de drainage et des empierrements
constitués de galets et de fragments de terre cuite architecturale. Ils
forment une aire de circulation autour de cette zone humide, avec une légère
inclinaison vers le centre de cette dernière. Le peu de mobilier, sa mauvaise
conservation et l’absence de forme identifiable ne permettent qu’une
attribution de ces restes à la période Antique au sens large. Du fait de la
morphologie du substrat, ce secteur a toujours été un point bas plus ou
moins humide. Des aménagements de drainage, fossés et empierrements, ont du
être mis en place dès le début de l’implantation humaine sur le Barricou,
et perdurer durant toute l’Antiquité.
Après une désertification
partielle ou totale des lieux durant près de deux siècles, il y a une réorganisation
de l’espace de l’établissement rural agricole. Les anciens bâtiments ne
sont pas réutilisés. De nouveaux bâtiments apparaissent, dont un grenier
sur sablières basses. Dans la partie méridionale du site, en
bordure de la zone humide présente dès le début de l’occupation du
secteur, il y a implantation d’une nécropole d’enfants dans des
amphores de type Almagro 51B (fin IIe - début IVe siècle)
ou dans des coffres en tegulae et fragments de briques près de trois bâtiments
contigus dont la fonction reste indéterminée.
Un
ensemble de sept tronçons de fossés, drains ou limites parcellaires,
ceinturent le domaine rural. Trois puits à eau, de même type que
ceux du Haut- Empire, complètent cette installation, dans la partie sommitale
du site. Leur comblement riche en mobilier céramique, donne une chronologie
de leur abandon : au début du Ve siècle pour le premier,
dans la première moitié du Ve siècle pour le deuxième et à la
fin du Ve siècle pour le dernier. Le deuxième puits a également
livré un pilier de balustrade ou de clôture en marbre, un baquet en if avec
un décor d’applique peut-être en étain ou en cuivre étamé, ainsi que de
l’outillage en fer : pic, pioche et houe pour le travail de la terre ;
émondoir à ergot et serpette à talon pour l’élimination de végétaux et
le travail de la vigne ; faux et faucille pour la récolte de céréales ;
curette à douille ; ciseaux pour le travail de la pierre ou du bois. Le
dernier puits a livré une œnochoé en alliage cuivreux ainsi qu’une tête
féminine en marbre. Cette dernière pose de très intéressants problèmes
techniques et iconographiques relatifs à la sculpture des portraits à la fin
de l’antiquité. Elle doit être comparée, même si quelques points l’en
différencient, à un célèbre et rare portrait découvert dans la villa
de Chiragan (5), à Martres-Tolosane (Haute-Garonne). Il est donc permis de
se demander si le contexte culturel de ces deux œuvres n’est pas le même :
entourage de la famille théodosienne ? La tête féminine du Barricou
est-elle la représentation du portrait de la maîtresse du domaine agricole
proche de Toulouse ? L’analyse complexe de cette œuvre est loin d’être
achevée. L’enjeu scientifique de la correcte interprétation de ce portrait
nous paraît donc important pour la connaissance de la fin de l’Antiquité
dans le Midi de la France et du royaume wisigothique de Toulouse.
La villa
gallo-romaine du Barricou à Beauzelle est le premier établissement rural de
cette importance a avoir fait l’objet de fouilles aussi étendues dans la
vallée de la Garonne, en aval de la cité antique de Tolosa.
L’important mobilier céramique recueilli ne présente que peu de différence
avec celui de la cité voisine, Toulouse. Il atteste un habitat permanent, même
si sa durée au-delà d’un demi-siècle ne paraît guère certaine pour les
deux grandes phases d’occupation. Ce bilan ne doit cependant pas dissimuler
que de nombreuses questions restent sans réponse sur le statut et l’économie
de la villa, en particulier au Bas-Empire.
Frédéric VEYSSIÈRE
Notes
1. Avec la collaboration de
Thomas Arnoux, Inrap (topographie), Erwan Berthelot, Inrap (étude de la nécropole
du as Empire), Laurent Bruxelles, Inrap (étude géomorphologique), Fabien
Callède, Inrap (topographie), Daniel Cazes, Conservateur du musée
Saint-Raymond de Toulouse (étude de la statuaire), Frédéric Chandevau,
Inrap (étude de la tabletterie), Olivier Dayrens, Inrap (traitement
photographique du mobilier), Céline Gargam, Matéria Viva (radiographie et
photo-interprétation du mobilier en fer), Vincent Geneviève, Inrap (étude
numismatique), Marc Jarry, Inrap (étude de l’industrie lithique préhistorique),
Anne Lagarrigue, Inrap (étude céramique période Bronze final/premier âge
du Fer), Ghislaine Macabéo, Inrap (dessin mobilier en bois), Hélène Martin,
Inrap (étude de la faune), Pierre Marty, Inrap (étude céramique antique),
Pierre Mille, Inrap (étude des bois gorgés d’eau), Olivier Onézime, Inrap
(topographie), Catherine Viers, Inrap (étude du bâti).
2. Frédéric Veyssière et
al., L’occupation antique du Barricou à Beauzelle (Haute-Garonne),
Rapport Final d’Opération, Inrap, Toulouse, juin 2006, 2 vol., 498 p.
3. Frédéric Veyssière,
Catherine Viers et Pierre Marty, « Une grange en brique crue du
Haut-Empire à Beauzelle (Haute-Garonne) », Les cultures
constructives de la brique crue, 3e échanges
transdisciplinaires sur les constructions en terre crue, Toulouse 16-17 mai
2008, à paraître.
4. Patrice Georges et al.,
Grand Noble 3 Blagnac (Haute-Garonne), Rapport Final d’Opération, Inrap,
Toulouse, août 2007, 354 p.
5. Daniel Cazes, « Portrait
de femme de l’époque théodosienne », dans Périple méditerranéen,
cat. d’exp., Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse, 2003, p.
198-201, n° 364.
La Présidente
remercie Frédéric Veyssière pour cette communication tout à fait
passionnante sur un site ainsi étudié sur la longue durée, et elle le félicite,
ainsi que toute son équipe, pour la qualité du travail réalisé. Parmi les
multiples questions qui se posent, il y a celle de l’identification de
l’habitation principale. Frédéric Veyssière pense pouvoir peut-être la repérer
autour des vestiges d’hypocauste, et il ne s’agirait donc pas d’un bâtiment
imposant. La fouille s’étant étendue sur plus de deux hectares et toute une
série de fossés ayant été identifiée en bordure, il semble bien que l’on
dispose de l’ensemble du domaine. Répondant à une nouvelle question de la Présidente,
Frédéric Veyssière précise que c’est à la fin du Ve siècle
que s’arrête l’occupation du site.
Christian
Darles propose des comparaisons avec le site de la villa de la Lonquette,
qui présente le même type de constructions sur des fondations très faibles :
ainsi le « grenier sur sablière basse » avait-il des élévations
en pan-de-bois sur des fondations formées d’une seule rangée de galets.
Cette technique pourrait expliquer la disparition totale des bâtiments et il
faut rappeler qu’une ossature en bois n’est pas incompatible avec un bâtiment
de luxe.
Christian
Darles note le nombre relativement important de puits à eau mis au jour, ce que
confirme Frédéric Veyssière en précisant que l’un d’entre eux appartient
à l’âge du bronze, un autre est gaulois tandis que deux sont du Haut- Empire.
La nappe phréatique se situait à peu près comme aujourd’hui à 3 m à 4 m
de profondeur. Frédéric Veyssière ajoute que la découverte d’un baquet en
if avait conduit Pierre Mille à s’interroger sur la présence d’un éventuel
sanctuaire à proximité.
Jean-Michel
Lassure fait remarquer qu’il est rare qu’autant de mobilier agricole soit
retrouvé au fond d’un puits, puis il demande si les amphores étaient sciées
au niveau du col. Frédéric Veyssière répond que certaines l’étaient et
que d’autres présentaient une fenêtre ménagée dans la panse : leur
utilisation funéraire est incontestable. Jean-Michel Lassure s’interroge
alors sur la présence éventuelle d’un édifice cultuel, mais Frédéric
Veyssière et Quitterie Cazes rappellent qu’elle n’est pas obligatoire dans
un contexte funéraire antique.
Jean-Michel
Lassure s’intéresse ensuite à la tête en marbre retrouvée sur le site, qui
évoque pour lui des portraits funéraires comme ceux que l’on connaît par
exemple dans le Gers. Frédéric Veyssière précise que l’aire de crémation
découverte par Patrice Georges quelques centaines de mètres plus au sud est de
la fin du Ier siècle ou du début du IIe, alors que la tête
est datable du Ve siècle, selon Daniel Cazes auquel il passe la
parole. Celui-ci se remémore la très grande surprise qui a été la sienne
quand Frédéric Veyssière est venu lui montrer cette découverte tout à fait
exceptionnelle. Le plus souvent ces têtes en marbre appartiennent aux
productions massives du Haut- Empire, jusqu’au IIe siècle. Elles
disparaissent ensuite. Cette tête est donc une exception. Il s’agit, c’est
sûr, d’une production locale et le marbre est, sans doute, pyrénéen, mais
l’iconographie exclut le Haut- Empire. La coiffure impose une comparaison avec
une magnifique tête d’époque théodosienne, elle-même très isolée en
Occident, provenant de la villa de Chiragan à Martres-Tolosane. Daniel
Cazes résume son impression : nous pourrions être en présence d’un
portrait datable de la fin du IVe siècle au VIe siècle,
donc celui d’une femme de l’aristocratie du Bas-Empire ou wisigothique.
Jean-Michel
Lassure demande si l’œnochoé mis au jour dans un puits est d’un type
tardif : Frédéric Veyssière dit n’avoir pas trouvé de pièces
comparables.
Guy Ahlsell
de Toulza voudrait avoir des précisions sur les techniques de construction des
puits. Catherine Viers et Frédéric Veyssière expliquent comment les puits
sont creusés et leurs parois bâties, et quelles procédures ont été suivies
pour les fouiller. Ils font remarquer que les entablures étaient ici en sapin
alors qu’ils sont habituellement en chêne ou en orme. En réponse à une
question d’Olivier Testard, Frédéric Veyssière ajoute que les bois sont
assemblés à mi-bois sans être forcément fixés.
La parole
est à Henri Molet pour la seconde communication inscrite à l’ordre du jour :
Un amphithéâtre urbain à Toulouse ? État de la recherche,
publiée dans ce volume (t. LXVIII, 2008) de nos Mémoires.
La Présidente
remercie Henri Molet de nous avoir présenté cette hypothèse qui paraît si séduisante
après une telle démonstration. Daniel Cazes exprime son admiration devant ce
travail tout à fait remarquable, qui aboutit à une telle évidence que l’on
se demandera désormais pourquoi on n’y a pas pensé plus tôt. Et de rappeler
à quel point notre connaissance de la ville antique de Toulouse a été entièrement
transformée depuis une vingtaine d’années, nous éloignant de la vision très
pessimiste que pouvait en avoir le professeur Michel Labrousse. Comme Daniel
Cazes l’interroge sur l’éventuelle présence de tours nobiliaires dans le
secteur supposé de l’amphithéâtre, Henri Molet indique que la liste des
habitants du début du XIVe siècle contient des capitouls, mais rien
de comparable pour l’instant à la demeure des Isalguier installée sur le
site du théâtre antique. Daniel Cazes évoque ensuite la topographie
religieuse liée aux amphithéâtres et à leur périphérie, et la discussion
porte alors sur la présence à cet endroit de l’église Saint-Rome, qui,
comme le fait remarquer Quitterie Cazes, sert de point de repère dans un acte
de 1146.
Patrice
Cabau exprime les plus grandes réserves sur l’utilisation de la tradition
historique toulousaine dont les textes ne présentent rien d’autre qu’une
collection de poncifs. Henri Molet n’en disconvient pas mais il fait remarquer
qu’à la fin du XIIIe siècle il y a néanmoins quelqu’un qui
sait où se trouvait le capitole, et Jean-Luc Boudartchouk fait observer que
l’on ne mentionne jamais le site de Lardenne à propos de l’amphithéâtre.
Répondant
à une question de Guy Ahlsell de Toulza, Henri Molet confirme que le cardo
passait au travers de l’amphithéâtre, et il cite des découvertes faites en
1932 rue Saint-Rome, mais qui n’ont pas fait l’objet d’un suivi archéologique.
Au titre des
questions diverses, Maurice Scellès présente quelques photographies de l’amphithéâtre
de Cahors et des fouilles des allées Fénelon. Comme à Toulouse, notre
connaissance de la ville romaine a été largement renouvelée par les découvertes
de ces dernières années. Les vestiges de thermes publics – l’« Arc
de Diane » des auteurs anciens – et ceux du théâtre étaient restés
visibles en élévation, mais aucun autre édifice public n’était identifié
et l’emplacement du forum lui-même était, et reste, incertain : site de
la cathédrale ou bien site du couvent des chartreux où Jean Catalo a repéré
une maçonnerie de petits moellons dont on peut se demander si elle ne serait
pas antique. Des fouilles récentes avaient permis de mettre au jour dans le
secteur de l’hôpital les fondations d’un temple circulaire, et ce sont les
vestiges très inattendus d’un amphithéâtre qui ont été découverts plus récemment
encore à l’extrémité est des allées Fénelon, à l’occasion de fouilles
préventives pour la construction d’un parc de stationnement souterrain.

CAHORS, ALLÉES FÉNELON, vue partielle de la fouille depuis le
sud-ouest. (printemps 2007). Cliché Gilles Séraphin.
|

CAHORS, ALLÉES FÉNELON, vue de la partie est de la fouille. Cliché
Gilles Séraphin.
|

Cahors. Vestiges de
l'amphithéâtre vus depuis le sud-ouest. Cliché Gilles
Séraphin.
|

Cahors. Vestiges de
l'amphithéâtre vus depuis le sud-est. Cliché Gilles
Séraphin.
|
Christian
Darles fait observer que la référence à des temples « de tradition
gauloise » pour des temples de plan circulaire est une erreur, et il
renvoie à un travail qu’il a récemment publié sur ce sujet. Maurice Scellès
accepte la remarque. Frédéric Veyssière et Catherine Viers complètent un peu
et corrigent si nécessaire la présentation des éléments découverts sur les
allées Fénelon (caves médiévales, vestiges de l’abside de l’église des
cordeliers, voirie du haut Moyen Âge, basilique antique ? etc.) qui
modifient grandement notre perception de cet espace au cours de l’histoire de
la ville.
Le problème
posé par la découverte des impressionnants vestiges de l’amphithéâtre a
immédiatement été celui de leur conservation, toutes les autres structures
mises au jour étant sacrifiées au parking. La première solution retenue était
un réenfouissement devant permettre une mise en valeur future. Maurice Scellès
précise l’étendue des vestiges mis au jour par rapport au collège Gambetta,
à la bibliothèque et au boulevard et s’interroge sur la manière d’intégrer
un jour l’ensemble du site au plan d’urbanisme actuel. Catherine Viers
explique que la hauteur des vestiges conservés à cet endroit est due à la déclivité
du terrain, et qu’elle doit être réduite à peu de chose sous les bâtiments
du collège et de la bibliothèque ; plus à l’est, les structures de
l’amphithéâtre ont nécessairement été détruites puisque l’on se
trouve très vite sur l’emplacement du fossé de la première enceinte
urbaine. Puis Catherine Viers confirme l’information selon laquelle les
vestiges de l’amphithéâtre seraient finalement conservés visibles avec un
accès à partir du parking : les remblais de réenfouissement étant sujet
à des tassements différentiels, il était de toute façon nécessaire de
couler une dalle, portée par des pieux, au-dessus des vestiges. Il y a donc
tout lieu de se réjouir de cette décision en attendant de pouvoir juger de
l’aménagement de la crypte archéologique qui sera réalisée.
SÉANCE DU 13
MAI 2008
Présents : Mme
Pradalier-Schlumberger, Présidente, MM. Cazes, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier,
Scellès, Secrétaire général, Mme Suau, Bibliothécaire-Archiviste, M.
Latour, Bibliothécaire-adjoint ; Mmes Bayle, Merlet-Bagnéris, Napoléone,
Pousthomis-Dalle, Watin-Grandchamp, MM. Bordes, Boudartchouk, Garland, Gilles,
Lassure, le Père Montagnes, M. Peyrusse, membres titulaires ; Mmes Barber,
Duhem, Fournié, Friquart, Haruna-Czaplicki, Krispin, MM. Capus, Dubois, Geneviève,
Pousthomis, Salvan-Guillotin, Surmonne, membres correspondants.
Excusé : M. Cabau, Secrétaire-adjoint.
Invitée :
Mme Martine Rieg.
Le Secrétaire
général donne lecture du procès-verbal de la séance du 29 avril 2008, qui
est adopté. Hiromi
Haruna-Czaplicki souhaite apporter quelques compléments et corrections à sa
communication du 1er avril dernier sur La décoration des livres de Bernard de Castanet et l’enluminure
toulousaine vers 1300.
Louis Latour
donne des nouvelles de Jean Coppolani, dont la « santé normale pour
son âge » ne lui permet pas de venir jusqu’à l’Hôtel d’Assézat,
et de Gabriel Manière, qui
nous assurent de leur bon souvenir.
La correspondance imprimée
comprend, parmi diverses informations, le programme du séminaire Memurbis,
organisé par les Archives municipales de Toulouse en collaboration avec les
villes d’Elche et de Coimbra, qui se tiendra les 2 et 3 juin prochains à
l’auditorium de Saint-Pierre-des-Cuisines, tandis que l’exposition Apprendre
la ville sera présentée dans le cloître des Jacobins du 2 juin au 14
juillet 2008.
Le colloque
sur la brique crue, organisé par les laboratoires mixtes CNRS-UTM FRAMESPA et
TRACES, se tiendra au Centre méridional de l’architecture et de la ville, à
Toulouse, les 16 et 17 mai prochains.
Une
rencontre des académies et sociétés savantes est organisée par la Fédération
historique de Midi-Pyrénées au château de Laréole le 7 juin 2008. Le
programme de la journée prévoit un déjeuner à Cox et une visite du château ;
ceux qui voudraient y représenter notre Société seront les bienvenus.
Au nom du
Centre Marcel-Durliat de Moissac, Chantal Fraïsse offre à la Société le
volume Hauts lieux de l’art roman dans le sud de l’Europe (XIe-XIIe
siècles) : Moissac, Saint-Jacques de Compostelle, Modène, Barri…,
Cahors, La Louve éditions, 2008, 288 p.
La parole
est à Nelly Pousthomis-Dalle et Marc Salvan-Guillotin pour une communication
intitulée : Prier, invoquer et guérir : pratiques cultuelles
autour des reliques durant le Moyen Âge, publiée dans ce volume (t.
LXVIII,
2008) de nos Mémoires.
La Présidente
remercie les deux orateurs pour cette communication tout à fait passionnante,
établie sur une enquête prenant en compte la longue durée. Il est intéressant
de pouvoir ainsi saisir le maintien et la disparition de ces pratiques. La Présidente
fait observer que l’influence de l’Italie, et en particulier du culte à
saint François d’Assise, a sans doute eu un rôle d’accélérateur lorsque
l’on a recommencer à élever les reliques au XIIIe siècle.
Emmanuel
Garland demande s’il est possible d’établir une relation entre la nature de
l’édifice et l’importance accordée à ce genre de culte. En d’autres
termes, ces pratiques étaient-elles aussi fréquentes dans les grandes églises
et les grands monastères que dans les petites églises paroissiales. Pour Nelly
Pousthomis-Dalle, il s’agissait de pratiques beaucoup plus répandues qu’on
ne l’imagine, mais les vestiges matériels en ont le plus souvent disparu dans
les grands édifices, plus rapidement mis à la mode. Un exemple l’illustrera :
le dispositif de Saint-Just de Valcabrère avait un équivalent, depuis
longtemps détruit, dans la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges.
L’attitude de l’Église vis-à-vis de ces pratiques autour des reliques a été
variable au cours du temps : la mise en contact avec les reliques connaît
un renouveau après le concile de Trente, puis un recul au XIXe siècle,
mais les préceptes édictés par les évêques ne sont pas toujours et partout
suivis d’effet. Marc Salvan-Guillotin insiste à son tour sur la modernisation
régulière des grands édifices, qui n’affecte que peu les petits sanctuaires
ruraux des Hautes-Pyrénées ou de Bretagne.
Le Père
Montagnes cite l’exemple contraire de la basilique de Saint-Maximin, où
l’on disposait de moyens très importants. Le recueil des miracles montre les
pèlerins accédant aux reliques placées au-dessus de l’autel ; le
dispositif a néanmoins été sans cesse modifié et les reliques ont été à
une époque placées sur le jubé auquel on accédait par des escaliers.
Pour Daniel
Cazes, ces pratiques autour des reliques remontent aux origines du
christianisme, avec sans doute des exemples très précoces dans les églises
d’orient notamment, où il arrive que le clergé les considère comme
encombrantes. Nous manquons en revanche d’exemples entre la fin de
l’Antiquité et le XIIe siècle. Daniel Cazes signale que le
tombeau de saint Vidian, dans l’église paroissiale de Martres-Tolosane, a été construit aux XIVe-XVe siècles de façon à
permettre la circulation sous le reliquaire, selon un dispositif analogue à
celui de Saint-Just de Valcabrère. Marc Salvan-Guillotin confirme que l’enquête
doit être poursuivie et Nelly Pousthomis-Dalle rappelle qu’en dépit d’un
probable déplacement, les dispositions générales de Valcabrère sont restées
les mêmes. Pour ce qui est du haut Moyen Âge, les études font défaut et les
vestiges conservés paraissent très rares ; il faut sans doute supposer
une continuité dans les pratiques. Emmanuel Garland rappelle qu’à l’époque
carolingienne, les corps sont presque toujours enterrés : les fidèles
passent sur le tombeau à Saint-Germain.
Louis Latour
cite le cas de Grépiac où l’on faisait passer les enfants dans un trou de
l’ancienne église en ruines. Mais on sait qu’au début du XVIIe
siècle, des prêtres d’Auterive luttaient contre ces pratiques jugées indécentes.
La parole
est à Vincent Geneviève qui présente à la Compagnie la suite de son travail
sur Les monnaies des établissements gallo-romains de la plaine de
Martres-Tolosane, avec une deuxième partie sur Les trouvailles
des sites de Sana, Marignac-las-Peyres, Bordier et du Tuc de Mourlan,
publiée dans ce volume (t. LXVIII, 2008) de nos Mémoires.
La Présidente
remercie Vincent Geneviève de nous faire partager ainsi les recherches qu’il
développe en poursuivant cet inventaire. Elle remarque que la belle découverte
de la monnaie provenant du Tuc de Mourlan semble en effet offrir des
perspectives intéressantes.
Après avoir
affirmé qu’il ne se vexerait pas de l’absence de questions sur un sujet à
vrai dire très technique, Vincent Geneviève veut insister sur le fait qu’il
est toujours délicat d’expliquer le lieu de découverte d’une monnaie, même
s’il faut considérer qu’il n’est pas dû au hasard. Dans ce cas, il
n’est pas possible de ne pas mettre en relation l’appartenance de ce denier
du Tuc de Mourlan à une émission rare, qui s’adresse à des personnages de
haut rang, et le fait que la découverte se situe à 3 km d’un des sites les
importants du sud de la Gaule.
Louis
Peyrusse remarque que cette découverte renforce l’hypothèse défendue par
Jean-Charles Balty d’une villa impériale à Chiragan. C’est aussi
l’avis de Daniel Cazes qui se félicite que la reprise de l’étude des
monnaies soit conduite en même temps que le réexamen des portraits sculptés.
Daniel Cazes ajoute que l’on a proposé de placer le Tuc de Mourlan sur la
limite entre la Narbonnaise et l’Aquitaine.
Comme Guy
Ahlsell de Toulza s’interroge sur la présence de ces monnaies dans les
collections du Musée des Augustins, Daniel Cazes et Vincent Geneviève précisent
les conditions de leur dépôt par Léon Joulin, puis de leur transfert dans le
cadre de la réorganisation des musées de Toulouse à partir de 1945. C’est
à l’occasion de ce transfert que Michel Labrousse rédigea son rapport resté
inédit. Vincent Geneviève indique que les monnaies sont désormais classées
dans le médailler du Musée Saint-Raymond mais que l’on a conservé les boîtes
de réglisse et autres, dans lesquelles elles étaient rangées jusque-là.
Au titre des
questions diverses, le Trésorier rappelle que la cotisation doit être acquittée
au cours du premier trimestre de l’année civile et il constate, une nouvelle
fois, de trop nombreux retards.
La Bibliothécaire-Archiviste
rappelle à son tour que les ouvrages empruntés doivent être rapportés avant
les vacances, sous peine de l’application des mesures prévues en cas de
non-respect du règlement de la bibliothèque.
SÉANCE DU 27
MAI 2008
Présents : Mme
Pradalier-Schlumberger, Présidente, MM. Cazes, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier,
Scellès, Secrétaire général, Cabau, Secrétaire-adjoint ; Mmes Bayle,
Napoléone, Watin-Grandchamp, MM. Julien, Lassure, le Père Montagnes, MM.
Peyrusse, Pradalier, Tollon, membres titulaires ; M. Costa, membre libre ;
Mmes Barber, Haruna-Czaplicki, MM. Capus, Surmonne, membres correspondants.
Excusé : Mme Suau,
Bibliothécaire-Archiviste, M. Latour, Bibliothécaire-adjoint, Mme Cazes, MM.
Barber, Garland.
La Présidente
ouvre la séance avec diverses informations. C’est en premier lieu une
modification du lieu de rendez-vous à Saint-Lizier le 21 juin, fixé désormais
en haut de la cité, devant le palais épiscopal. Par ailleurs, la première
rencontre organisée par FRAMESPA sur Le livre dans la région toulousaine et
ailleurs au Moyen Âge se tiendra à l’université de Toulouse-Le Mirail
le vendredi 30 mai.
La Présidente
annonce que M. Alexis Corrochano, primé cette année par notre Société, et
Mme Catherine Viers, architecte et archéologue à l’I.N.R.A.P., nous ont
adressé leur candidature au titre de membre correspondant. Le Bureau a demandé
à Jean-Luc Boudartchouk d’établir les rapports qui seront présentés au
cours de la séance du 10 juin.
La parole est à Georges Costa
pour une communication sur Les testaments et la collection de
l’architecte Pierre Souffron, publiée dans ce volume (t. LXVIII,
2008) de nos Mémoires.
La Présidente
remercie Georges Costa de nous avoir apporté cet éclairage très vivant sur ce
grand architecte, sa famille, ses biens, ses collections… Connaît-on les
auteurs de la trentaine de tableaux qu’il possédait ? Georges Costa
indique que nous ne connaissons, au mieux, que les titres des tableaux.
L’inventaire de Mansart mentionne un Poussin et un Vouet, mais ne celui de
Lemercier ne fait pas état des auteurs. Souffron a vécu vingt ans à Toulouse
avant de s’installer à Auch, et il est probable que sa collection ait été
constituée principalement de tableaux de contemporains, des peintres de
Toulouse et plus largement du Languedoc, où ont d’ailleurs résidé de
nombreux étrangers. L’esprit de précision et l’excellente mémoire de
Souffron nous assurent de dix-neuf tableaux, au moins, que possédait
l’architecte, et que leur filiation permettra peut-être un jour
d’identifier.
Pour Pascal
Julien, ce n’est pas là le seul apport de la communication de notre confrère,
car c’est en effet la première fois qu’est établie la très grande longévité
de Pierre Souffron, alors que l’on considérait jusqu’à présent qu’il y
avait deux Pierre Souffron. Georges Costa rappelle que Braquehaie a cependant établi
la filiation entre les deux architectes, et que Pierre Souffron I était mort en
1621. Pascal Julien fait état de la thèse d’Alain de Beauregard, soutenue en
2002, qui décrit une bonne partie de la carrière de Pierre Souffron. Georges
Costa se souvient d’avoir, à certains moments, hésité pour finalement en
rester à deux Souffron, avec l’argument fourni par Braquehaie de deux
signatures très différentes ; notre confrère propose, si on le souhaite,
de reprendre la question et d’essayer de la débrouiller pour une nouvelle
communication l’année prochaine.
Après avoir
remercié à son tour notre confrère d’avoir si bien su faire revivre ces
personnages, Bruno Tollon fait remarquer que Gilles Séraphin et Joël Perrin
retiennent tous deux l’existence de deux Pierre Souffron. Et comme Georges
Costa indique que Pierre I a été moins étudié que Pierre II, Bruno Tollon précise
que le premier a été rapidement écarté du chantier qu’il conduisait à
Bordeaux pour des raisons de mauvaise organisation. Bruno Tollon souligne
ensuite l’intérêt de ces allusions aux bibliothèques des gens de l’art,
trop peu publiées en France alors que les inventaires publiés par les
Espagnols font connaître les livres que possédaient les architectes, les maçons
ou les charpentiers.
Daniel Cazes
demande si l’appellation d’« objets extraordinaires » peut
laisser entendre un goût pour les monnaies, la glyptique ou les bronzes.
Georges Costa ne le croit pas et pense plutôt à des gravures et des objets
autres qu’archéologiques.
La parole
est à Jean-Michel Lassure pour une communication sur La Garonne et ses
affluents entre Toulouse et Muret : premier bilan d’une opération de
prospection archéologique diachronique, qui sera publiée dans le
prochain volume (t. LXIX, 2009) de nos Mémoires.
La Présidente
remercie Jean-Michel Lassure de nous avoir présenté les premiers résultats
d’une recherche très originale. L’utilisation des photographies prises par
satellite est tout à fait remarquable. On comprend qu’il s’agisse d’une
recherche diachronique, mais est-ce qu’il est par exemple possible de dater
les pierres de mouillage ? Jean-Michel Lassure répond par la négative en
insistant sur le fait qu’il s’agit d’un début de recherche. Dans notre région,
des recherches sur des rivières ont été engagées sur le Lot et autour de
Montauban, mais notre retard est néanmoins considérable par rapport à ce qui
se fait en Charente ou sur la Saône. Le premier enjeu est donc de se former et
de préciser les méthodes et les problématiques.
Dominique
Watin-Grandchamp se souvient que les recherches qu’elle avait faites dans le
fonds de Malte avaient été très fructueuses pour le site d’Orgueil, en
bordure du Lot, puis elle évoque les travaux de Philippe Delvit sur la Garonne,
qui contiennent déjà un premier balayage des archives. Jean-Michel Lassure
explique que pour cette première phase, on a préféré mettre l’accent sur
l’enquête de terrain, et qu’il n’a dès lors pas été possible de dégager
le temps nécessaire à la recherche en archives.
À propos
des trouvailles de la chaussée du Bazacle, Maurice Scellès raconte que Georges
Fouet expliquait lui-même qu’il entretenait des relations avec les fouilleurs
clandestins afin de pouvoir au moins étudier et photographier les objets. Toute
cette documentation devrait se trouver dans les papiers de Georges Fouet, qui
sont déposés aux Archives départementales de la Haute-Garonne, précise
Daniel Cazes. Jean-Michel Lassure dit avoir consulté l’inventaire du fonds
Fouet, et il ajoute qu’il n’a trouvé que des tirages photographiques, les négatifs
ayant semble-t-il disparu.
Daniel Cazes
souhaite remercier notre confrère pour cette communication en effet pionnière
dans notre région. Des recherches analogues se développent dans toute
l’Europe avec des résultats extraordinaires. On a également à l’esprit le
trésor de Garonne et la découverte toute récente qui a été faite à Arles.
Par chance, le cours supérieur de la Garonne offre des eaux très claires,
comme le montrent les photographies par satellite sur lesquelles les aménagements,
voire peut-être les épaves, se repèrent assez aisément. Il est vrai qu’il
fallait montrer l’urgence d’une étude d’ensemble de la rivière. Les
recherches bibliographiques apporteront sans doute beaucoup, et l’on pense
bien sûr aux travaux de Gabriel Manière, mais il y a également toute une
tradition orale qui va bientôt disparaître : c’est le cas par exemple
à Roquefort avec les derniers représentants de familles de bateliers et de
carriers. Jean-Michel Lassure partage ce point de vue et confirme l’importance
d’enquêtes auprès des gens de rivière. On ne connaît pour l’instant
qu’une seule barque de pêcheur et un bateau de dragage en fer.
Daniel Cazes
s’intéresse ensuite à Toulouse, où le champ d’investigation est énorme.
Qui sait par exemple que le moulin de Baylac existe encore ? Ses parties médiévales
seront-elles un jour relevées et étudiées ? Il faudrait aussi étudier
les nombreux bras d’eau et canaux de fuite, parfois comblés, en particulier
dans le quartier des Amidonniers. La Ville aménage actuellement à cet endroit
la deuxième partie de la « coulée verte », sans aucune étude archéologique
préalable, et les engins mettent au jour des vestiges de bâtiments. Concernant
les objets du Bazacle, Daniel Cazes dit avoir toujours été scandalisé par la
façon dont ils avaient été traités. Ce sont près de 40 000 objets qui
ont été trouvés sur la chaussée du Bazacle, et les plus précieux ont
disparu, et ont sans doute disparu de Toulouse. Or le fleuve appartient à l’État
et les fouilles des années 1972-1973 n’étaient pas le fait de clandestins
mais bien des fouilles officielles. L’abbé Jean Rocacher a publié les
enseignes de pèlerinage, mais que sont devenus les objets ? Georges Fouet
expliquait très bien pourquoi les objets de la chaussée du Bazacle étaient
dans un parfait état de conservation : perdus par leur propriétaire, ils
n’avaient pas été roulés par la rivière, se retrouvant très vite piégés
dans les cupules de la roche bientôt obturées par les alluvions.
La parole
est enfin au Secrétaire-adjoint pour la lecture du procès-verbal de la séance
du 1er avril, pour lequel sont demandées quelques modifications,
puis au Secrétaire général pour la lecture du procès-verbal de la séance du
13 mai. Les deux procès-verbaux sont adoptés.
SÉANCE DU 10
JUIN 2008
Présents : Mme
Pradalier-Schlumberger, Présidente, MM. Cazes, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier,
Scellès, Secrétaire général, Mme Suau, Bibliothécaire-Archiviste, M. Cabau,
Secrétaire-adjoint ; Mmes Bayle, Pousthomis-Dalle, Watin-Grandchamp, MM.
Bordes, Boudartchouk, Garland, Gilles, le Père Montagnes, MM. Peyrusse,
Pradalier, Mgr Rocacher, M. Testard, membres titulaires ; Mmes Barber, de
Barrau, Czerniak, Fournié, Friquart, Haruna-Czaplicki, Krispin, MM. Barber,
Burroni, Laurière, Mattalia, Pousthomis, Salvan-Guillotin, Stouffs, Surmonne,
membres correspondants.
Excusé : M. Latour,
Bibliothécaire-adjoint.
Invités :
Mme Martine Rieg ; M. Robert Coustet.
La Présidente
invite les membres qui ne l’auraient pas encore fait à s’inscrire pour la
journée foraine du 21 juin à Saint-Lizier, et de profiter ainsi de la chance
exceptionnelle de pouvoir visiter l’église Notre-Dame de la Sède.
Puis elle
souhaite la bienvenue à M. Robert Coustet, professeur émérite d’Histoire de
l’art contemporain à l’Université de Bordeaux, que nous accueillons
volontiers parmi nous ce soir. Cette séance est la dernière de l’année académique
2007-2008, et la Présidente se réjouit d’une assemblée aussi nombreuse. La
séance sera suivie d’une réunion amicale autour d’un peu de champagne.
Le Secrétaire
général donne lecture du procès-verbal de la séance du 13 mai dernier, qui
est adopté. En complément
au procès-verbal, Dominique Watin-Grandchamp rapporte que Michèle Éclache lui
a confié avoir rencontré sur un même document les signatures des deux Pierre
Souffron.
L’ordre du
jour appelle l’élection de membres correspondants. La Présidente donne la
parole à Jean-Luc Boudartchouk, rapporteur pour les candidatures de Mme
Catherine Viers et de M. Alexis Corrochano. Les rapports entendus, on procède
au vote : Mme Catherine Viers et de M. Alexis Corrochano sont élus membres
correspondants de notre Société.
Aucun
courrier n’a été reçu. Quelques dons viennent en revanche enrichir notre
bibliothèque :
- Archéopages,
volume 20, octobre 2007, Naissance de la ville, avec un article de
Jean-Luc Boudartchouk, Lexicographie de la ville dans l’Antiquité romaine :
quelques mots de latin…, p. 52-57 (don de J.-L. Boudartchouk) ;
- Carnets
de Garnac, Bulletin semestriel de liaison et d’information de la Société
d’histoire du Garnaguès. Belpech et son canton, n° 30, octobre 2007, et
n° 31, avril 2008 (envoi de M. Auguste Armengaud).
Le Bureau
devra examiner l’éventualité d’un échange de publication avec le Bulletin
de la Société d’histoire du Garnaguès.
La parole
est à Jean-Marc Stouffs et Virginie Czerniak pour une communication sur Les
peintures romanes de l’église de Vals (Ariège), publiée dans ce volume (t.
LXVIII,
2008) de nos Mémoires.
La Présidente
remercie les deux intervenants de nous avoir présenté toutes ces observations
très précieuses et cette relecture du programme des peintures de Vals. En se
remémorant une visite sur place au mois d’avril, la Présidente souligne à
quel point la restauration de ces peintures, qui étaient devenues illisibles,
est spectaculaire. Les analyses techniques : tracés dans l’enduit frais,
mise en place des couleurs, etc. sont tout à fait passionnantes. Quant à la
Vierge, est-elle placée sous un arc ou bien dans une mandorle ? Pour
Emmanuel Garland, c’est bien un arc sous lequel la Vierge est mise en exergue.
Sans
remettre en cause l’ensemble de l’analyse proposée, Marc Salvan-Guillotin
exprime ses doutes quant au rôle d’intercesseur attribué à la Vierge, dont
la présence rappelle l’Incarnation, d’une manière assez banale, alors le
Christ est figuré en juge. Virginie Czerniak rappelle ce qui fonde sa
proposition : la porte entr’ouverte derrière la Vierge, les anges… et
elle ajoute que l’idée de jugement est ici absente, le moment évoqué de la
parousie se plaçant juste avant le Jugement dernier.
Pour
Emmanuel Garland, ce sont peut-être deux thèmes qui sont réunis. Le thème
marial, preuve de l’Incarnation du Sauveur s’augmente de l’Adoration des
Mages, à connotation politique, mais la présence des anges est fondamentale,
et tout à fait exceptionnelle même si on en connaît d’autres exemples.
Viennent donc se superposer un thème marial et un thème liturgique, alors que
l’autel ne se situait pas au fond de l’abside, mais sous le doubleau où est
figuré le Christ, et sur lequel pouvaient également se trouver Caïn et Abel.
Comme Virginie Czerniak lui fait remarquer que notre certitude s’arrête à
deux personnages superposés, Emmanuel Garland convient qu’il faut sans doute
s’en tenir à un collège apostolique étendu aux prophètes. Quant à
Panthasaron, il s’est laissé dire qu’il s’agissait d’un ange très
important dans la tradition juive.
Virginie
Czerniak souligne que l’un des intérêts de la restauration est d’avoir
confirmé la technique pressentie et la présence de deux mains, comme le
pensait Marcel Durliat.
Henri
Pradalier rejoint Emmanuel Garland sur l’analyse iconographique. Le programme
réunit en effet deux thèmes, le premier avec le Christ en gloire et la cour céleste,
le second avec la Vierge à laquelle est dédiée l’église ; la
composition est adaptée à une abside semi-circulaire, le registre du Christ
restant placé au-dessus de celui de la Vierge. (Henri Pradalier fait cependant
remarquer que l’épisode des Mages s’intègre mal dans l’ensemble qu’il
propose.) Pour les doubleaux, ce sont peut-être des prophètes, comme on en
fait l’hypothèse pour Saint-Lizier ou Saint-Pierre de Burgale, mais on a
ailleurs des séries de saints.
Henri
Pradalier trouve intéressant le parallèle établi entre la porte
entr’ouverte et la Vierge, porte du ciel, mais il rappelle que la porte
entr’ouverte est souvent celle où apparaît une servante, témoin de la scène.
Puis Henri
Pradalier s’intéresse aux fragments peints. Jean-Marc Stouffs explique
qu’ils ne peuvent appartenir à une représentation de saint Paul. Ces
fragments, replacés en désordre par Sylvain Stym-Popper après avoir été
remployés comme moellons une première fois, conservent en particulier un
visage et une urne. Quant aux inscriptions lisibles sur les rouleaux des
archanges, Henri Pradalier note qu’elles correspondent à la formule de la petitio.
Il ajoute enfin qu’il trouve le style des peintures médiocre (ce qui provoque
un mouvement dans l’assemblée). Emmanuel Garland convient que le style
n’est pas exceptionnel, mais les peintures montrent en revanche une parfaite
maîtrise technique. Une discussion s’ensuit sur le dessin et l’emploi de la
couleur. Jean-Marc Stouffs attire l’attention sur le bleu du vêtement du
Christ, et Virginie Czerniak sur les éléments en relief. Henri Pradalier évoque
alors les œuvres du maître de Pedret, en comparaison desquelles il ne fait pas
de doute que les peintures de Vals sont un peu maladroites : plus « maladroites »
que « médiocres », souligne Virginie Czerniak. Pour la Présidente,
la disparition des aplats de couleur doit en tout cas inciter à la prudence.
Jean-Luc
Boudartchouk voudrait avoir des précisions sur les parties de l’église
attribuées au Xe siècle. Emmanuel Garland fait remarquer
qu’aucune étude véritable ne permet de proposer de datation, et Nelly
Pousthomis-Dalle confirme que nous ne disposons d’aucune mention pour étayer
l’hypothèse d’un édifice antérieur à l’époque romane. Pour Henri
Pradalier, c’est surtout le plan qui se rattache à des formes pré-romanes,
et Jean-Marc Stouffs rappelle que l’abside actuelle repose sur les vestiges
d’une construction antérieure qui, selon un témoignage oral, comporterait
des parties d’appareil en arête de poisson.
La parole
est à Jean-Luc Boudartchouk et Henri Molet qui se sont proposés de dire Encore
un mot sur les lacs sacrés de Toulouse.
La Présidente
les remercie, en regrettant que des défaillances techniques aient empêcher de
projeter les images, qui seront donc présentées à la séance de rentrée, en
octobre ; le Trésorier promet que nous disposerons alors d’un ordinateur
portable connecté à notre vidéo-projecteur numérique.
Michèle
Pradalier-Schlumberger rappelle à la Compagnie que Patrick Foissac soutiendra
sa thèse sur les collèges universitaires de Toulouse le 14 juin prochain, à
14 heures, au 56 rue du Taur, sur le site de l’ancien collège de Périgord.
La Présidente
prononce la clôture de l’année académique 2007-2008 en souhaitant à tous
de bonnes vacances.
JOURNÉE FORAINE DU 24 JUIN 2008
Présents : Mme
Pradalier-Schlumberger, Présidente, MM. Cazes, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier,
Scellès, Secrétaire général, Mme Suau, Bibliothécaire-Archiviste, M. Cabau,
Secrétaire-adjoint ; Mme Watin-Grandchamp, MM. Garland, Peyrusse, Pradalier,
Testard, membres titulaires ; Mmes Barber, Félix, Haruna-Czaplicki, Viers,
MM. Barber, Burroni, membres correspondants.
Excusé : M. Latour,
Bibliothécaire-adjoint.
Invités : Plusieurs
parents et amis.
La Compagnie
est accueillie à 10 heures devant l’entrée de l’ancien palais épiscopal
par M. Dedieu, maire de Saint-Lizier. Après quelques mots de bienvenue, M.
Dedieu demande à la Compagnie d’excuser l’absence de Mme Albertin,
conservateur des musées départementaux de l’Ariège, empêchée au dernier
moment. Puis il donne quelques informations sur les travaux d’entretien et
d’aménagement réalisés par la Ville de Saint-Lizier pour permettre aux
visiteurs de faire le tour du rempart gallo-romain.
Daniel Cazes
se livre à une rapide présentation topographique et historique des sites de
Saint-Lizier et Saint-Girons, que l’on considère aujourd’hui comme
indissociablement liés. La fortification du pech ferait partie d’un ensemble
défensif établi à la fin de l’Antiquité, depuis Bayonne, au Pays-Basque,
jusqu’à la Méditerranée, en passant par Saint-Lézer dans les Hautes-Pyrénées,
et qui pouvait inclure Carcassonne.
M. Dedieu
invite la Compagnie à profiter, par cette belle journée et sans doute pour la
dernière fois, de la beauté des lieux et du site, car la promenade au pied du
palais épiscopal ne sera plus aussi accessible quand seront aménagées la
billetterie d’entrée du musée et la terrasse du restaurant. Pour la
transformation en résidence hôtelière, trente percements étaient prévus :
on est revenu au nombre plus raisonnable de six. L’appartement de l’évêque
qui devait être divisé en trois restera finalement en l’état, tandis que
les caves du palais seront dévolues à la restauration et seront donc des
espaces privés. Puis M. Dedieu explique en outre que l’aménagement de la
partie nord du site prévoyait d’adosser les nouveaux bâtiments, dus à
l’architecte Villemote, à l’enceinte qui aurait été percée, et qu’il a
pu obtenir, en refusant d’accorder le permis de construire, que les
constructions soient réalisées un peu en retrait. (La Compagnie le constatera
en effet un peu plus tard, en même temps que le décaissement important d’une
grande partie de cette zone et jusqu’au pied du rempart, visiblement réalisé
sans réelles fouilles archéologiques.)
La visite débute
avec la courtine sud de l’enceinte, sur laquelle a été construit le palais
épiscopal dont les aménagements du XVIIIe siècle et ceux récents ou en cours
sont appréciés. Parvenus devant Notre-Dame de la Sède, nous ne pouvons que
regretter plus encore l’absence de Mme Albertin sur qui nous comptions pour
nous ouvrir l’église. Après que Catherine Viers a détaillé les blocs
romains en remploi, Emmanuel Garland tâche de décrire l’intérieur de l’édifice
et les peintures que nous ne pouvons pas voir.
Après la
pause-déjeuner, la Compagnie reprend le cours de sa visite avec la présentation
par Henri Pradalier de l’intérieur de l’église Saint-Lizier, où
l’architecture et les peintures suscitent de nombreuses questions. À l’extérieur,
Catherine Viers commente les remplois antiques intégrés dans les maçonneries
du chevet avant qu’Emmanuel Garland présente le cloître.
La visite se
poursuit avec l’Hôtel-Dieu et sa pharmacie, puis nous retrouvons Monsieur le
Maire de Saint-Lizier dans les locaux de l’ancien presbytère en cours d’aménagement.
La Présidente
ayant dû repartir un peu auparavant, il revient au Directeur de conclure cette
journée. L’importance historique, archéologique et patrimoniale du site de
Saint-Lizier doit être une évidence pour tous, et pourtant on voit à quel
point une chose aussi facile que le fait de réunir les différents partenaires
concernés est difficile dans notre pays. Il est important que notre Société
continue à organiser des journées comme celle-ci, sur le terrain, renouant
ainsi avec une tradition ancienne.
© S.A.M.F. 2007-2009. La S.A.M.F. autorise la
reproduction de tout ou partie des pages du site sous réserve de la mention des auteurs
et de l'origine des documents et à l'exclusion de toute utilisation commerciale ou
onéreuse à quelque titre que ce soit.