
Mémoires
de la Société Archéologique
du Midi de la France
_____________________________________
Tome LXIII (2003)
|
Mémoires |
BULLETIN DE L'ANNÉE ACADÉMIQUE
2002-2003
établi par Patrice CABAU & Maurice SCELLÈS
Les parties non reproduites dans l’édition papier apparaissent en vert dans cette édition électronique.
| Séances du 1er octobre 2002 au 21 janvier 2003 | Séances du 31 janvier 2003 au 11 mars 2003 |
| Séances du 25 mars 2003 au 3 juin 2003 | |
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 272
SÉANCE DU 25 MARS 2003
Présents : Mme
Pradalier-Schlumberger, Présidente, MM. Cazes, Directeur, Coppolani, Directeur honoraire,
Ahlsell de Toulza, Trésorier, Latour, Bibliothécaire-Archiviste, Scellès, Secrétaire
général, Cabau, Secrétaire-adjoint ; Mme Cazes, Napoléone, Watin-Grandchamp, MM.
l’abbé Baccrabère, Bordes, Bruand, le Père Montagnes, MM. Nayrolles, Pradalier,
Prin, Peyrusse, membres titulaires ; Mmes Bayle, Bellin, Boussoutrot, Conan,
Czerniak, Fronton-Wessel, MM. Balagna, Manuel, Testard, membres correspondants.
Excusés : MM. Boudartchouk, Hermet.
Après avoir annoncé que la présentation du procès-verbal du 11 mars était reportée à la prochaine séance, la Présidente rend compte de la correspondance reçue. Me Viala nous communique copies des courriers qu’il a adressés à la Mairie de Toulouse et des réponses qui lui ont été faites à propos des incidents survenus dans le fonctionnement des ascenseurs, des stationnements abusifs devant l’entrée du garage et des dégâts des eaux de février dernier.
Notre confrère M.
Manuel offre à la Société deux dossiers illustrés de photographies sur l’église
Saint-Michel de Cordes et les peintures de la chapelle Saint-Jean-de-Mordagne. La
Présidente remercie M. Manuel.
Nous avons encore reçu
l’ouvrage de Gérard Veyries, De Montégut à L’Isle en Albigeois. Remise en
question d’un mythe historique, 2002, 240 p., offert par l’auteur en
remerciement des recherches qu’il a pu effectuer dans notre bibliothèque.
Par ailleurs, Jean-Luc
Schenck, conservateur du musée de Saint-Bertrand-de-Comminges, nous adresse
l’ouvrage de Jean-Pierre Bost et Clary Namin, Collections du Musée archéologique
départemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. 5. Les monnaies, Conseil Général de
la Haute-Garonne, 2002, 240 p.
La correspondance imprimée comprend le programme des conférences organisées par les Pays d’art et d’histoire des bastides du Rouergue et l’annonce du colloque sur Le Moyen Âge dans les Pyrénées catalanes. Art, culture et société qui se déroulera du 23 au 25 mai prochain. On y ajoutera l’article paru dans l’édition du Tarn de La Dépêche du Midi et repris dans l’édition en ligne qui rend compte très amplement de l’étude de la tour de Palmata de Gaillac, réalisée par Anne-Laure Napoléone, Catherine Guiraud et Bertrand de Viviès.
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 273
La parole est à Olivier Testard pour la communication du jour : La porte Miègeville de Saint-Sernin de Toulouse : proposition d’analyse iconographique, qui sera publiée dans le tome LXIV (2004) de nos Mémoires.
La Présidente remercie Olivier Testard pour cette communication qui apporte beaucoup à la compréhension de la porte Miègeville et suscite sans doute tout autant d’interrogations. Des scènes qui restaient énigmatiques sont élucidées et du sens est rendu à d’autres. Ces nouvelles interprétations sont tout à fait intéressantes et seront amplement débattues. La Présidente se dit convaincue par l’argument de la laideur du péché, mais elle réserve son opinion quant aux anges qui seraient représentés sur l’une des consoles, promettant de vérifier sur place au plus tôt.
Pour Daniel Cazes, la
bibliographie très nombreuse témoigne qu’il y avait encore beaucoup à discuter,
tant l’iconographie de ce portail est riche. L’interprétation proposée du
relief de Simon est convaincante, le situant dans une perspective plus large que celle,
admise jusqu’à présent, qui le limitait à un récit anecdotique lié à
l’histoire du chapitre. En revanche, Daniel Cazes ne croit pas à une représentation
synthétique de saint Jacques, qui associerait le Majeur et le Mineur, cette
interprétation lui paraissant relever d’une vision intellectuelle contemporaine. Les
chanoines de Saint-Sernin qui firent réaliser le portail devaient sans aucun doute savoir
lequel des deux apôtres y était figuré. Daniel Cazes rappelle que le chanoine
Delaruelle s’était prononcé en faveur du Mineur, mais l’inévitable
rapprochement avec la représentation de Saint-Jacques-de-Compostelle, où saint Jacques
est également accompagné de bâtons, a imposé d’y reconnaître le Majeur. Du point
de vue de la méthode, et alors que les attributs sont nos repères principaux pour
identifier les personnages, il est peut-être risqué d’identifier différemment deux
images semblables.
Après avoir rappelé
qu’il ne rejetait pas l’identification de saint Jacques le Majeur, Olivier
Testard assure avoir eu le même parcours, jusqu’à donner la préférence au Mineur.
Mais les études sur Jacques indiquent de manière récurrente la confusion à cette
époque entre les deux saints, tant et si bien que l’on demande aux dominicains une
révision des récits hagiographiques et que l’on insiste sur le fait qu’il ne
faut pas confondre Jacques le Majeur et Jacques le Mineur. La confusion semble donc bien
réelle, et il a fallu l’admettre.
Sur le second point,
Olivier Testard avoue qu’il lui faut encore approfondir la question de la conception
de l’iconographie au Moyen Âge, et il reconnaît que cela peut nous poser de
véritables problèmes de méthode.
Louis Peyrusse
s’interrogeant sur l’interprétation proposée pour le relief placé sous celui
de saint Jacques, Henri Pradalier demande pourquoi l’une des deux femmes a les pieds
nus, l’autre les pieds chaussés. Après avoir fait remarquer que l’une des
femmes n’a pas les pieds nus mais dans des sandales et que l’autre porte des
chaussures fermées, Olivier Testard explique que les deux femmes d’Abraham
pourraient représenter l’Ancien et le Nouveau Testament, c’est-à-dire les
Écritures maîtrisant le mal qui apparaît sous la forme des lions.
Henri Pradalier est
prêt à suivre Olivier Testard quand il propose de voir dans Simon le Magicien le premier
des hérétiques et une image du peuple juif, mais il conserve un double sens,
l’ascension manquée de Simon s’opposant à celle du Christ : c’est
également ce que pense Olivier Testard. Pierre représente la papauté à un moment où
l’on exalte à Rome la chaire de l’apôtre, et il est celui qui a vaincu Simon
le Magicien. La lecture supplémentaire qui est proposée contribue effectivement à une
meilleure explication des reliefs. En poursuivant dans le même sens, il serait possible
de voir dans les figures d’Agar et de Sarah, les deux femmes d’Abraham, des
images de la Synagogue et de l’Église, avec une question sous-jacente qui est celle
de savoir si les Juifs seront sauvés ou non. S’opposent en effet alors deux
tendances, l’une rigoriste, l’autre libérale. Suivant en cela saint Paul, le
tympan de Beaulieu relèverait de la tendance libérale qui voulait que chacun soit jugé
selon sa loi s’il l’avait lui-même appliquée. Si l’interprétation du
relief est la bonne, Abraham oblige Agar et Sarah, c’est-à-dire l’Église et la
Synagogue, à se regarder alors que les animaux divergent, et l’on aurait donc là
l’expression de la tendance libérale. Olivier Testard partage cette analyse. Henri
Pradalier ajoute qu’à Saint-Isidore de León, on trouve aussi Agar d’un côté,
Sarah de l’autre et Abraham au milieu, Abraham qui est encore représenté à
Saint-Jacques-de-Compostelle, mais seul et sans que l’on connaisse sa provenance.
Henri Pradalier récuse
en revanche l’hypothèse d’une représentation à Miègeville de la Pentecôte
dont l’iconographie est bien fixée : les apôtres sont assis tandis que des
flammes descendent sur eux, et la Vierge est parmi eux. Pousser l’interprétation des
figures du linteau jusque-là relève de la surinterprétation. Quant à l’idée
selon laquelle l’Église n’avait guère à afficher sur un portail des conflits
« internes », elle n’est pas convaincante si l’on considère que la
simonie n’était pas seulement une affaire interne puisqu’il s’agissait de
la collusion entre le clergé et la noblesse. En rappelant que l’accusation de Cluny
ne concerne que les chanoines, Olivier Testard dit qu’il a surtout considéré que
l’allusion ne touchait qu’une petite partie de la société et qu’il
s’agissait donc d’un problème important mais particulier qui n’avait pas
sa place sur un portail à portée universelle.
Henri Pradalier
maintient son désaccord. Il relève ensuite que si l’on s’en tient à la grille
de lecture proposée, Simon se trouve dans la zone céleste. Olivier Testard en convient.
Henri Pradalier dit être prêt à admettre la confusion des deux saints Jacques, mais il
ne voit pas, lui non plus, quel rapport pourrait être établi entre l’un ou
l’autre des apôtres et Abraham. Olivier Testard ajoute qu’il n’a pas de
réponse satisfaisante à proposer pour les reliefs supérieurs. Les éléments dont il
dispose lui ont paru néanmoins assez probants pour être présentés. Il reconnaît une
autre faiblesse, qu’il n’a d’ailleurs fait qu’évoquer, au sujet de la
corniche dont il faut se demander si elle doit être intégrée au programme
iconographique du portail : on sait cependant que cinq des huit consoles ont été
refaites, et il est donc de toute façon bien difficile de raisonner sur seulement trois
d’entre elles.
Henri Pradalier
poursuit l’exposé de ses désaccords. La présence de David, sous le linteau, sur la
console de gauche, s’explique par deux versets du début du psaume 138 par lequel
commençait la journée des chanoines : « Je te chante en présence des anges,
je me prosterne vers ton Temple sacré ». Le lien iconographique avec saint Pierre
n’est donc pas nécessaire, et l’apôtre ne figure ni à Jaca ni à Compostelle
où David musicien est cependant représenté. Quant aux lions sur lesquels il est assis,
Henri
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 274
Pradalier y voit la reprise du thème de
la chaise curule, dont les extrémités sont toujours ornées de têtes de lions, et non
une représentation du mal. Pour Olivier Testard il n’y a là rien
d’incompatible. Henri Pradalier se dit également sceptique sur
l’interprétation du chapiteau à feuillage et animaux qui serait là pour
représenter la Création et il cite l’exemple de Jaca, dans une série où le
chapiteau à feuillage n’a aucune signification particulière. Il pense, pour
conclure, que l’enthousiasme de notre confrère le conduit parfois à la
surinterprétation, ce qui n’enlève rien à l’apport de sa communication pour
une meilleure compréhension du programme iconographique de la porte Miègeville.
Olivier Testard assure
prendre en compte les autres édifices, mais en considérant que la personnalité qui
fabrique intellectuellement le programme est ici et pas nécessairement ailleurs.
Patrice Cabau dit
s’être intéressé aux éventuels commanditaires qui pourraient être derrière ce
qui est à l’évidence la manifestation d’une pensée, architecturale et
iconographique. On se situe à un moment où le flou est grand autour de ceux qui dirigent
le chapitre de Saint-Sernin. Par ailleurs, en scrutant le personnel, on ne trouve aucun
équivalent intellectuel à ce que l’on connaît pour Moissac ou Saint-Victor de
Marseille. Le cartulaire ne contient que deux actes qui fassent preuve d’une certaine
élévation de pensée, et ils sont dictés l’un par le prévôt d’Angoulême,
l’autre par l’évêque de Cahors. Jamais un écolâtre n’apparaît dans les
archives et le nom de capiscol que l’on relève est un nom de famille. On
trouve bien un magister Odon en 1115-1120. Quant à Raymond Guillaume, prévôt
avant 1108, devenu abbé entre 1114 et 1117, décédé en 1140, on ignore à quelle
famille il pouvait appartenir et sa personnalité demeure inconnue. Henri Pradalier
réaffirme que, pour lui, la porte Miègeville est en place en 1096.
Au titre des questions diverses, Anne-Laure Napoléone présente les premiers résultats de l’analyse archéologique des bâtiments du collège de Périgord :
« À l’occasion des travaux actuellement en cours au n° 56 de la rue du Taur, il a été possible d’observer une partie des vestiges du collège de Périgord. L’histoire de cet édifice est assez bien connue. Il fut fondé par le Cardinal Hélie de Talleyrand Périgord en 1360 pour une vingtaine d’étudiants. Pour sa construction, il fallut acheter six hôtels longeant la rue du Taur et la rue de Périgord, en grande partie détruits à la fin du XIVe siècle pour édifier les bâtiments du collège (1). Ces bâtiments ont fait l’objet d’une vaste campagne de modifications au cours du XIXe siècle. On connaissait jusque-là la tour Maurand, vestige d’un grand hôtel du XIIe siècle englobé dans les constructions du collège, et l’aile ouest de celui-ci, la seule qui ait survécu aux destructions du XIXe siècle. L’observation des maçonneries à l’occasion des récents travaux ont permis de nombreuses constatations intéressantes.
En tout premier lieu, des informations complémentaires ont pu être recueillies sur l’hôtel de la famille Maurand. On soupçonnait déjà l’existence d’une aile longeant la rue de Périgord, sur une cinquantaine de mètres environ, à l’est de la tour. Les maçonneries des caves, clairement lisibles au cours de ces travaux, ont confirmé ce fait. D’autres vestiges mis au jour récemment sur l’élévation ouest sur la cour (correspondant à la seule aile du collège qui soit conservée) ont montré également qu’une seconde aile, plus restreinte, longeait la rue du Taur au nord donc de la tour. Cette portion de maçonnerie est particulièrement intéressante puisqu’elle montre clairement le mur du XIIe siècle – éclairé au rez-de-chaussée par une fente de jour – cassé sur deux niveaux, et la reprise des maçonneries effectuée à la fin du XIVe siècle, notamment pour aménager la grande porte en arc brisé destinée à ouvrir sur la chapelle du collège (cette partie est aujourd’hui à nouveau enduite).
Alors que toute la façade donnant sur la rue du Taur avait été remontée au XIVe siècle, on conservait sur la cour un fragment de la maçonnerie de l’aile ouest de l’hôtel Maurand relié aux vestiges d’un autre hôtel (vraisemblablement celui de la famille Pechbonnieu) par ce même fragment de mur daté par la porte de la chapelle. Les vestiges de ce second hôtel sont donc antérieurs à la fin du XIVe siècle, mais aucun lien chronologique ne peut être établi avec ceux de l’hôtel Maurand. L’emploi de briques de dimensions différentes indique seulement que ces deux constructions ne sont vraisemblablement pas contemporaines. Ces maçonneries conservent trois fenêtres en plein cintre ouvrant sur la cour qui ont pu être reprises au XIVe siècle puisqu’un arrachement de mur de direction est-ouest semble indiquer que cette partie se trouvait à l’origine à l’intérieur. Sont également conservées les parties en sous-sol modifiées également au XIVe siècle par la construction d’arcs formerets sur le mur ouest et d’arcs diaphragmes au nord cantonnant une petite voûte destinée à soutenir le passage d’entrée du collège.
Le collège a donc pris place à l’intérieur de ces vestiges modifiés et réadaptés. Il faut lui restituer les trois autres ailes détruites au XIXe siècle, mais dont une série de plans levés en 1753 nous donne une image assez précise. Il se développait sur quatre ailes formant un trapèze autour d’une cour bordée de galeries de bois. L’observation du seul fragment de la galerie ouest aujourd’hui conservé ne fait aucun doute quand à son authenticité, même si l’on peut déceler une reprise importante datable du XVIIe siècle qui a entraîné le changement de certaines pièces de bois dans les parties hautes.
Anne-Laure NAPOLÉONE »
1. M. Meusnier, « Fondation et construction d’un collège universitaire au XIVe siècle : le collège de Périgord à Toulouse », dans Annales du Midi, t. 63, 1951, p. 211-221.
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 275
TOULOUSE, Hôtel Maurand-Collège de Périgord : plan du rez-de-chaussée avant travaux.
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 276
TOULOUSE, Hôtel Maurand-Collège de Périgord : relevé de la façade ouest sur cour (derrière la galerie) avant la pose de l’enduit au rez-de-chaussée.
TOULOUSE, Hôtel Maurand-Collège de Périgord : relevé de la galerie ouest sur cour.
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 277
La Présidente
remercie Anne-Laure Napoléone de tout le travail accompli. Ce premier aperçu donne la
mesure des résultats que l’on peut escompter de l’étude complète de
l’édifice.
Louis Peyrusse ayant
remarqué que l’escalier étudié naguère par Bruno Tollon n’apparaissait pas
sur le plan, Anne-Laure Napoléone précise qu’elle n’en a présenté
volontairement qu’une copie simplifiée.
On rappelle qu’il nous faudra avoir un débat sur les travaux en cours et la manière dont l’affaire a été conduite pour décider d’éventuelles actions à engager. Il sera pour cela nécessaire de prévoir un temps suffisant de discussion lors d’une prochaine séance.
SÉANCE DU 1er AVRIL 2003
Présents : Mme
Pradalier-Schlumberger, Présidente, MM. Cazes, Directeur, Coppolani, Directeur honoraire,
Ahlsell de Toulza, Trésorier, Latour, Bibliothécaire-Archiviste, Scellès, Secrétaire
général, Cabau, Secrétaire-adjoint ; Mmes Pousthomis-Dalle, Watin-Grandchamp, MM.
Boudartchouk, l’abbé Baccrabère, Bordes, Hermet, le Père Montagnes, membres
titulaires ; Mmes Bayle, Bellin, Blanc-Rouquette, Boussoutrot, Czerniak, Fournié,
Stutz, MM. Manuel, Molet, Rebière, Testard, membres correspondants.
Excusés : Mme Napoléone, MM. Lapart, Garland, Pradalier.
Le Secrétaire général donne lecture du procès-verbal de la séance du 25 mars, qui est adopté.
La Présidente rend compte de la correspondance manuscrite. M. Bernard Dumolard, Sous-Préfet honoraire, prie notre Société de bien vouloir excuser son absence à notre séance publique.
La parole est alors à Patrice Cabau, qui tient à protester par avance, et en dépit de la date, du parfait sérieux de sa communication : Saint Saturnin, premier évêque de Toulouse ?
La Présidente remercie Patrice Cabau pour cette recherche très érudite qui met bien en évidence les ambiguïtés de la tradition liée à saint Saturnin.
Henri Molet ayant
rappelé l’attention sur l’activité organisatrice du pape Fabien (236-250),
Patrice Cabau précise qu’elle s’est a priori limitée à Rome. Au début du IVe
siècle, l’Église est encore dans une phase de transition, et son organisation est
très floue et n’est pas celle que l’on connaît pour l’Empire, aux
environs de 400, avec la Notitia.
L’action de Fabien à Rome permet d’imaginer l’envoi d’évêques dans
des régions des Gaules qui n’auraient pas encore été organisées.
Henri Molet rappelle
que des tombes chrétiennes des années 180-200 ont été trouvées près des sites de
garnison du Rhin. Après avoir cité les autres exemples de Marseille et Mérida où le
christianisme s’implante aussi avant 250, Patrice Cabau note que c’est souvent
avec les persécutions que des noms apparaissent, témoignant d’une organisation en
place. Vers 400, Sulpice Sévère déclare cependant que le christianisme fut reçu assez
tard en deçà des Alpes. Par ailleurs, en 314, au concile d’Arles, non seulement les
circonscriptions ecclésiastiques paraissent encore très floues mais encore un diocèse
est-il éventuellement représenté par un évêque, un diacre, un lecteur ou un
exorciste.
Daniel Cazes fait
observer que dans l’Empire du deuxième siècle, le réseau des villes est encore
très présent et qu’une diffusion précoce du christianisme n’aurait donc rien
de surprenant ; il n’y a pas lieu de supposer un désert en dehors de Lyon.
Patrice Cabau affirme que c’est tout à fait son opinion, et il ajoute que
l’absence de traces archéologiques n’est peut-être due qu’au fait
qu’elles n’ont pas été vues. On constate que dans le diocèse des Gaules (mais
peut-on l’appeler ainsi ?) existe vers 170 une communauté orientale chrétienne
à Lyon et qu’en 250, Saturnin, qui est dit primus
ac summus, est accompagné d’un diacre et d’un prêtre, ce qui indique que
la communauté est structurée, mais rien n’interdit une diffusion du christianisme
à Toulouse dès le deuxième siècle.
Daniel Cazes dit ne pas
avoir bien compris pourquoi notre confrère remettait en cause le témoignage de Sidoine
Apollinaire. Pour Patrice Cabau, il s’agit d’un simple problème grammatical
qu’il explique à nouveau. Louis Latour relève qu’en effet la cinquième
strophe fait écho à la deuxième.
Henri Molet cite un
traité des années 1250, dont le manuscrit est conservé à la British Library et qui
n’a jamais été traduit en français hormis quelques extraits, dont l’auteur,
Jean de Garlande, se moque de la prétention des Toulousains à avoir eu le premier
évêque des Gaules, et, qui plus est, directement envoyé par saint Pierre. Patrice Cabau
précise à ce propos qu’au Moyen Âge, l’expression « saint
Pierre » peut désigner l’évêque de Rome, même si elle peut aussi être
prise à la lettre.
Relevant que Patrice
Cabau a beaucoup insisté sur le fait que le Moyen Âge invoquait le martyr avant
l’évêque, Jean-Luc Boudartchouk dit qu’il est normal que soit mis en avant ce
qui est le titre de gloire de Saturnin. Patrice Cabau acquiesce en ajoutant que la mention
de l’évêque apparaît surtout quand se fait jour un souci historique.
Mme Bayle demande si
l’on peut imaginer chez les premiers chrétiens des évêques sans attribution
territoriale, comme on en connaît chez les cathares. Patrice Cabau explique que la
compétence géographique des évêques des premiers siècles est très incertaine et que
l’on ne sait, quand on a mention d’un évêque de Toulouse, s’il faut
entendre « de la ville » ou « de la cité », au sens territorial
du mot.
Dominique
Watin-Grandchamp s’étonne que la cathédrale de Toulouse ne réclame pas saint
Saturnin en tant que premier évêque de Toulouse. Michelle Fournié rappelle que les
premiers évêques sont habituellement enterrés hors les murs, dans des basiliques
funéraires. On peut parfois se demander si elles n’ont pas fait fonction de
cathédrale primitive : la question se pose à Agen, par exemple, où la basilique
est une étape obligatoire de l’intronisation de tout nouvel évêque avant
qu’il ne gagne sa
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 278
cathédrale. Patrice Cabau indique par ailleurs que les inhumations des évêques dans les cathédrales ne semblent pas se généraliser avant le XIIIe siècle, excepté à Lodève où l’on en a mention avant l’an mil, mais dans un contexte topographique très particulier. Pour Toulouse, notre ignorance est à peu près complète jusqu’à la première inhumation attestée à la cathédrale en 1286. Michelle Fournié ajoute que les évêques de Bourges ne sont jamais enterrés dans la cathédrale avant la fin du XIe siècle.
SÉANCE DU 15 AVRIL 2003
Présents : Mme
Pradalier-Schlumberger, Présidente, MM. Cazes, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier,
Scellès, Secrétaire général, Cabau, Secrétaire-adjoint ; Mmes Cazes, Napoléone,
M. l’abbé Baccrabère, membres titulaires ; Mmes Czerniak, Fronton-Wessel, MM.
Manuel, Salvan-Guillotin, membres correspondants.
Excusés : M. Latour, Bibliothécaire-Archiviste, Mme Bayle, MM. Bordes, Pradalier.
Le Secrétaire général donne lecture du procès-verbal de la séance du 1er avril, qui est adopté à l’unanimité. La Présidente rend compte de la correspondance manuscrite. La Mairie de Toulouse confirme la subvention de fonctionnement qu’elle nous attribue chaque année.
L’ordre du jour
appelle l’élection d’un membre correspondant. Le rapport de Mme Virginie
Czerniak entendu, M. Jean-Marc Stouffs, restaurateur, est élu membre correspondant de
notre Société.
La Présidente se
félicite de l’élection de M. Jean-Marc Stouffs qui nous entretiendra sans doute de
ses chantiers de restauration et que nous aurons en particulier à cœur de suivre
pour la deuxième tranche de travaux des peintures murales de Notre-Dame-du-Taur.
La parole est à Marie-Laure Fronton-Wessel pour une communication sur Les corbeaux peints de l’église de Trèbes (Aude), publiée dans ce volume (t. LXIII, 2003) de nos Mémoires.
La Présidente
remercie Marie-Laure Fronton-Wessel pour cette communication qui nous permet de voir enfin
les corbeaux de Trèbes, peu visibles du sol et dont la couverture photographique
n’avait encore jamais été diffusée. L’ensemble constitue un matériel
d’une très grande richesse, représentatif d’un art populaire dont les
différences de qualité avec les décors de l’église d’Aragon, dans le
Cabardès, sont très perceptibles. On a en effet affaire à un phénomène de mode qui
concerne une aire assez réduite.
Quitterie Cazes se
demande s’il faut vraiment parler de registres à propos de la répartition des
décors sur les corbeaux et s’il ne vaudrait pas mieux s’en tenir à la notion
de profil, auquel s’adaptent les peintures. Par ailleurs, il est bien difficile de
considérer que l’on est en présence d’un programme iconographique devant ces
quelque trois cents corbeaux dont les motifs se succèdent sans ordre, tout au moins
apparent. Quant au changement de style qui apparaît avec la travée J, Quitterie Cazes
voudrait savoir s’il peut être mis en relation avec une éventuelle césure dans
l’architecture. Marie-Laure Fronton-Wessel précise que les maçonneries ne montrent
aucune trace de rupture de chantier, mais qu’un changement apparaît à ce niveau
dans les bases des colonnes avec l’apparition de griffes. Pour Maurice Scellès,
l’apparition d’une nouvelle forme de bases doit probablement être considérée
comme la marque d’une nouvelle campagne de construction, même si les deux campagnes
sont très rapprochées dans le temps.
Quitterie Cazes demande
si les planches de la volige étaient peintes. Marie-Laure Fronton-Wessel ne le pense
pas : seuls les corbeaux et parfois les pannes sont décorés. Répondant à une
nouvelle question de Quitterie Cazes, Marie-Laure Fronton-Wessel indique qu’aucune
analyse de dendrochronologie n’a été réalisée à Trèbes et qu’aucune
n’est actuellement prévue. Quitterie Cazes demande encore si l’on peut imaginer
une production d’atelier en série sans lien direct avec le chantier. Marie-Laure
Fronton-Wessel explique que l’homogénéité du décor et la répartition en deux
séries sont plutôt en faveur d’une réalisation sur place. La Présidente remarque
en outre que certains de ces décors occupent des emplacements précis dans
l’édifice.
Pour ce qui est
de l’identification des figures, Daniel Cazes y voit la représentation de types
sociaux, avec un répertoire très général qui est celui des arts décoratifs. Des
modèles ou des comparaisons pourraient être recherchés dans les autres techniques
artistiques, par exemple la céramique. Les répertoires décoratifs des carreaux
émaillés utilisent aussi ces différents types de représentations : telle tête
masculine de Trèbes est semblable à celle qui figure sur un carreau émaillé retrouvé
par Maurice Prin aux Jacobins de Toulouse. Pour aller dans ce sens, Virginie Czerniak
évoque les animaux tout à fait semblables à ceux de Trèbes qui apparaissent sur un
plafond conservé au musée de Metz, et Marc Salvan-Guillotin cite les décors des
plafonds d’Albi.
Le fait que le décor
n’ait pas été complété une fois le corbeau mis en place ou, au contraire,
qu’une partie du décor soit engagé dans la maçonnerie des arcs diaphragmes sont
pour Maurice Scellès les marques d’une mise en œuvre rapide. On en a également
des exemples dans l’architecture civile, avec des ais d’entrevous dont une
partie du décor peint est coupée au moment de la pose pour ajuster la planchette. De
fait, les décors peints des murs révèlent une identique rapidité d’exécution.
C’est l’effet d’ensemble qui compte.
Maurice Scellès fait
en outre remarquer que les coiffures « à la saint Louis » identifient sans
ambiguïté des figures masculines. Marie-Laure Fronton-Wessel dit qu’en effet
l’incertitude porte sur une seule figure.
Sur la question de
savoir s’il faut parler de deux ateliers, ou d’un maître et de ses compagnons,
Marie-Laure Fronton-Wessel rappelle que les notions d’« atelier », de
« maître » ou de « main » sont toujours difficiles à définir
pour cette époque. Dans le cas de Trèbes, l’intervention de deux peintres ne semble
pas devoir être mise en doute.
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 279
Quitterie Cazes
observe que les photographies montrent assez que le ou les peintres ont un dessin très
alerte qui n’a rien de médiocre. Les murs étaient-ils également peints ?
Marie-Laure Fronton-Wessel indique que jamais on ne trouve simultanément des décors sur
les charpentes et sur les murs dans les édifices que l’on connaît aujourd’hui.
Dans le cas de Capestang, qu’évoque la Présidente, ce sont deux ateliers
différents qui sont intervenus sur la charpente et sur les murs.
Virginie Czerniak
signale qu’une figure à oreilles d’âne existe dans le décor d’un manoir
du Berry et qu’il s’agit d’une représentation carnavalesque, au même
titre que les lions de Trèbes. Marc Salvan-Guillotin en cite un exemple sculpté sur un
chapiteau du cloître des Augustins. La tête noire à hure de sanglier pourrait relever
de ce même répertoire.
Répondant à une
question de Patrice Cabau, Marie-Laure Fronton-Wessel précise que les corbeaux traversent
en effet toute la maçonnerie des arcs et forment donc des paires, sans qu’il y ait
pour autant aucune correspondance dans les thèmes représentés.
Patrice Cabau relève
que les joints de la volige sont fixés par-dessous et que leur pose a donc nécessité
l’installation d’un échafaudage. L’état actuel reproduit-il les
dispositions antérieures ? Marie-Laure Fronton-Wessel avoue ne pas le savoir et elle
précise qu’il n’existe aucune photographie prise avant ou pendant les travaux
de 1977. L’édifice étant cependant inscrit à l’inventaire supplémentaire des
Monuments historiques, un dossier de travaux devrait exister chez le restaurateur.
Patrice Cabau se
demande si la volige, actuellement en pin semble-t-il, était laissée à l’état
brut. On indique que jusqu’au XVIIe siècle les menuiseries des fenêtres
ne sont pas peintes. Maurice Scellès constate à son tour que les charpentes peintes des
bâtiments civils juxtaposent des éléments décorés et des pièces laissées au
naturel. La discussion se poursuit sur l’aire prise en compte, sur les grandes salles
de l’architecture civile, sur les salles épiscopales…
Au titre des questions diverses, Daniel Cazes informe la Compagnie de l’ouverture récente, au Musée d’histoire de la Catalogne à Barcelone, de l’exposition Cathares et troubadours. L’Occitanie et la Catalogne, renaissance et futur. Il en recommande chaleureusement la visite en précisant qu’elle est présentée jusqu’au 27 juillet prochain.
En préalable à la discussion sur les travaux en cours au collège de Périgord, la Compagnie examine une série de diapositives présentant les différentes parties de l’édifice.
En guise de remarque liminaire, plusieurs membres déclarent ne pouvoir retenir leur colère devant le spectacle que donne un chantier aussi mal tenu, devant autant de ferraille et de béton… Tout montre la plus totale absence de sensibilité au lieu et aux bâtiments existants.
Sans doute nous faut-il d’abord nous-mêmes battre notre coulpe. En juin 2000, nous avons certes adressé au Conservateur régional des Monuments historiques une demande d’extension de la protection au titre des Monuments historiques mais nous avons eu le tort d’en rester à l’enregistrement du refus, laissant à l’Histoire le soin de juger. Il fallait faire appel de la décision auprès du Directeur régional des Affaires culturelles, du Préfet voire si nécessaire auprès du Ministre de la Culture, d’autant plus, nous le savons aujourd’hui, que le Conservateur régional des Monuments historiques ne pouvait refuser d’instruire le dossier. Seule la délégation permanente peut décider l’interruption d’une instruction, que le Conservateur régional ne peut en aucun cas refuser de son propre chef. Celui-ci n’est d’ailleurs pas habilité à prendre des décisions qui relèvent de la responsabilité du préfet. Nous devons en tirer la leçon pour les actions à entreprendre aujourd’hui et à l’avenir.
On fait par ailleurs observer que l’indifférence générale avec laquelle l’Université a traité les bâtiments du collège de Périgord est peut être révélatrice de l’état d’une société. Nous fustigeons souvent, et à juste titre, l’enseignement de rupture qui est dispensé dans les écoles d’architecture, qui forment des architectes dont la culture commence au mieux avec Le Corbusier. Mais ne sommes-nous pas en présence d’une culture de rupture quand, hormis quelques exceptions individuelles, l’ensemble du corps enseignant d’une université et son président méconnaissent totalement un édifice majeur du patrimoine de leur ville et aussi emblématique de l’histoire de leur propre institution ? Quelle est donc aujourd’hui la culture d’une élite intellectuelle qui est censée appartenir à la frange la plus cultivée de la population ?
Faut-il croire que la conservation du patrimoine n’est le souci que d’une part réduite de la société, dont nous sommes ? Plusieurs membres réaffirment que ce qui se passe au collège de Périgord est inexcusable. Le problème n’est certes pas spécifique à l’université mais concerne l’ensemble de la société française. Il est bien difficile de ne pas faire le parallèle avec le sort promis aux fouilles archéologiques, rangées parmi les activités privées et qui devraient être à ce titre soumises à la concurrence : l’archéologie n’est plus d’intérêt national dans un pays où l’histoire architecturale et le patrimoine en général ne sont plus reconnus comme des valeurs autres qu’économiques. On constate que l’on assiste effectivement à une réduction très importante du champ de ce qui était considéré comme relevant de l’intérêt public.
On relève le paradoxe d’un intérêt touristique depuis longtemps reconnu et le massacre qui est opéré aujourd’hui. Peut-on ignorer au début du XXIe siècle l’intérêt historique, archéologique, artistique et touristique de la tour Maurand et des bâtiments adjacents dévolus au Moyen Âge au Collège de Périgord ? Comment concevoir que les bâtiments de la tour Maurand et adjacents à celle-ci aient pu être considérés comme une simple structure architecturale à réutiliser en en modifiant sans limite les ouvertures, les espaces intérieurs, les plafonds et planchers alors que l’ensemble a une véritable valeur archéologique, historique et artistique ? Peut-on imaginer un instant que l’Université propriétaire des lieux, au sein de laquelle existe un puissant département d’histoire, d’histoire de l’art et d’archéologie, ait totalement ignoré cette valeur patrimoniale essentielle lorsque ses instances supérieures ont décidé d’affecter ces lieux au département audiovisuel et d’y réaliser des travaux conséquents ? Les historiens du Mirail pouvaient-ils ne pas savoir le rôle joué par la famille Maurand au XIIe siècle, dans l’histoire du catharisme toulousain ? Le sort de Pierre Maurand et de sa tour est connu très largement : toutes les histoires de Toulouse, tous les ouvrages sur le catharisme, savants ou de divulgation, l’évoquent. Et l’on sait la ferveur qui entoure aujourd’hui tout ce qui touche au catharisme dans la culture
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 280
historique des méridionaux et dans le
formidable développement touristique du Grand Sud-Ouest français. Ajoutons que la
littérature historique et touristique lui accorde une part prépondérante dans des
publications faites dans la majorité des langues étrangères. Quel paradoxe
incompréhensible ! L’Université des Lettres de Toulouse, la Direction
régionale des Affaires culturelles, la Direction de la Culture et de l’Audiovisuel
du Conseil régional de Midi-Pyrénées, le Comité départemental du Tourisme,
l’Office du Tourisme de Toulouse et Midi-Pyrénées, la Mairie de Toulouse
peuvent-ils être indifférents à la préservation et la mise en valeur d’un tel
monument ?
Dès les années 1940,
le Syndicat d’Initiative de Toulouse avait fait encastrer dans la façade sur la rue
du Taur de la tour Maurand une pierre gravée d’une inscription mentionnant
l’identité et l’intérêt du lieu pour les visiteurs de la ville. Depuis 1969,
l’Association toulousaine d’histoire de l’art (devenue aujourd’hui
l’association Arthémis) fait régulièrement étape à la tour Maurand, dans le
cadre de l’organisation de ses visites thématiques du patrimoine toulousain,
accompagne ses visiteurs dans la cour du 56 rue du Taur pour évoquer l’histoire,
présenter l’architecture d’un haut-lieu de Toulouse où, à des demeures
aristocratiques des XIe, XIIe et XIIIe siècles, a
succédé un des collèges médiévaux les plus célèbres de Toulouse, celui de
Périgord, qui a laissé son nom à la rue voisine. Sa galerie de bois médiévale,
toujours admirée, est une rareté dans Toulouse. Alors qu’est sans cesse mise en
avant l’importance économique du tourisme, on détruit le patrimoine qui en est le
support, et l’administration faite pour le protéger lui tourne le dos. Une nullité
et une incohérence totales.
Il paraît important de souligner l’incapacité la plus généralement rencontrée à imaginer ce que peut être la qualité des vestiges des bâtiments anciens et ce que l’on pourrait en faire. L’imagination des maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage relève le plus souvent de l’esthétique de la salle de bains et de nombreux maires ne sont pas très contents si on ne leur livre pas une église rutilante à la fin des travaux. Il y a en effet un problème de références et en particulier pour les administrations. Quelles sont les références des administrations chargées du patrimoine ? Il semblerait naturel que la règle soit d’étudier l’édifice dans un premier temps puis d’établir ensuite le projet sur la base de l’étude archéologique.
Un membre affirme à son tour que l’on fait les choses à l’envers. Un autre se demande encore s’il faut toujours réutiliser un monument. On fait remarquer qu’à l’échelle d’une ville, tout peut être monument et qu’une ville ne vit que si elle est habitée. En fait, il y a rarement incompatibilité réelle, à la condition que l’étude soit bien menée en amont.
Il est précisé que l’architecte en chef des Monuments historiques est non seulement hors de cause mais qu’on lui doit d’avoir arrêté le projet d’un ascenseur qui devait être installé dans la tour Maurand ! « En éventrant les voûtes ? » demande-t-on ? « Oui » est-il répondu en faisant remarquer qu’il y a là un point qui pourrait servir de levier : il faudrait vérifier si les avis ont été donnés sur un projet incluant l’installation d’un ascenseur dans la tour. On rappelle que les deux ailes du collège de Périgord sont accolées à la tour Maurand, classée Monument historique, et qu’elles sont donc sous le contrôle de l’architecte des Bâtiments de France.
Un membre dit combien lui apparaît grave l’absence de synthèse entre les différentes administrations qui ont en charge le patrimoine, carence qu’il dénonce systématiquement. Le système est beaucoup trop cloisonné et on aimerait voir se rencontrer les personnels de l’archéologie, de l’Inventaire, des Monuments historiques et les chercheurs de l’Université et du C.N.R.S. On peut finalement se demander à quoi servent une préfecture et une direction régionale des Affaires culturelles.
On fait remarquer que l’on a beaucoup cité les exemples de l’Italie et de l’Espagne mais en oubliant que tout n’y est pas non plus parfait et on rappelle les scandales dus aux travaux du Jubilé à Rome. Il faut cependant convenir que la différence, c’est justement qu’il y a eu scandale, ce qui n’est pas le cas à Toulouse.
Il semble que l’architecte aurait été disposé à modifier son projet si on le lui avait demandé. Pour certains, il n’y a pas lieu de dédouaner l’architecte qui n’a pas su conseiller le maître d’ouvrage. En outre, il paraît totalement inadmissible qu’une porte moderne ait été percée à côté d’une porte médiévale qui, dans n’importe quel autre pays, aurait été mise en valeur. On fait valoir qu’il peut s’agir d’une erreur, mais que c’est aussi l’expression d’une idéologie, assez largement répandue dans ce milieu, selon laquelle il faut absolument inscrire l’architecture contemporaine dans les centres anciens.
Plusieurs membres pensent qu’il faut demander l’arrêt des travaux. On convient que des courriers en ce sens devront être adressés au Directeur régional des Affaires culturelles et au Président de l’Université, mais également au Préfet et au Maire de Toulouse. On insiste sur la nécessité de préserver les peintures murales de l’ancienne chapelle.
La Présidente craint que les démarches qu’entreprendra notre Société ne nous interdisent désormais l’accès au bâtiment. Il est décidé que le Bureau se réunira dès la semaine prochaine pour établir le courrier et le dossier qui seront envoyés pour demander l’arrêt des travaux et l’instance de classement du collège de Périgord.
SÉANCE DU 6 MAI 2003
Présents : Mme
Pradalier-Schlumberger, Présidente, MM. Cazes, Directeur, Coppolani, Directeur honoraire,
Scellès, Secrétaire général, Cabau, Secrétaire-adjoint, Latour,
Bibliothécaire-Archiviste ; Mmes Cazes, Napoléone, Watin-Grandchamp, MM.
l’abbé Baccrabère, Prin, membres titulaires ; Mmes Bayle, Bellin,
Félix-Kerbrat, Fournié, Galés, Merlet-Bagnéris, Stutz, MM. Bordes, Boudartchouk,
Garland, Manuel, Molet, Stouffs, Testard, Vézian, membres correspondants.
Excusés : M. Ahlsell de Toulza, Trésorier ; Mgr Rocacher, MM. Lapart,
Peyrusse.
Invitée : Mme Jacqueline Caille.
La Présidente ouvre la séance à 17 h. Après avoir souhaité la bienvenue à M. Jean-Marc Stouffs, élu membre correspondant le 15 avril dernier et qui prend séance, elle accueille notre invitée de ce soir, Mme Jacqueline Caille, auteur d’une thèse de troisième cycle sur l’église de la Daurade à Toulouse, en voie de publication par le C.T.H.S.
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 281
La parole est au Secrétaire général pour la lecture du procès-verbal de la séance du 15 avril, qui est adopté.
La Présidente rend compte ensuite de la correspondance manuscrite, qui comprend notamment l’annonce de deux colloques intéressants, dont le premier est organisé par notre confrère Pascal Julien :
– « Marbres de Rois, XVIIe et XVIIIe s. », à tenir les 23 et 24 mai 2003 dans la Galerie basse du château de Versailles ;
– « Chrétiens et Musulmans, autour de 1100 », « Journées Romanes » à tenir du 8 au 15 juillet 2003 à l’abbaye Saint-Michel de Cuxa.
Puis elle présente une série d’ouvrages anciens que Maurice Scellès offre à notre bibliothèque :
– Fleury, Histoire ecclésiastique, nouvelle édition, Pierre Beaume, Nîmes, 1779, 4 volumes sur 24 : t. 7, Depuis l’an 795, jusqu’à l’an 878, 700 p. ; t. 8, 616 p. ; t. 10, Depuis l’an 1129, jusqu’en 1298, 680 p. ; t. 11, Depuis l’an 1197, jusqu’en 1243, 690 p.
– Jean Calmon et René Prat, Les cadastres des XVIe et XVIIe siècles de la Ville de Cahors (1500-1606-1650), Cahors, première partie, 1947-1951 (372 p.) ; seconde partie, 1957-1958 (env. 240 p.).
Mme Pradalier-Schlumberger remercie vivement M. Scellès pour ces dons précieux.
La parole est à Emmanuel Garland pour la première communication du jour, intitulée La restauration de Notre-Dame de Cap d’Aran (Val d’Aran), publiée dans ce volume (t. LXIII, 2003) de nos Mémoires.
La Présidente remercie le conférencier, signalant le plaisir qu’elle a pris à entendre un exposé consacré à la monographie d’une église romane, sujet devenu rare. Elle note que l’édifice présenté s’inscrit dans la lignée de ceux du Val de Boi. Pour toutes ces églises des Pyrénées, on ne peut s’appuyer sur aucune date, de sorte que leur chronologie demeure problématique. Concernant Santa Maria de Cap d’Aran, à Tredos, il est effectivement fort probable que l’abside principale correspondait à une nef initiale unique. Emmanuel Garland souligne encore une fois que cette construction primitive, toute modeste, était bien proportionnée. Michèle Pradalier-Schlumberger s’étant enquise de la nature des matériaux utilisés dans la construction, M. Garland précise que, comme pour les autres églises du Val d’Aran, on a mis d’abord en œuvre certaine pierre rousse, puis un calcaire froid de couleur grise, très majoritairement employé à partir du milieu du XIIe siècle. Daniel Cazes se demande si les portails et les baies n’ont pas fait l’objet de remaniements. M. Garland répond que les ouvertures pratiquées dans le mur nord paraissent cohérentes avec une datation de la seconde moitié du XIIe siècle, voire du début du XIIIe, la « rupture ogivale » ne s’étant produite en Val d’Aran que dans les années 1225/1250.
Pour Quitterie Cazes, l’analyse architecturale de l’église de Tredos, « compliquée juste ce qu’il faut », représente un « rêve d’archéologue ». Les photographies projetées montraient un nombre considérable de reprises de maçonnerie. Il faut donc pousser l’étude, l’affiner par le relevé systématique des élévations, l’identification des matériaux et le repérage des éléments réutilisés. Mme Cazes note ainsi que le tympan du portail sud, qui porte un chrisme signé AT CENTVL ME FECIT, paraît bien être en remploi. M. Garland signale que ce chrisme est de la même main que celui de Salardú. Il ajoute que l’église du Cap-d’Aran a passablement souffert, sous l’effet notamment de plusieurs tremblements de terre, et que la restauration de l’édifice a eu lieu dans des circonstances peu orientées vers l’observation archéologique fine : il s’agissait de rendre visitable un édifice situé sur les « routes romanes », et la remise en état s’est faite sous la direction d’un architecte du Pallars.
Michèle Pradalier-Schlumberger demande s’il existe dans les constructions romanes des exemples de voûte en cul-de-four sous-tendue par une nervure centrale analogues à celui de la demi-crypte de Tredos. Emmanuel Garland déclare que ce type de voûte est rare, mais pas inconnu. On s’accorde à considérer que la voûte en cause résulte d’une reprise.
Un membre revient sur la question des arguments servant à justifier la datation du mur nord. M. Garland dit qu’il a essentiellement fondé sa proposition – seconde moitié du XIIe siècle, sinon début du XIIIe – sur l’étude de la mise en œuvre des matériaux, du vocabulaire du décor sculpté, et une comparaison avec les autres églises du Val d’Aran, celle de Vilach par exemple. Dominique Watin-Grandchamp pose de nouveau le problème des remontages : les éléments formant l’encadrement des baies du mur nord ont été manifestement remis en œuvre. Emmanuel Garland convient que ces fenêtres ont été élargies.
La Présidente annonce les exposés de la deuxième partie de la séance, consacrée à Notre-Dame la Daurade.
Quitterie Cazes présente une communication courte intitulée L’église médiévale de la Daurade à Toulouse, publiée dans ce volume (t. LXIII, 2003) de nos Mémoires.
Jean-Luc Boudartchouk et Quitterie Cazes rendent compte des observations faites tout récemment sur les vestiges de structures de la Daurade antique dégagés en 1961, que Michel Labrousse avait signalés dans Toulouse antique en 1968 :
« Les sondages de 1961 dans l’abside de l’ancienne église de la Daurade
En 1961, trois sondages archéologiques furent menés à l’emplacement du sanctuaire de l’église de la Daurade démolie entre 1761 et 1763. Les deux responsables, É. Delaruelle et P. Fort, M. Labrousse, M. Durliat, R. Camboulives, G. Leblanc et M. Prin, tous membres de la Société Archéologique du Midi de la France, se succédèrent pour surveiller les fouilles effectuées par quatre à cinq ouvriers de l’entreprise Sagné. Ils tinrent un journal de fouilles, aujourd’hui conservé dans les Archives de la Société archéologique : c’est le seul document qui
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 282
nous transmet les résultats des travaux, qui s’achevèrent le 31 mai de la même année. Les résultats leur semblèrent relativement décevants : “Les dernières fouilles faites à la Daurade en 1960-61 n’ont pas permis de retrouver, comme il était espéré, les murs du décagone primitif, mais elles ont rencontré, au moins en remploi, quelques matériaux romains, en particulier des briques estampillées” [1]. M. Labrousse demanda cependant, le 12 avril 1962, le classement des vestiges au titre des Monuments Historiques : un sol bétonné, et un mur “qui, par son orientation, répond, semble-t-il, à l’un des côtés de ce décagone et atteste le remploi de matériaux romains, dont des briques estampillées”. S. Stym-Popper, architecte en chef, fit alors procéder à la remise en état des sols et, surtout, créa une crypte archéologique, de sorte que deux des trois sondages [2] sont toujours accessibles. Grâce à cela, nous avons pu procéder, du 22 au 24 avril 2003 [3], au réexamen des vestiges après un léger nettoyage (essentiellement à l’aspirateur) et, après relevés, à une nouvelle interprétation qui conduit à renouveler une part non négligeable des propositions faites jusqu’à présent.
Analyse des vestiges
Salle 1
Les éléments les plus anciens sont mis en place dans un remblai anthropisé (US 114) directement sur le substrat de graves. Il s’agit d’un petit mur (US 108) de direction est-ouest, de 0,35 m de largeur, conservé sur 0,95 m de longueur. Sur une fondation débordante de galets liés au mortier, cinq assises subsistent. Les briques, de 23 cm x 37 cm x 3,5 cm, sont homogènes et “propres” : il ne s’agit pas de récupération. Perpendiculaire à lui, a subsisté un tronçon de caniveau (US 109), de pendage sud-nord. Deux assises de briques forment le conduit, large de 0,10 m, établi sur une fondation large de 0,35 m. La petite face des briques est systématiquement utilisée en parement. Ces deux éléments, mur et caniveau, sont détruits par une même fosse (US 106), et l’arase du mur est recouverte par deux remblais (US 104 et 105).
Un autre segment de mur de briques (US 112), de direction est-ouest, est recoupé à l’est par une grande tranchée de fondation 110, à l’ouest par un mur de liaison des piliers de la croisée du transept (US 101), et son parement nord est hors des limites du sondage. Sa direction est donnée par le seul bord visible de sa tranchée de fondation, côté sud, sur 0,50 m de longueur. Sa largeur observée est de 0,95 m et sa hauteur de 0,60 m.
Un énorme massif (US 111) n’a conservé qu’une partie de sa maçonnerie, dans l’angle sud-ouest de la tranchée creusée pour le construire (US 110). De celle-ci, on ne connaît qu’une partie de son bord sud, pas exactement rectiligne, dégagé sur 4,60 m de long, et de son bord ouest, visible sur 1,95 m. Elle vient recouper toutes les structures déjà citées. Ce massif est fait de galets non sélectionnés, jetés dans le mortier sans aucune organisation particulière. Un tout autre vestige peut être rapproché d’un point de vue chronologique : il s’agit des restes d’un sol de mortier de tuileau (US 103), conservé sur une surface d’environ 1 m2. Établi sur le remblai 105 et d’une épaisseur de 0,15 m, il est composé de fragments de briques et éclats de galets liés par un mortier d’une couleur rose pâle, posé sur un hérisson de petits galets. La surface, plus ou moins lissée, a été rechapée avec du mortier blanc.
Les coupes est et nord du sondage montrent de très grands remblais meubles (US 118), qui occupent toute la hauteur, depuis le fond de la tranchée de récupération du massif 111 jusqu’à quelques décimètres de la dalle de béton portant le sol de l’église actuelle : cela atteste d’une part que le remblaiement s’est fait en une seule fois, et d’autre part que le niveau du sol à l’époque où l’on effectuait ce comblement était à peu près le même que celui du sol actuel. Ils ne sont recoupés que par les tranchées de fondation des murs de chaînage 100 et 101 qui appartiennent à la construction de l’église actuelle.
Salle 2
Les structures antiques sont fondées à travers le substrat géologique en place : des graves de Garonne à petits galets (US 213). L’élément le plus ancien est l’angle d’un mur est-ouest (US 212), formé d’un hérisson de galets et fragments de brique, surmonté d’une solide maçonnerie en opus caementicium, conservée sur une hauteur de 24 cm. Sa largeur est inconnue (il se trouve à la limite nord du sondage). Perpendiculaire à lui et appuyé contre sa face est, le mur 211 est formé d’un opus caementicium (H. cons. : 35 cm) reposant sur un puissant hérisson de galets.
Le mur 212 est coupé lors de l’installation d’une canalisation de briques orientée nord-sud (US 208). Sa base, non liée au mortier, est constituée de briques entières (23 x 30 x 3,4 cm) disposées dans leur largeur. Les montants comprennent quatre assises de demi-briques liées au mortier, se rapprochant de plus en plus pour former une fausse voûte, couronnée par une cinquième assise. Il en résulte une conduite de section pyramidale (17 x 13 cm), pour une emprise en coupe de 45/50 x 25cm. Plusieurs briques ont livré des estampilles. On peut y lire les timbres : SPARTACI ; (SPARTA)CI ; SPA(RTACI) ; Q?(PS ?). À l’extrémité sud (point haut) paraît se trouver l’arrivée d’un puisard : un empilement de briques remplace la base de la conduite. À l’autre extrémité, le conduit s’incurve vers le nord-ouest.
La canalisation est partiellement détruite par une fosse ou tranchée remplie de gros galets (US 207), qui paraissent disposés sur deux assises (?). Cette couche est recouverte par une chape de galets (US 206) liés par un mortier de chaux gris résistant. Le mur 211, arasé, ainsi que le sommet de 206 sont ensuite recouverts par un sol de mortier rosâtre (US 205) épais de 5 à 7 cm. La partie basse de ce sol de circulation est constituée de fragments de briques et de tuileaux grossiers inclus dans un mortier de chaux. Sa partie supérieure est un mortier de tuileau plus fin, rosâtre. Ce sol paraît exister sur l’ensemble de la salle 2.
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 283
TOULOUSE, ANCIENNE ÉGLISE NOTRE-DAME LA
DAURADE,
plan des vestiges relevés dans la crypte archéologique (avril 2003).
|
TOULOUSE, ANCIENNE ÉGLISE NOTRE-DAME LA DAURADE, |
TOULOUSE, ANCIENNE ÉGLISE NOTRE-DAME LA DAURADE, |
Immédiatement sur le sol 205 sont épandus des matériaux de destruction qui correspondent à la destruction de l’église médiévale (US 204). À l’église moderne appartient le puissant mur de briques 203, fondation du premier pilier de la nef, contre lequel vient buter une nouvelle couche de démolition (US 202) contenant des débris pulvérulents provenant de matériaux divers. Enfin, un remblai limoneux noirâtre et meuble (H. reconnue : plus de 1,10 m) est mis en place ; il marque le sommet de la stratigraphie.
Chronologie relative des vestiges
Phase 1 - Antiquité I. Dans la salle 2, les deux murs antiques en opus caementicium marquent le début de l’occupation. Le plus ancien est endommagé par la canalisation, qui est parallèle au plus récent. La datation de cette canalisation est suggérée par la répétition de l’estampille SPARTACI et par l’emploi de briques de première main qui incitent à rattacher cette canalisation à l’Antiquité classique – cette estampille est attestée entre 20 et 50 de notre ère [4]. Dans la salle 1, la première phase est représentée par le petit mur de briques 108, de direction est-ouest, et par le caniveau 109, qui a la même orientation et paraît avoir la même position stratigraphique que celui de la salle 2. Ces vestiges témoignent d’une occupation “légère”, qui peut faire référence à de l’architecture domestique.
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 284
TOULOUSE, ANCIENNE ÉGLISE NOTRE-DAME LA DAURADE,
vestiges conservés dans la crypte archéologique replacés par rapport à l’église actuelle et à l’église ancienne (d’après le plan de Franque, A.D. Haute-Garonne, PA 102, en gris).Phase 2 - Antiquité II. On placera le gros mur 112 de la salle 1 dans une phase suivante : son orientation diffère légèrement de celle de 108 ; ses prolongements vers l’est et vers l’ouest ont obligatoirement recoupé les caniveaux 109 et 208. La construction, toute de briques homogènes et liées avec un mortier de grande qualité, fait plutôt référence aux usages du bâti antique que du médiéval. D’une largeur de plus d’1 m, ce mur appartient à un édifice beaucoup plus important que ce qui a existé précédemment. On pourra alors penser à une architecture publique.
Phase 3 - Fin de l’Antiquité ? Le massif 111, d’une longueur est-ouest minimale de 4,60 m pour une largeur minimale de 2 m, représente les restes d’une énorme fondation. Au moment de sa construction, l’extrémité orientale du mur 112 est soigneusement sectionnée, le mortier de 111 venant adhérer directement contre la tranche du mur de briques : il est vraisemblable que la partie conservée de 112 continue d’être utilisée. Sans doute peut-on rattacher le sol 103 à cette phase. Dans la salle 2, les murs comme la canalisation sont mis hors service et arasés, recouverts par le sol de tuileau rosâtre. Ceci marque un changement radical du type d’occupation ; on l’attribuera, à cause de la documentation disponible par ailleurs, au sol de la nef de l’ancienne église.
La construction des murs de liaison de la croisée du transept, la démolition de l’ancienne église dans les années 1761-1763, et peut-être aussi les fouilles de 1961, ont fait apparemment disparaître tout remblai ou élément de construction appartenant à l’époque médiévale.
Phase 4 - Démolition de l’église (1761-1763) et construction de l’église actuelle. L’arasement du massif 111, en réalité sa récupération presque totale, et celui du mur 112, sont directement recouverts par les masses de remblai 118. Ceux-ci apparaissent donc comme directement liés à la démolition de la maçonnerie. Le fait qu’ils soient immédiatement antérieurs à la construction de l’église actuelle permet de penser qu’ils correspondent à la démolition de l’ancienne église. La construction de l’église actuelle, à partir de 1771, est représentée dans les deux sondages par les gros murs qui lient en partie basse les piliers de la croisée du transept, et par les remblais 116 (salle 1) et 202 (salle 2) qui viennent égaliser les remblais antérieurs avant la mise en place du sol de l’église.
Interprétation
Le recalage des plans anciens et des sondages fait apparaître que le gros massif 111 se situe très exactement à l’emplacement du piédroit nord de l’arc triomphal de l’ancienne église. On constate une limite très nette du massif vers le sud : il n’y a donc jamais eu de prolongement de la maçonnerie vers le sud-ouest, qui aurait pu appartenir au décagone imaginé depuis le XVIIIe siècle, mais bien une abside à sept pans, les deux occidentaux refermant légèrement la forme. Il s’agit donc d’une forme architecturale cohérente qui doit être comprise comme une création originale. En second lieu, le caractère soigné de la rupture vers l’est du mur 112 et le fait que le mortier du massif 111 vient se plaquer directement contre sa tranche indiquent que les actions de démolition d’une partie du mur et de construction du massif sont contemporaines. Ils permettent aussi d’envisager que la partie occidentale du mur 112 ait été conservée en élévation. Dans ce cas, nous sommes conduits à renverser la proposition généralement admise depuis Jean de Chabanel [5], qui veut que la nef soit postérieure à l’abside : au contraire, nous pourrions être en présence d’une grande salle antique, dont l’extrémité orientale aurait été démolie pour laisser place à l’abside à sept pans. Les sols conservés viennent à l’emplacement de l’abside et de la nef. Celui reconnu dans l’emprise de l’abside (en mortier de
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 285
tuileau, dans la salle 1) peut être considéré comme celui de la crypte dont plusieurs auteurs et un plan des années 1640 portent témoignage (on ne sait toutefois si sa réalisation appartient au projet d’origine). Il faut donc imaginer que le sol surhaussé de l’abside se trouvait bien au-dessus, probablement à peu près à la hauteur du sol de l’église actuelle.
Jean-Luc BOUDARTCHOUK, Quitterie CAZES »
[1] M. LABROUSSE, Toulouse antique des origines à l’établissement des Wisigoths, Paris, De Boccard, 1968, p. 416.
[2] La salle 1 correspond au sondage n° 2 de 1961, la salle 2 au sondage 3 (le sondage 1, au nord-est du croisillon sud du transept actuel, a été rebouché en 1962).
[3] Nettoyage des fouilles anciennes (1961-62) réalisé dans la crypte archéologique de l’église Notre-Dame la Daurade, du 22 au 24 avril 2003, par Jean-Luc Boudartchouk (INRAP), Quitterie Cazes (Université Paris I), Sophie Cornardeau (INRAP), Éric Tranier (INRAP), Catherine Viers (INRAP).
[4] Ch. RICO, « L’artisanat de la brique », dans J.-M. Pailler (dir.), Tolosa. Nouvelles recherches sur Toulouse et son territoire dans l’Antiquité, Coll. École française de Rome, 281, 2001 p. 267.
[5] Jean de CHABANEL, De l’Antiquité de l’Eglise Nostre Dame dite la Daurade, et autres antiquités de Tolose, Toulouse, 1625, p. 98-99 : « ces deux aisles ou murailles [qui forment les murs de la nef] surmontent le demy rond du vieux temple qui enuironne le grand autel, & paroissent auoir esté là comme cousuës et adioustées ».
Michèle Pradalier-Schlumberger remercie les deux intervenants, dont les contributions apportent une information majeure : l’église primitive de la Daurade n’était pas, comme on l’a cru depuis le XVIIIe siècle, un édifice à plan centré, mais une basilique pourvue d’une abside polygonale.
Jean-Luc Boudartchouk ajoute quelques indications sur des tessons de céramiques remarquables recueillis récemment, dont l’un peut être daté du Ve siècle. Quitterie Cazes précise qu’un sondage complémentaire devrait permettre d’affiner stratigraphie et chronologie.
Maurice Prin se souvient que les fouilles de 1961 avaient mis au jour une source et demande si l’on rencontre toujours de l’eau sur le site. M. Boudartchouk et Mme Cazes répondent par la négative.
Dominique Watin-Grandchamp fait observer que le massif occidental de l’église médiévale pourrait être assimilé à une tour symbolisant le pouvoir seigneurial du prieur de la Daurade. Quitterie Cazes rejette cette hypothèse en indiquant que ce massif n’était pas fortifié et qu’il s’inscrit bien plutôt dans la tradition de l’architecture monastique, ainsi que le montre l’exemple de l’abbaye de Jumièges. Michèle Pradalier-Schlumberger évoque à ce propos les édifices de l’époque carolingienne. Dominique Watin-Grandchamp appelle ensuite l’attention sur l’originalité de la solution architecturale qui a permis la coexistence des moines de la Daurade et des habitants de la paroisse ou de la ville : les uns ont pu prolonger leur église jusqu’à la Garonne, et les autres disposer d’un passage public longeant le fleuve.
Françoise Merlet-Bagnéris imagine que la chapelle haute du massif occidental, dédiée à saint Michel, ait pu servir pour les cérémonies du « Montement » de la Vierge, mais Quitterie Cazes objecte qu’aucun témoignage ne l’atteste. Mme Cazes signale qu’elle a trouvé des renseignements très éclairants sur la vie monastique à la Daurade dans l’ouvrage que le curé de la paroisse, Jean de Chabanel, fit paraître en 1625.
Henri Molet intervient au sujet de la Daurade antique. À la fin du VIe siècle, Grégoire de Tours mentionne une basilique Sainte-Marie, qui paraît s’être trouvée extra muros, mais que l’on a traditionnellement identifiée avec la Daurade, située elle intra muros. Cette contradiction aurait déjà été relevée par May Vieillard-Troïekouroff dans sa thèse sur Les Monuments religieux de la Gaule d’après les œuvres de Grégoire de Tours, publiée en 1977. Jean-Luc Boudartchouk abonde en ce sens : on ne possède pas d’édition véritablement critique de l’Historia Francorum, Grégoire de Tours, qui n’est jamais venu à Toulouse, a pu commettre une confusion… Dans ces conditions, la première attestation vraiment assurée pour la Daurade ne remonterait qu’à 844, date du diplôme d’immunité confirmé par Charles le Chauve en faveur de l’Église de Toulouse.
Au titre des questions diverses, la Présidente donne lecture des projets de cinq lettres que notre Société se propose d’adresser aux autorités concernées par le chantier ouvert dans les bâtiments de l’ancien collège de Périgord à Toulouse : le Préfet de la Région Midi-Pyrénées, le Directeur régional des Affaires culturelles, le Président du Conseil régional de Midi-Pyrénées, le Député-Maire de Toulouse et le Président de l’Université de Toulouse-Le Mirail.
Le contenu de ces courriers est avalisé par la Compagnie. Il est précisé que des copies de ces divers courriers seront adressées à qui de droit. On s’attend à ce que le Préfet réagisse vis-à-vis des Services placés sous son autorité, et on espère vivement que des réponses nous parviendront avant la date limite du délai légal de deux mois qui s’impose à l’Administration.
SÉANCE DU 20 MAI 2003
Présents : Mme
Pradalier-Schlumberger, Présidente, MM. M. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Scellès,
Secrétaire général, Cabau, Secrétaire-adjoint, Latour,
Bibliothécaire-Archiviste ; Mmes Cazes, Napoléone, Noé-Dufour, Watin-Grandchamp,
MM. Gérard, Peyrusse, membres titulaires ; Mmes Blanc-Rouquette, Czerniak,
Fronton-Wessel, Stutz, MM. Bordes, Manuel, membres correspondants.
Excusés : M. Cazes, Directeur, Mme Pujalte, M. Garland.
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 286
Le Secrétaire-adjoint donne lecture du procès-verbal de la séance du 6 mai dernier, qui est adopté.
En marge du procès-verbal et pour faire suite aux réserves exprimées à propos de la mention par Grégoire de Tours d’une église Sainte-Marie, Patrice Cabau dit qu’après avoir revu les textes, la lecture qu’en a donnée May Vieillard-Troïekouroff lui paraît être la bonne :
« Grégoire de Tours et les basiliques de Toulouse
Dans son Histoire des Francs, l’évêque de Tours Grégoire (538/9 - 573 - 594) mentionne incidemment, à propos d’événements survenus au début des années 580, deux des églises de Toulouse :
- à la fin de 581 ou au début de 582, la femme du duc Ragnovald, apprenant que son mari avait été mis en fuite par le duc Didier et que les cités de Périgueux et d’Agen, possessions du roi de Bourgogne Gontran, étaient ainsi tombées au pouvoir du roi de Neustrie Chilpéric, se réfugia à Agen dans la basilique du saint martyr Caprais. “Mais, expulsée de ce lieu et dépouillée de ses biens ainsi que du secours de ses serviteurs, après avoir donné des cautions, elle est dirigée sur Toulouse ; et là elle résidait à nouveau dans une basilique, celle de saint Saturnin” (1) ;
- vers la fin de 584, Rigonthe, fille de Chilpéric et de Frédégonde, partie de Paris pour Tolède afin de rejoindre son fiancé Reccared, fils du roi wisigoth Léowigild, s’arrêta à Toulouse, cité dépendant du royaume de Neustrie. À la nouvelle de l’assassinat de Chilpéric († vers le 20 décembre 584), le duc Didier entra dans la ville, s’empara des trésors de la princesse, enferma celle-ci dans une maison qu’il fit placer sous scellés et sous une forte garde, puis il partit pour Avignon. À quelque temps de là, “Rigonthe résidait dans la basilique de sainte Marie de Toulouse, où la femme de Ragnovald, de qui nous avons parlé plus haut, s’était réfugiée par crainte de Chilpéric” (2) ; revenu d’Espagne où Gontran l’avait envoyé en ambassade, le duc Ragnovald fut rendu à son épouse et à ses biens.Les indications de lieux données dans les récits de ces épisodes pourraient à première vue sembler contradictoires. À relire de plus près les deux passages, on s’aperçoit que la narration est elliptique et qu’il n’y a pas au fond d’incompatibilité. Ainsi que dom Ruinart (1657-1709) l’a supposé (3), l’épouse de Ragnovald dut séjourner d’abord à Saint-Sernin, puis à Sainte-Marie (la Daurade), c’est-à-dire que, dans un intervalle d’environ trois années, elle passa d’un premier refuge situé extra muros à un nouvel asile situé intra muros (4) et sans doute plus sûr. Aussi n’y a-t-il guère lieu de conjecturer une confusion entre les deux basiliques toulousaines, ni de la part de l’auteur, visiblement bien informé au sujet des faits relativement récents qu’il rapporte (5), ni de celle des transcripteurs de son ouvrage, dont les leçons sont concordantes (6).
Au demeurant, confusion ou pas, l’accord de la tradition manuscrite prouve indubitablement que l’évêque de Tours connaissait l’existence à Toulouse d’une basilique Saint-Sernin et d’une basilique Sainte-Marie. On sait d’ailleurs, par son Livre à la gloire des martyrs, qu’il connaissait aussi une basilique Saint-Vincent (7), ultérieurement assimilée à Saint-Sernin (8), pour laquelle il est notre seule source.
Patrice CABAU »
Notes
1. Sed extracta exinde et spoliata a facultate ac famolorum solatio, datis fideiussoribus, Tolosae dirigitur ; ibique iterum in basilica sancti Saturnini resedebat. Historia Francorum, livre VI, chapitre 12. Éditions : MOREL 1561, p. 323 – RUINART 1699, c. 289 = MIGNE 1849, c. 385 – ARNDT 1884, p. 257 (éd. citée) – KRUSCH, LEVISON 1937-1951, p. 282. Traductions : GUADET, TARANNE 1836, p. 363 – LATOUCHE 1965, p. 30.
2. Rigunthis vero in basilica sancte Mariae Tholosae, in qua Ragnoaldi uxor, cui supra meminimus, Chilpericum metuens confugerat, resedebat. Historia Francorum, livre VII, chapitre 10 (cf. livre V, chapitre 39, livre VI, chapitre 46, et livre VII, chapitres 9 et 15). Éditions : MOREL 1561, p. 382-383 – RUINART 1699, c. 338 = MIGNE 1849, c. 422 – ARNDT 1884, p. 296 (éd. citée) – KRUSCH, LEVISON 1937-1951, p. 332. Traductions : GUADET, TARANNE 1838, p. 14 – LATOUCHE 1965, p. 85-86.
3. « Dicitur in libro præced., cap. 12, in basilica sancti Saturnini resedisse. Forte post aliquam moram in basilica sancti Saturnini ad S. Mariam transierat. » RUINART 1699, c. 338, n. f = MIGNE 1849, c. 422, n. f.
4. VIEILLARD-TROÏEKOUROFF 1977, p. 300, n° 305 ; cf. p. 298, n° 303.
5. La rédaction du chapitre 12 du livre VI (chapitre figurant dans la version primitive de ce livre), doit se placer avant le milieu des années 580, et celle du chapitre 10 du livre VII (livre achevé avant 591 au plus tard), vers cette date ou peu après (LECLERCQ 1924, c. 1739-1740). Grégoire de Tours est un écrivain fondamentalement scrupuleux, à qui il arrive certes de commettre quelques (rares) inadvertances, mais dont le témoignage est le plus souvent tout à fait digne de foi (LECLERCQ 1924, c. 1750-1753).
6. S’agissant des noms des saints titulaires des basiliques, la tradition manuscrite est quasiment unanime : seul, le ms. du Mont-Cassin (XIe/XIIe s.), écrit en Italie et criblé de fautes, donne par erreur basilica sancti Martini au lieu de basilica sancti Saturnini (VI, 12 – ARNDT 1884, p. 257, n. w) ; le ms. de Cambrai (VIIe/VIIIe s.) porte basilica sancti Mariae pour basilica sanct(a)e Mariae (VII, 10 – ARNDT 1884, p. 296, n. w).
7. Apud urbem enim Tolosatium ferunt fuisse quemdam, Antoninum nomine, iniquum in Deum, et omnibus hominibus odibilem, eo quod multa perpetraret scelera. Factum est autem, ut, impletis diebus, migrans a sæculo in basilica beati Vincentii sepeliretur, in qua ipse sibi vivens vas deposuerat. Liber in gloria martyrum, chapitre 88 (ou 89) – RUINART 1699, c. 821 = MIGNE 1849, c. 783 (éd. citée) – KRUSCH 1969, p. 97 – Cf. VIEILLARD-TROÏEKOUROFF 1977, p. 300, n° 304. Pour l’identification du saint Vincent titulaire de cette basilique, on peut avec vraisemblance hésiter entre le diacre de Saragosse martyrisé à Valence et le martyr d’Agen.
8. In urbe tholosa fuit quidam nomine Anthonius / iniquus erga deum et propter suam vitam seueram odibilis hominibus : quo mortuo sepultum est corpus eius in basilica sancti Saturnini in vase quod ipse prius ibi apposuerat dum viuebat. BERTRAND 1515, f. xlv r° (d’après Bernard Guy, [De sanctis dyocesis Tholosane] - De beati Saturnini miraculis, qui a lui-même reproduit le De
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 287
mirabilibus sancti Saturnini composé vers la fin du VIIe siècle ou au début du VIIIe à partir des chapitres 47/48, 88/89, 103/104 du Liber in gloria martyrum et du chapitre 22 du Liber de passione et de virtutibus sancti Juliani martyris). « Gregoire de Tours au Chapitre quatre-vingts & neuf du liure premier des miracles, raporte vn miracle arriué en Tolose dans l’Eglise sainct Vincens d’vn nommé Antoninus, lequel ayant mal vescu auoit fait construite son tumbeau dans ladite Eglise, & ayant esté enterré son Sepulchre se treuua auec le corps à l’entrée de ladite Eglise ; mais cest Antonin n’est point Antonius duquel est parlé en la vie de S. Sernin. Ie diray seulement, qu’au lieu qu’il est escrit dans Gregoire de Tours en l’Eglise S. Vincent, il est dit dans deux liures manuscrits que j’ay des miracles de S. Sernin, que ce miracle arriua à Tolose dans l’Eglise S. Sernin : aussi n’y a il point d’Eglise S. Vincent que l’on sçache dans Tolose. » CATEL 1633, p. 819.
Bibliographie
ARNDT (Wilhelm), Gregorii Turonensis opera - Historia Francorum, Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum Merovingicarum, Hahn, Hanovre, I-1, 1884 (et 1885) – nouv. éd. : KRUSCH, LEVISON 1937-1951.
BERTRAND (Nicolas), Opus de Tholosanorum Gestis ab urbe condita […], Jean Grandjean, Toulouse, 1515.
CATEL (Guillaume de), Memoires de l’Histoire du Languedoc […], Pierre Bosc, Arnaud Colomiez, Toulouse, [1626-] 1633.
GUADET (J.), TARANNE (N.-R.), Histoire ecclésiastique des Francs, par Georges Florent Grégoire, évêque de Tours, en dix livres, Publications de la Société de l’Histoire de France, Jules Renouard et Cie, Paris, I, 1836 ; II, 1838.
KRUSCH (Bruno), Gregorii episcopi Turonensis miracula et opera minora, Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum Merovingicarum, Hahn, Hanovre, I-2, 1885 – nouv. éd. : 1969.
KRUSCH (Bruno), LEVISON (Wilhelm), Gregorii Turonensis opera - Historiarum libri decem, Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum Merovingicarum, Hanovre, I-1, 1937-1951 – nouv. éd. : 1965.
LATOUCHE (Robert), Grégoire de Tours - Histoire des Francs, Les classiques de l’histoire de France au Moyen Âge, 27e et 28e vol., Les Belles Lettres, Paris, I, 1963 ; II, 1965 – nouv. éd. : I, 1975 ; II, 1979.
LECLERCQ (Dom Henri), Grégoire de Tours, dans Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, Letouzey et Ané, Paris, VI-2, 1924, c. 1711-1753.
MIGNE (Jean-Paul), Patrologiæ cursus completus, Series Latina, LXXI, Jean-Paul Migne, Paris, 1849 – nouv. éd. : Paris, 1858 ; Turnhout, 1968.
MOREL (Guillaume), Gregorii Turonensis historiae Francorum libri decem […], Guillaume Morel, Guillaume Guillard et Almaric Warancore, Paris, 1561.
RUINART (Dom Thierry), Sancti Georgii Florentii Gregorii Turonensis episcopi opera omnia […], Paris, 1699 – nouv. éd. : MIGNE 1849, 1858, 1968.
VIEILLARD-TROÏEKOUROFF (May), Les monuments religieux de la Gaule d’après les œuvres de Grégoire de Tours, thèse présentée devant l’Université de Paris IV le 27 avril 1974, Service de reproduction des Thèses, Université de Lille III, 1977.
Notre bibliothèque s’enrichit d’un don de François Bordes : Le Périgord roman. 1. La perception de l’espace, numéro hors série de Reflets du Périgord, printemps 1996, 125 p. La Présidente remercie notre confrère au nom de notre Société.
Puis la Présidente annonce la décision prise par le Bureau de retrouver des règles plus strictes pour notre concours annuel. Les travaux présentés au concours de l’année académique devront être accompagnés d’une lettre de candidature et avoir été adressés à la Société avant le 31 décembre ; ils seront examinés par les rapporteurs de janvier à mars ; sauf circonstance particulière, les candidats primés seront tenus d’être présents à la séance publique au cours de laquelle les prix seront remis.
La parole est à M. Pierre Gérard pour la communication du jour : Un exemple de collège universitaire toulousain, le Collège de Foix :
« Fondé en 1457, le collège doit son nom à son fondateur : le cardinal Pierre de Foix, légat du pape, gouverneur du Comtat Venaissin. Tel qu’il nous est parvenu, il constitue un bon exemple d’architecture du XVe siècle toulousain. Implanté dans l’ancien centre universitaire de Toulouse, non loin des Cordeliers et des Dominicains, à l’ombre de Saint-Sernin, il plonge ses fondations dans un sol marqué par le souvenir de ce qui fut au Moyen âge le « Quartier latin » de la vieille cité raimondine.
Construit de 1455 à 1461 par le maître-maçon toulousain Jean Constantin, notre collège développe ses bâtiments tout près de l’église des Cordeliers. Le pivot en est le “donjon”, important édifice en brique flanqué de quatre tourelles dominant la rue des Lois. Adossé à cette “forteresse”, nous trouvons le cloître et son préau entouré de galeries à deux étages, où se trouvaient autrefois les chambres d’étudiants. Près du vestibule d’entrée, rue Deville, à l’ouest, se trouvait la chapelle, disparue, consacrée à saint Jérôme et à saint François d’Assise.
Nous avons une bonne connaissance du collège de Foix grâce au rapport daté de 1464, que nous ont laissé des experts charpentiers et maçons peu après le grand incendie de Toulouse de mai 1463. »
La Présidente
remercie Pierre Gérard pour cette communication qui nous a fait assister au déroulement
du chantier, avec des informations très précieuses sur l’origine des matériaux de
construction, et nous a apporté des détails très concrets sur les aménagements
intérieurs grâce à l’expertise de 1464 qui s’avère être un document de
première importance. Pierre Gérard avoue n’être qu’un archéologue amateur et
il explique que c’est la passion pour cet édifice exceptionnel qui l’a conduit
à se lancer dans cette étude.
On souligne toute l’importance de cette
description alors que des travaux sont actuellement prévus. Un projet très étonnant,
comprenant par exemple un ascenseur extérieur, a été présenté. L’une des
difficultés du réaménagement des bâtiments réside en
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 288
effet dans les circulations et le texte
analysé par notre confrère apporte des précisions importantes sur les dispositions
d’origine.
On rappelle que l’édifice est inscrit à
l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Pierre Gérard explique
comment il a été interpellé dans le cadre de ce dossier et les découvertes qu’il
a faites en revisitant les bâtiments. Il ajoute que des démarches ont été faites pour
le classement au titre des Monuments historiques, mais que la communauté propriétaire
des lieux n’y a pas été favorable.
Maurice Scellès s’étant interrogé sur l’emplacement des escaliers en vis montant de fond, Dominique Watin-Grandchamp fait remarquer que le dessin du XVIIe siècle les montre au revers du corps de bâtiment sur rue.
Après avoir
rappelé que le collège de Foix se trouvait dans le secteur sauvegardé, on explique que
les chargés d’étude ont rendu leur travail mais que le règlement de secteur
sauvegardé n’a toujours pas été adopté par le Conseil municipal. On se trouve
donc dans la situation juridique d’un secteur sauvegardé en cours
d’élaboration mais sans chargé d’étude, le contrôle revenant à
l’architecte des Bâtiments de France.
Plusieurs membres pensent qu’il faut
demander le classement d’office du collège de Foix, en préalable à l’étude
qui, sans cela, ne pourrait être légalement exigée. Un membre croit que l’étude
archéologique de l’édifice pourrait être imposée dans le cadre du secteur
sauvegardé.
Un membre dit qu’il faut travailler en
collaboration avec l’architecte des Bâtiments de France et un autre rappelle que le
service régional de l’archéologie est désormais compétent en matière
d’archéologie du bâti. On annonce que le service régional de l’Inventaire
commencera prochainement l’inventaire du centre historique de Toulouse et qu’il
a été convenu d’accompagner l’architecte des Bâtiments de France dans ses
visites à l’occasion de l’instruction des permis de démolir ou de construire ;
des chantiers ont ainsi fait tout récemment l’objet de visites en commun.
Il est proposé que nous nous rapprochions des Toulousains de Toulouse pour créer une association dont le but serait d’agir en justice pour la défense du patrimoine. On évoque la dernière réunion du Conseil d’administration des Toulousains de Toulouse au cours de laquelle plusieurs dossiers ont été examinés. Le Président a en particulier souhaité que la Société Archéologique du Midi de la France transmette aux Toulousains de Toulouse le dossier qui a été constitué sur le collège de Périgord. On rappelle l’action menée par les Toulousains de Toulouse contre le projet de passerelle le long de la façade sur Garonne de l’Hôtel-Dieu, avec succès.
Maurice Scellès lui ayant demandé si les « chambres » dont fait état le texte de 1464 étaient divisées par une cloison, Pierre Gérard rappelle que les experts qui visitent les bâtiments sont des techniciens qui ne donnent pas la fonction des espaces.
La parole est à M. Robert Manuel qui présente à la Compagnie Les anges peints de la chapelle Saint-Jean-de-Mordagne (dite des « pestiférés ») à Cordes-sur-Ciel :
« Cachée au fond d’un vallon, la chapelle Saint-Jean est située à environ 1 km au sud de Cordes. Son existence est attestée en 1224, datation que ne contredit pas la présence d’une petite baie en plein cintre aménagée dans le mur épais du chevet dans l’axe de l’abside. Charles Portal, en 1902, dans son incontournable Histoire de la Ville de Cordes, mentionne que la chapelle aurait été “refaite entièrement” au XIXe siècle. Mais que faut-il entendre par cette affirmation? S’agit-il d’une restauration, d’une transformation, ou d’une simple réfection de la charpente ?
M. Greslé-Bouignol, ancien directeur des Archives Départementales du Tarn, a relevé, lors d’une visite extérieure faite en 1986, les caractères architecturaux qui correspondent à la typologie « d’églises très anciennes à angles arrondis », comme il en existe dans le Quercy (préromanes ou romanes d’après les travaux de M. d’Alauzier) et, d’après notre confrère, en Grésigne autour de Puycelsi. Par ailleurs, la présence d’un arc outrepassé dans l’entrée de l’abside confirme l’ancienneté et l’intérêt architectural déjà attribués à cette modeste chapelle. L’histoire de Saint-Jean-de-Mordagne est intimement liée à celle de Cordes, notamment au temps des grandes épidémies. Longtemps à l’abandon, elle a été confiée, vers 1975, par la Mairie de Cordes aux bons soins des membres de la Communauté du Lion de Juda (aujourd’hui Communauté des Béatitudes). Dans les années 1980, un décor polychrome, peint dans l’embrasure de la petite baie en plein cintre située au fond du chevet, aurait été découvert, dégagé discrètement du badigeon bleu qui le recouvrait et, tout aussi discrètement, « restauré » par les membres de la Communauté. Le Colonel Valat, Président en exercice de la Société des Amis du Vieux Cordes, et moi-même avons eu connaissance, en 2002, de ce décor suite aux indications de M. Greslé-Bouignol et avons aussitôt fait faire un relevé photographique.
Ce décor représente deux anges nimbés, porteurs chacun d’un lourd candélabre. Les corps sont souples ainsi que les plis de leur robe. Les ailes sont faites de plumes en forme d’écailles, noires sur fond blanc, et se terminent par de longues plumes disjointes de couleur ocre-orangé. Les visages sont sobrement dessinés ainsi que les chevelures. Les paupières sont modestement baissées. Certains détails, comme la présence d’éléments de remplage gothique, permettraient-ils de dater l’ensemble du XIIIe ou du XIVe siècle ? Ce décor, de toute façon, enrichit l’inventaire, déjà riche, des peintures murales du Vieux Cordes et mériterait une protection officielle au titre des Monuments Historiques.
Robert MANUEL »
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 289
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 290
Virginie Czerniak précise que l’oxydation notée par Robert Manuel est celle du blanc de céruse de plomb, utilisé surtout du XIVe siècle à la fin du Moyen Âge ; la Présidente rappelle l’exemple célèbre de Cimabue. Maurice Scellès note que le dessin des plumes des ailes diffère sensiblement du motif de la maison Gaugiran à Cordes, qui s’apparente à une tenture de vair. Michèle Pradalier-Schlumberger dit que ces deux anges porte-cierges font songer aux représentations de la Vierge de la Chandeleur et que l’on pourrait admettre une datation du début du XIVe siècle.
Robert Manuel regrette de ne pouvoir donner plus d’informations sur la découverte de ces peintures, qui remonte déjà à quelques années. Le Président des Amis du Vieux Cordes avait pris contact avec la communauté religieuse qui occupait l’édifice et a réalisé les travaux. Notre confrère sait seulement qu’une couche de peinture uniformément bleue couvrait le décor auparavant. Pour Virginie Czerniak, on ne peut exclure une reprise au XIXe siècle. Dominique Watin-Grandchamp relève que certains traits semblent refaits et Louis Peyrusse remarque à son tour que le tracé est peut-être un peu trop régulier. Michèle Pradalier-Schlumberger se dit un peu gênée par le dessin des visages et des chevelures. Guy Ahlsell de Toulza pense que si la peinture avait été restaurée, elle aurait alors été complétée. En revoyant les photographies, des doutes de plus en plus nombreux saisissent néanmoins la Compagnie, tempérant l’enthousiasme du début : on conclut qu’il est nécessaire d’aller voir les peintures sur place.
Au titre des questions diverses, la Présidente informe la Compagnie des suites de l’affaire du collège de Périgord.
Aucune réponse
officielle ne nous est encore parvenue. La Présidente a néanmoins eu l’occasion de
discuter, en présence de notre confrère Jean Nayrolles, avec le conservateur régional
des Monuments historiques et le conservateur des Monuments historiques lors de la C.R.P.S.
du 15 mai dernier. Elle a ainsi appris que, comme on pouvait s’y attendre, le
courrier adressé au D.R.A.C. a été transmis au conservateur régional des Monuments
historiques.
Nous avions demandé au
préfet de région, par fax, la modification l’ordre du jour de la C.R.P.S. afin que
soit examiné le dossier de l’ancien collège de Périgord. Le conservateur régional
des Monuments historiques a dit que le délai était trop court, que cela ne se faisait
pas… sauf dans le cas exceptionnel d’une instance de classement… La
discussion a ensuite montré que nos courriers avaient eu quelques effets. Des échanges
auraient eu lieu avec l’architecte des Bâtiments de France, lequel proposerait
d’enlever l’enduit sous la galerie ; le conservateur des Monuments
historiques est néanmoins contre, arguant que l’épiderme de la brique aurait été
par trop détérioré par le ciment. La Présidente a réaffirmé la demande de notre
Société en faveur de l’enlèvement avant que le mortier ait fini de durcir.
L’architecte des Bâtiments de France aurait prévu un retour en arrière pour les
fenêtres de la tour Maurand avec enlèvement des menuiseries métalliques et mise en
place de menuiseries en bois semblables à celles qui existaient jusque-là. Quant aux
peintures murales, la décision serait irrévocable selon le conservateur des Monuments
historiques : elles ne pourraient être ni restaurées ni mises en valeur. La
Présidente ajoute que l’on considère à la Direction régionale des Affaires
culturelles que nos courriers font « désordre ».
Pour certains membres,
l’architecte paraît très sincère. On ajoute qu’il se conforme aux avis de
l’architecte des Bâtiments de France.
La Présidente donne
lecture des avis des deux inspecteurs généraux des Monuments historiques qui lui ont
été remis en main propre par le Conservateur régional des Monuments historiques le 15
mai. On relève les contradictions que contient l’un des deux avis. On fait surtout
remarquer que nous avons, avec l’affaire de l’ancien collège de Périgord, un
bel exemple de l’évolution du vandalisme. L’administration des Monuments
historiques se déclare surprise dans sa bonne foi dès lors que la procédure a été
respectée : le vandalisme se trouve aujourd’hui au sein même de
l’institution.
Il faudra sans doute
saisir la presse de l’affaire. Il est déjà prévu qu’un dossier soit publié
dans L’Auta et il faudrait obtenir un article dans La Dépêche du Midi.
On souligne que des articles de presse seraient d’autant plus intéressants que les
journalistes devraient tout naturellement interroger les différentes parties.
SÉANCE DU 3 JUIN 2003
Présents : MM. Cazes, Directeur,
Ahlsell de Toulza, Trésorier, Scellès, Secrétaire général, Cabau,
Secrétaire-adjoint, Latour, Bibliothécaire-Archiviste ; Mmes Cazes, Napoléone,
Noé-Dufour, Watin-Grandchamp, MM. l’abbé Baccrabère, Bordes, Prin, membres
titulaires ; Mmes Bayle, Bellin, Boussoutrot, Conan, Czerniak, Galés, Marin, Stutz,
MM. Geneviève, Manuel, Rebière, membres correspondants.
Excusés : Mme Pradalier-Schlumberger, Présidente, MM. Balagna, Burroni, Peyrusse,
Pradalier, Tollon.
Le Directeur ouvre la séance en priant la Compagnie de bien vouloir excuser l’absence de notre Présidente, en voyage d’étude. Deux communications sont inscrites au programme d’aujourd’hui, qui seront suivies d’un apéritif pour fêter la clôture d’une année académique particulièrement riche.
Le Secrétaire général n’ayant pu achever la rédaction du procès-verbal de la séance du 20 mai, sa présentation est reportée à la rentrée.
Le Directeur informe la Compagnie des suites de l’affaire de l’ancien collège de Périgord. C’est en particulier un courrier qui attire notre attention sur le sort de la bibliothèque de l’I.É.M. Notre Société ajoutera sans doute à sa démarche la question de la sauvegarde de la bibliothèque du 56 rue du Taur.
Le Secrétaire général donne lecture de la réponse que nous a faite le Président de l’Université de Toulouse-Le Mirail le 15 mai.
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 291
On s’étonne
qu’un historien de la qualité de M. Rémy Pech parle de « vieux
documents », expression tellement étrange et vague… L’architecte des
Bâtiments de France avait utilisé ce même argument à propos du portail du collège de
l’Esquile, il y a quelques années.
On fait observer
qu’il est curieux qu’une université qui comprend en son sein l’un des plus
anciens instituts d’art de France et qui a créé un D.E.S.S. Patrimoine
n’assume pas elle-même, pour ses propres locaux, le contenu de ses enseignements. Il
est au moins du devoir de notre Société de le faire savoir. Les vacances académiques
commencent ce soir, mais le Bureau assurera pendant tout l’été le suivi des
correspondances.
La parole est à Françoise Galés pour une communication sur Le château de Sauveterre-en-Béarn, publiée dans ce volume (t. LXIII, 2003) de nos Mémoires.
Le Directeur remercie
bien vivement Françoise Galés de nous avoir fait découvrir ce château de Sauveterre et
ses caractères architecturaux, et il s’étonne qu’un ensemble de cet intérêt
ne bénéficie d’aucune protection au titre des Monuments historiques.
Jean-Louis Rebière
voudrait savoir quel était le matériau de couverture des toitures. Françoise Galés
répond qu’elle n’en a aucune mention dans les textes mais que la documentation
fait état de bardeaux pour d’autres châteaux de Gaston Phébus. Jean-Louis Rebière
lui ayant encore demandé s’il subsistait des traces de scellement de poutres ou
d’arcs-diaphragmes, Françoise Galés indique que ce n’est pas le cas.
Répondant à Agnès
Marin, Françoise Galés précise que la voûte pyramidale de la cuisine peut être
restituée par comparaison avec celle de Montaner qui est connue par une photographie du
début du XXe siècle. À propos de photographies, Dominique Watin-Grandchamp
croit avoir vu des clichés de Sauveterre pris par Mieusement dans les archives des
Monuments historiques.
Maurice Scellès
l’ayant interrogée sur les embrasures de fenêtre en brique, Françoise Galés
indique qu’on les trouve surtout dans le bâtiment situé le long du gave. Quitterie
Cazes remarque qu’en revanche le mur à arases de brique correspond à une
reconstruction. Françoise Galés dit que c’est aussi le cas du pigeonnier, à
l’évidence tardif, et elle pense en effet que le mur est a été repris.
Après une question de
Maurice Scellès et Jean-Louis Rebière sur la forme des fenêtres, Françoise Galés
confirme qu’il s’agissait de croisées mais elle ajoute que les encadrements
sont arrachés ou très abîmés ; quant à la demi-croisée, il s’agit en fait
d’une croisée en partie murée.
Maurice Scellès ne
croit pas que la position de la cheminée dans la salle doive être analysée en fonction
d’une meilleure répartition de la chaleur dans la salle ; il faut plutôt se
demander si le fait qu’elle soit décentrée n’est pas la marque d’une
utilisation particulière de l’espace, lors des réceptions ou d’autres
événements. Françoise Galés ajoute que cette formule est employée dans tous les
châteaux de Gaston Phébus.
Le Directeur émet le vœu que l’administration des Monuments historiques s’intéresse au château de Sauveterre.
La parole est à Agnès Marin pour une communication complémentaire sur les peintures murales d’une maison du XIIe siècle à Périgueux :
« La Maison dite “des Dames de la Foi” à Périgueux, 4-6 rue des Farges
Parmi les vestiges fragmentaires ou dénaturés de l’architecture domestique de la fin de l’époque romane à Périgueux [1], la “maison des Dames de la Foi” constitue un témoignage exceptionnel tant par son bon état de conservation que par sa qualité architecturale : celle-ci a été reconnue dès la première moitié du XIXe siècle par Félix de Verneuilh [2] qui présenta une précieuse restitution de la façade avant qu’elle ne soit altérée par les ouvertures modernes de la seconde moitié du siècle (fig. 1) [3]. Après une longue période de déshérence, un projet de réhabilitation globale [4] a suscité fin 2002 une étude archéologique préalable prescrite par le Service régional de l’archéologie d’Aquitaine afin d’étendre l’attention portée à cette demeure, jusque-là limitée à sa façade classée depuis 1913 [5], à l’ensemble de la construction : au-delà de sa qualité monumentale, c’est donc l’occasion de rendre à cet édifice préservé par les hasards des aménagements urbains, toute la richesse de son intérêt historique et documentaire.
La demeure est située à peu près à mi-parcours de la rive sud de la rue des Farges, axe considéré comme un des plus anciens du bourg médiéval du Puy-Saint-Front [6], reliant ce dernier à l’ancienne cité antique. Elle est située non loin de la “Salle” du comte qui contrôlait l’extrémité ouest de la rue et autour de laquelle se sont groupées plusieurs demeures aristocratiques dont l’identité des possesseurs est bien connue à partir XIVe siècle [7]. A. Higounet-Nadal a pu démontrer par l’étude des confronts que c’est bien cet édifice qui fut vendu en 1332 par le commandeur d’Andrivaux, frère Arnault de Serres de l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, à un bourgeois de la ville, Hugo Peyroni [8]. Du même coup, la mention de 1247 d’une “maison du Temple sise rue des Farges” [9] a pu lui être rapportée, attestant son appartenance à l’Ordre des Templiers d’Andrivaux au moins depuis cette date, mais selon des modalités qui restent à élucider [10].
La succession des propriétaires est ensuite bien établie : par jeux d’alliances, elle échoit au début du XVIe siècle à la branche des Arnault de Golce, puis aux Arnaud de Laborie qui la conservent jusqu’à la fin du XVIIe siècle, avant d’en faire don à l’Ordre des Dames de la Foi qui y établit un couvent. Après la fermeture de l’établissement religieux en 1792, l’édifice abrita un dépôt de mendicité, puis fut subdivisé en logements locatifs dans la deuxième moitié du XIXe siècle, affectation qu’elle gardera jusque dans les années 1985.
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 292
PÉRIGUEUX, MAISON DITE DES “DAMES DE LA FOI”,
restitution de la façade (dessin F. de Verneuilh, Annales archéologiques, 1846, p. 164).
PÉRIGUEUX, MAISON DITE DES “DAMES DE LA FOI”, plan du 2e étage (salle).
Relevé E. du Chazaud, A. Marin.C’est une maison-bloc de plan trapézoïdal (fig. 2) qui semble être restée libre de toute mitoyenneté jusqu’au XVIIIe siècle [11]. À l’arrière lui est toujours associé un jardin qui ne semble jamais avoir été loti et qui, du fait de l’importante rupture de pente qui affecte toute la rive sud de la rue des Farges, est à 3 m en contrebas du niveau de cette dernière. Cette conformation topographique a fortement conditionné la distribution spatiale de l’édifice. La répartition des niveaux d’origine a été brouillée par la complète restructuration qu’il a connue à la fin du XVIe siècle, visant à conférer à l’ancienne demeure le lustre et la rigueur d’ordonnance qui sied à l’hôtel particulier d’une illustre famille d’humanistes [12] : un escalier rampe sur rampe à quart tournant a été implanté dans un espace autonome réservé dans l’angle nord-ouest afin de desservir, depuis la cave creusée à cette époque, les quatre niveaux installés dans le volume initial de l’édifice, dont l’élévation a été intégralement remaniée afin d’insérer l’étage supplémentaire. Dans le même temps, un épais refend nord-sud a été établi à la fois pour servir de relais aux solives des planchers et pour ménager les conduits des cheminées installées dans chacune des pièces. Des travées régulières de croisées et demi-croisées ont été percées dans les trois murs est, ouest et sud : soulignons que l’ordonnance d’origine de la façade a été épargnée par ces percements, signe probable de déférence à l’égard de ce frontispice dont la magnificence devait déjà inspirer le respect. Ces transformations très lisibles n’ont cependant guère affecté les quatre murs porteurs de l’édifice médiéval : l’étude archéologique des élévations permet de décrypter les traces témoignant des dispositions d’origine et des quelques modifications apportées au cours du Moyen Âge.
L’important dénivelé qui affecte l’assiette de l’édifice a déterminé une répartition spatiale du rez-de-chaussée nettement divisée en deux parties, opposant un espace nord largement ouvert sur la rue à celui tourné sur le jardin, 3 m en contrebas (fig. 3). Trois grandes arcades montrent que, malgré le prestige évident qu’affiche le décor de la façade, la demeure n’était pas exclue des activités de production et d’échange de la rue commerçante qu’elle bordait. Ces ouvertures étaient complétées par deux portes latérales pouvant desservir indépendamment l’étage ou la partie arrière de la maison [13]. À l’opposé, côté jardin, un portail de 3 m de haut au centre de la façade sud (fig. 4) était le seul accès depuis l’extérieur à cet espace semi-enterré dépourvu de toute autre ouverture, caractéristique suggérant une fonction de stockage. Le niveau du rez-de-chaussée côté rue coupant le portail à 1,50 m du sommet de son arrière-voussure (fig. 3), il est certain que ces deux parties étaient autonomes, séparées par un dispositif porteur est-ouest, peut-être simplement composé de piliers, et indispensable pour réduire la portée des poutres du plancher de l’étage [14]. C’est dans une deuxième phase d’aménagement qu’un niveau intermédiaire a été inséré dans les 7 m de l’élévation initiale, complété par l’ouverture de deux baies côté sud afin de desservir et éclairer cet entresol, dont on ignore comment il s’articulait par rapport au niveau du rez-de-chaussée, 1,20 m plus bas [15].
Le premier étage formait une vaste salle où aucune trace de cloisonnement n’a pu être repérée. Elle était abondamment ouverte sur la rue par quatre fenêtres à baies quadruples aux archivoltes sculptées, complétées aux angles par de hautes baies en plein cintre dont une au moins servait à coup sûr de porte [16]. Une fenêtre quadruple et une baie ternée de conception beaucoup plus sobre ménagées respectivement dans les murs sud et est complétaient
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 293
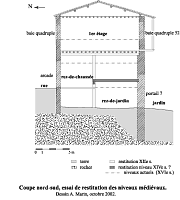
PÉRIGUEUX, MAISON DITE DES “DAMES DE LA FOI”, coupe nord sud : essai de restitution des niveaux médiévaux.
Relevé A. Marin.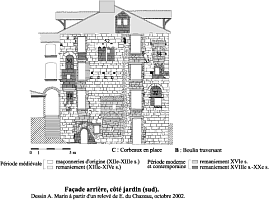
PÉRIGUEUX, MAISON DITE DES “DAMES DE LA FOI”, façade sud.
Relevé A. Marin.l’éclairement de la salle. Une galerie couvrait toute l’emprise du mur sud, accessible depuis la salle par au moins deux portes [17], la fonction d’une troisième baie d’une hauteur bien supérieure restant à déterminer. Les aménagements domestiques mis au jour se limitent à de simples placards muraux, aucun indice ne témoignant de la présence de cheminée, aménagement pourtant attesté dans plusieurs maisons du Périgord dès la fin du XIIe siècle [18].
C’est dans cette salle qu’un décor peint a fait l’objet de relevés détaillés lors de l’étude archéologique, mettant en évidence sa remarquable qualité et le caractère d’exception de son iconographie.
La composition est structurée par un arrière-plan ornemental à plusieurs registres de motifs végétaux et géométriques séparés par des bandes jaunes et rouge sombre et sur lequel se déploie une théorie d’écus armoriés insérés dans des quadrilobes (fig. 5). Le registre inférieur [19] est couvert de trois bandes horizontales superposées alignant des motifs difficiles à caractériser : des carrés sont recoupés par leurs diagonales, chacun des triangles étant rempli de demi-cercles alternativement verts, jaunes, rouges et gris. Leurs bases sont soulignées par un contour de lobes noirs qui confèrent au motif une vague apparence végétale. Au-dessus, un bandeau est garni d’un motif inspiré des grecques produisant un effet de profondeur par des dégradés de couleurs et des angles soulignés de triangles noirs. La partie médiane de l’ensemble, sur laquelle se déploient les écus armoriés, est tapissée d’un thème répétitif où s’affirme à nouveau le même goût du trompe-l’œil : des carrés noirs ornés de quadrilobes rouge brun rehaussés de blanc et dont les quatre pétales s’étirent pour rejoindre les angles sont eux-mêmes inscrits dans l’angle inférieur gauche de grands carrés blancs ; les lignes obliques qui réunissent les angles supérieurs droits des deux carrés, ainsi que les bandes d’épaisseur inégales qui garnissent la partie droite du carré extérieur génèrent une impression de profondeur, comme si le motif floral était logé au fond de cubes ouverts. Enfin, une frise de quadrilobes noirs sur fond blanc sépare ce large registre, qui sert d’arrière-plan à la théorie d’écus, du bandeau sommital occupant les 0,50 m immédiatement sous la corniche biseautée romane encore en grande partie conservée. Celui-ci est alternativement composé de carrés garnis de quatre motifs de rubans pliés dont la réunion forme une croix grecque vermillon aux extrémités empattées par des triangles noirs, et de panneaux figurés de 0,50 m de côté. L’ensemble du décor est conçu comme un tapis et obéit à une rigueur implacable ne tenant aucun compte des aménagements divers qui perturbent la surface du mur : ainsi, les registres se prolongent dans l’embrasure des baies comme si le décor venait se rabattre, en toute logique, sur le plan courbe des arrière-voussures.
Sur la trentaine d’écus armoriés que pouvait comporter la salle, sept seulement ont pour l’instant été repérés et quatre sont à peu près lisibles [20]. Deux écus sont à champ uni, or, un autre est à lion rampant
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 294
de sinople sur argent, et le dernier est fascé ondé enté de gueule sur argent [21]. Sous réserve qu’il ne s’agisse que d’un parti décoratif, l’identification de ces armoiries devra requérir une attention particulière dans la suite de l’étude.
De la frise qui couronnait l’ensemble, et qui pouvait comporter une quarantaine de panneaux historiés, neuf d’entre eux, le plus souvent très lacunaires, ont pu être reconnus. Seul, pour l’instant, un panneau du mur ouest est dans un état de conservation suffisant pour qu’on puisse identifier le Repas chez Simon le Pharisien (fig. 6). À l’arrière d’une table abondamment garnie d’objets culinaires et de mets, quatre personnages se tiennent debout. Les visages nimbés des deux de gauche sont bien conservés. Celui du quatrième a été entièrement détruit par l’encastrement d’une solive du plancher moderne qui a heureusement épargné le nimbe crucifère du troisième personnage, ce qui permet d’identifier avec certitude une représentation du Christ dont la main droite, maladroitement tracée, esquisse le geste de bénédiction. Devant lui et à l’avant de la table, une forme blanche très dégradée n’est plus guère reconnaissable que par l’auréole de cheveux blonds aux boucles volontairement accentuées qui côtoient les pieds du Christ, désignant la pécheresse du Repas chez Simon tel que l’épisode est rapporté par l’Évangile de Luc (7, 36-50). Le personnage non nimbé, vêtu d’une tunique blanche et d’un bonnet blanc occupant, à l’avant de la table, la partie gauche du panneau peut alors figurer Simon le Pharisien dont les gestes éloquents expriment l’indignation causée par l’incursion de la pécheresse auprès du Christ, suscitant de celui-ci un sermon sur les vertus de la gratitude et du pardon.
Un autre panneau, au-dessus de la baie quadruple du mur sud, présente également une scène de repas dans un contexte religieux qui reste à définir [22]. Sept autres panneaux plus ou moins fragmentaires ont été reconnus, la plupart comportant des personnages nimbés qui confirment la dominante religieuse de l’iconographie [23].
Suite à cette découverte, la Conservation régionale des Monuments Historiques a prescrit une consolidation des peintures dégagées, réalisée par Jacqueline Laroche. Grâce aux nombreuses observations de détail complétées par des analyses de pigments, ce travail a permis de préciser plusieurs aspects techniques [24]. La couche picturale repose sur un simple badigeon de chaux [25], probablement apposé sur la pierre à l’état liquide vu l’abondance des coulures : par sa finesse qui la rend par endroit presque imperceptible, cette préparation n’a aucune fonction d’aplanissement de la surface du parement, dont le traitement est pourtant le plus souvent très irrégulier. Du reste, on constate partout une indifférence évidente à l’égard de l’état de la surface à peindre, les aménagements devenus caducs (ancrages divers ou cavités liées aux systèmes de fermeture des baies romanes modifiées par la suite) ayant reçu la couche picturale sans qu’on ait pris la peine de les boucher. Le décor comme les figures ont été tracés à l’ocre rouge, révélant pour l’esquisse des figures une réelle aisance du peintre, d’autant plus frappante eu égard à la mauvaise qualité du support. La polychromie se limite à des ocres jaune et rouge d’origine minérale, à un noir utilisé systématiquement pour délimiter tant les figures que les motifs décoratifs, un vert bleuté à base de cuivre, et de deux sortes de rouge : un rouge orangé à base de jaune de chrome et un rouge vermillon très vif à base d’oxyde de fer. Tous ces pigments d’origine minérale sont liés avec du carbonate de calcium en faible teneur et un liant organique de type jaune d’œuf.
PÉRIGUEUX, MAISON DITE DES “DAMES DE LA FOI”, mur ouest de la “salle” médiévale, panneau historié : le repas chez Simon de Béthanie.
Relevé A. Marin.Enfin, deux points sont maintenant assurés. D’une part, des sondages ponctuels réalisés sur la totalité des murs de l’étage prouvent que ce décor couvrait sans rupture l’ensemble de la salle. D’autre part, il a été apposé sans conteste dans une deuxième phase d’aménagement de l’édifice : la preuve la plus manifeste en est le réaménagement de la baie ternée du mur oriental dont la partie basse a été obturée par des assises de pierres de taille après suppression des colonnettes qui devaient compartimenter la baie dans le prolongement des petits arcs cintrés échancrés dans le linteau monolithe. L’ouverture de ces derniers a néanmoins été épargnée, agrémentée à la base par un glacis taillé dans l’assise supérieure du bouchage de la baie. La niche faiblement éclairée ainsi ménagée a ensuite été entièrement recouverte par le décor peint, les motifs développés sur les murs adjacents se prolongeant sur les montants de l’ancienne fenêtre, les assises du bouchage de l’ouverture et l’intrados de l’arrière-voussure [26].
Depuis le travail de nettoyage, les figures des panneaux historiés, bien que souvent lacunaires, se révèlent assez nombreuses et dans un état de conservation suffisant pour
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 295
PÉRIGUEUX, MAISON DITE DES “DAMES DE LA FOI”, mur ouest de la “salle” médiévale, panneau historié : le repas chez Simon de Béthanie.
Cliché A. Marin.PÉRIGUEUX, MAISON DITE DES “DAMES DE LA FOI”, mur ouest de la “salle” médiévale, panneau historié : le repas chez Simon de Béthanie, détail.
Cliché A. Marin.autoriser une analyse stylistique qui devrait aider à terme à préciser la datation de ces peintures (fig. 7). Mais, d’ores et déjà, l’ensemble de la composition et en particulier la thématique héraldique du registre médian permettent d’intégrer ces peintures dans la catégorie déjà abondamment représentée des décors de salles d’apparat où dominent les frises d’écus armoriées, dont la faveur semble s’affirmer à la fin du XIIIe siècle et s’amplifier dans toute la première moitié du siècle suivant [27]. D’autre part, le répertoire ornemental utilisé, et notamment la rigueur de l’esprit de géométrie et les effets de perspective recherchés dans l’ordonnance des motifs nous incitent à rapprocher ces peintures des grandes compositions religieuses relativement bien datées de la fin du XIIIe ou du début du XIVe siècle, telles celles des Jacobins de Toulouse et d’Agen [28].
PÉRIGUEUX, MAISON DITE DES “DAMES DE LA FOI”, mur sud de la “salle” médiévale, panneau historié : scène de la vie du Christ.
Relevé A. Marin.Dans le corpus des décors peints de l’architecture civile urbaine médiévale, l’importance de cet ensemble, par la qualité stylistique autant qu’iconographique de sa composition, nous paraît devoir être soulignée. En Aquitaine, actuellement, seul le décor de la “maison aux musiciens” de Mont-de-Marsan [29] soutient la comparaison par l’ampleur et la complexité de son développement, mais dans un registre
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 296
PÉRIGUEUX, MAISON DITE DES “DAMES DE LA FOI”, mur sud de la “salle” médiévale, panneau historié : scène de la vie du Christ.
Relevé A. Marin.purement profane. Si le décor héraldique de la partie médiane n’étonne guère dans le cadre d’une demeure urbaine [30], sa conjonction avec l’iconographie religieuse savante déployée sur la frise sommitale n’a de cesse d’intriguer. Bien que la portée de la thématique religieuse ne doive pas être surévaluée [31], force est de constater qu’aucun ensemble de cette ampleur n’est encore attesté à ce jour dans le contexte d’une simple demeure patricienne [32]. L’appartenance de la demeure à l’Ordre du Temple au moins depuis le milieu du XIIIe siècle prend donc un relief particulier et pourrait expliquer ce trait d’exception de l’iconographie. La confrontation des données de l’analyse archéologique, de celles de l’étude stylistique du décor et de celles que pourraient apporter d’éventuelles recherches historiques complémentaires devrait permettre de préciser la compréhension de ce site, dont on ne saurait trop souligner l’intérêt.
Agnès MARIN »
PÉRIGUEUX, MAISON DITE DES “DAMES DE LA FOI”, décor peint de la “salle” médiévale.
Relevé et restitution A. Marin.
[1] P. GARRIGOU GRANDCHAMP, « L’architecture domestique dans les agglomérations périgourdines aux XIIe et XIIIe s. », dans Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord (désormais cité B.S.H.A.P.), t. CXXII, 1995, p. 683-728 ; P. GARRIGOU GRANDCHAMP, « Habitat et topographie du Puy-Saint-Front à Périgueux aux XIIe et XIIIe s. », B.S.H.A.P., t. CXXIV, 1997, p. 499-523.
[2] F. de VERNEUILH, « Architecture civile au Moyen Âge dans le Périgord et le Limousin aux XIIe et XIIIe s. », Annales archéologiques, p. 162-166. Pour l’historiographie du site, voir P. GARRIGOU GRANDCHAMP, « Le grenier du chapitre de Saint-Front et la “Maison des Dames de la Foi” », B.S.H.A.P., t. CXXI, 1994, note 15 et fig. 8 à 11.
[3] Concernant l’analyse de la façade, voir l’étude récente de P. GARRIGOU GRANCHAMP, op. cit., 1994, p. 192-202 et pour l’ensemble de l’édifice : I. DOTTE-MESPOULÈDE, « Étude architecturale de quatre maisons romanes à Périgueux », B.S.H.A.P., t. CXIX, 1992, p. 233-264.
[4] Projet conçu par M. E. Du Chazaud, architecte du Patrimoine à La Tour Blanche (24).
[5] L’ensemble de l’édifice a en outre été inscrit à l’Inventaire supplémentaire en 1998.
[6] Ch. HIGOUNET, A. HIGOUNET-NADAL, « Les origines de la formation de la ville du Puy-Saint-Front de Périgueux », Annales du Midi, t. 90, n° 138-139, 1978, p. 270.
[7] A. HIGOUNET-NADAL, « Structure sociale et topographie à Périgueux aux XIVe et XVe s. », L’urbanisation de l’Aquitaine, Actes du XXVIIe Congrès d’études régionales, Pau, 1975, Sociétés des Sciences, Lettres et Arts de Pau et du Béarn, 1975, p. 35-48.
[8] A. HIGOUNET-NADAL, « Ce fut la maison des Templiers d’Andrivaux », B.S.H.A.P., t. CXV, 1988, p. 153-156.
[9] Registre des rentes de la Charité, A.C. Périgueux, DD 5, f°5, A. HIGOUNET-NADAL, op. cit., 1988, p. 153.
[10] La commanderie du Temple d’Andrivaux, située à quelques kilomètres à l’ouest de Périgueux, a été fondée en 1139, suite au don de l’église du lieu par l’évêque de Périgueux. Mais la documentation concernant les nombreux dons qui ont alimenté la richesse de l’Ordre n’est conservée qu’à partir du 2e quart du XIIIe siècle (S. GENDRY, « Andrivaux », B.S.H.A.P., t. XCVIII, 1971, p. 159-210).
[11] C’est l’organisation des percements du rez-de-chaussée qui l’atteste, les murs est et ouest ayant été dotés encore lors de la phase de remaniements de la fin du XVIe siècle de fenêtres à ce niveau.
[12] La demeure appartenait alors à Arnauld de La Borie, issu d’une ancienne famille noble périgourdine – son père fut maire de Périgueux et Conseiller au parlement de Bordeaux - s’illustra par une brillante carrière ecclésiastique et par son œuvre de
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 297
traducteur et d’historien (A. DUJARRIC-DESCOMBES, « Recherche sur les historiens du Périgord au XVIIe s. », B.S.H.A.P., t. IX, 1882, p. 162-188).
[13] Aucune trace des circulations verticales ne permet néanmoins de connaître la distribution d’origine et donc de savoir si une communication directe existait entre la partie de la maison côté rue et celle ouverte sur le jardin.
[14] Le système de piliers porteurs est attesté dans plusieurs maisons des XIIIe et XIVe siècles à Périgueux. P. GARRIGOU GRANCHAMP, Inventaire des édifices domestiques romans et gothiques des XIIe, XIIIe et XIVe s. dans le Périgord, 2002, www.societes-savantes-toulouse.asso.fr/samf/grmaison/geomm/France/24/perigueu.htm.
[15] Deux ouvertures percées après coup dans le mur sud et antérieures aux baies du XVIe siècle nous indiquent encore le niveau de circulation de ce niveau qui coupait la partie haute de l’embrasure du portail central, peut-être alors en partie condamné.
[16] Les gonds d’origine insérés dans des logettes soigneusement taillées avant la pose du montant de la porte ainsi qu’un retrait de la maçonnerie ménagé également lors de la construction dans le mur oriental implanté dans le prolongement de la porte et destiné au logement de l’huis sont la preuve que cette ouverture, dont le seuil correspond bien au niveau de circulation du 1er étage, était destinée à servir de porte. En revanche, aucune trace n’a pu être mise en relation pour l’instant avec cette baie pour expliquer avec quelle structure elle fonctionnait (balcon ou pontet ?).
[17] Cet aménagement est attesté par la présence d’ancrages traversants ménagés dès la construction et complétés par une ligne de corbeaux située environ 0,50 m plus bas destinés à porter une poutre muralière.
[18] À Périgueux même dans la maison Place Saint-Étienne, face à l’ancienne cathédrale, à Coulounieix, près de Périgueux, à l’Hôpital Charroux (I. DOTTE-MESPOULÈDE, op. cit., 1992, p. 249-264).
[19] On ignore tout de la nature du décor dans sa partie basse, qui actuellement se trouve dans la moitié supérieure des murs du 1er étage actuel : le dégagement des plâtres récents n’a laissé apparaître que des îlots extrêmement ponctuels de la couche picturale et des parties plus étendues de la couche préparatoire, permettant seulement de s’assurer que le décor couvrait bien la totalité de l’élévation des murs du 1er étage d’origine sur environ 5 m de haut.
[20] Ces écus n’ont pas la forme quasi triangulaire qui s’impose à la fin du XIIIe siècle mais sont bien arrondis à la base, ce qui est peut-être un indice d’ancienneté.
[21] Cet écu peut-être rapproché des armes des Rochechouart, maison originaire du Poitou et du Limousin, qui a tenu à partir du milieu du XIIIe siècle plusieurs seigneuries et fiefs importants en nord Périgord, notamment la châtellenie de Nontron en 1258, de Coussière-Saint-Saud en 1283 (A. de FROIDEFOND DE BOULAZAC, Armorial de la Noblesse du Périgord, t. 1, Périgueux, 1891, p. 424-425).
[22] Un troisième panneau figurant une scène de repas n’a été que partiellement dégagé lors d’un sondage limité.
[23] Un seul d’entre eux figure un animal stylisé, dans un état trop fragmentaire pour être identifié.
[24] Nous tenons à remercier Jacqueline Laroche pour l’esprit de collaboration étroite avec la recherche archéologique qu’elle a mis en œuvre lors de son intervention. Les analyses ont été confiées au Centre National d’Évaluation de Photoprotection (CNEP), Université Blaise Pascal, Clermont II, UMR CNRS 6505.
[25] Sur les trois prélèvements effectués, le résultat des analyses de composition de cette couche sous-jacente varie : si on retrouve partout du carbonate de calcium en teneur largement prépondérante, un aluminosilicate de type ocre à l’état de traces et de la matière organique de type jaune d’œuf en très faible proportion, deux prélèvements ont également révélé la présence d’un sulfate de calcium bihydraté de type plâtre ou gypse. Rapport d’étude par microspectrophotométrie IRTF du CNEP.
[26] Le dégagement en cours du ciment qui couvre le bouchage de la fenêtre à baies quadruples du mur sud semble révéler le même parti.
[27] Voir l’inventaire de ce type de décor aristocratique dans M.-P. SUBES-PICOT, « Découverte de peintures murales civiles du XIVe s. au manoir de Mesnil-sous-Jumièges », Bulletin Monumental, t. 152, 1994, p. 360.
[28] P. DUBOURG-NOVES, « Les Jacobins d’Agen : histoire du couvent, restauration de l’église et de ses peintures », Bulletin archéologique du C.T.H.S., fasc. 29, Paris, 2002, p. 5-42.
[29] M.-D. et F. LAFARGUE, « Étude d’une maison médiévale de Mont-de-Marsan », Bulletin de la Société de Borda, n° 445, 1997, p. 159-188.
[30] À Périgueux même, ce type de décor est attesté à l’hôtel de Gamanson, daté des environs de 1300 : M. GABORIT, Des Hystoires et des couleurs. Peintures murales médiévales en Aquitaine (XIIIe et XIVe s.), 2002, p. 129-131. En Gironde, l’étage du logis du château de Rauzan conservait également les traces d’un décor d’écus dans des quadrilobes, relevé au XIXe siècle.
[31] Les thèmes religieux ne sont pas exclus du décor de l’architecture civile urbaine, mais se limitent le plus souvent à des représentations de Saints ou thèmes moralisateurs, et abordent beaucoup plus rarement les scènes historiées : sur ce sujet voir Ch. de MÉRINDOL, « Murs et plafonds peints à la fin de l’époque médiévale. L’état de la question et première synthèse », Château et société castrale au Moyen Âge, Rouen, 1998, p. 95-96 et M.-C. LEONELLI, « Le décor de la maison », dans Cent maisons médiévales (du XIIe s. au XVIe s.). Un corpus, une esquisse, sous la dir. de Y. Esquieu et J.-M. Pesez, Paris, CNRS, 1998, p. 131.
[32] En Gironde, il faut néanmoins mentionner l’existence, dans un contexte castral, d’un décor à l’iconographie religieuse savante dans la salle du 1er étage de la tour du château de Langoiran, dont l’état de conservation très lacunaire est complété par les descriptions précises que Léo Drouyn en a faites au XIXe siècle (M. GABORIT, op. cit., 2002, p. 190-192).
Le Directeur remercie
Agnès Marin de nous avoir fait partager les progrès de cette passionnante recherche sur
une maison magnifique. Il souligne la qualité admirable des relevés et leur grand
intérêt pour un édifice comme celui-ci.
Après avoir fait
remarquer que les relevés étaient en outre très agréables à l’œil, Patrice
Cabau demande si les écus portent des armoiries exactes ou simplifiées. Agnès Marin dit
que la question reste à approfondir.
Maurice Scellès note
que la salle, dans l’état qui correspond au décor peint, occupe tout l’étage.
Où se trouvaient donc les autres pièces : cuisine, chambres… nécessaires à
un édifice à vocation domestique, si cette hypothèse doit être retenue ? Pour
Dominique Watin-Grandchamp, la grande pièce de l’étage fait penser à une salle
seigneuriale ; la mise en place du décor peint pourrait avoir été réalisée par
les Templiers au moment où ce type de décor se multiplie dans de nombreuses
commanderies. Agnès Marin explique que la possession réelle de la maison doit être
encore précisée.
M.S.A.M.F., t. LXIII, p. 298
Anne-Laure Napoléone demande si la galerie sur l’élévation arrière et la porte qui la dessert supposent une division de l’étage dans l’état d’origine. Agnès Marin indique qu’en effet la porte ne fonctionne plus avec la pièce unique créée lors de la réalisation du décor peint.
À propos de l’opération d’aménagement en cours, Agnès Marin rappelle que la salle où ont été retrouvées les peintures devait être la première à être mise en location mais que l’architecte qui est aussi le propriétaire de l’édifice a modifié son programme pour en garantir la conservation et la mise en valeur. Un membre demande si la maison est classée au titre des Monuments historiques. Agnès Marin précise que seule la façade sur la rue est protégée. On rappelle l’exemple d’une maison de Figeac où le propriétaire était tout à fait disposé à restaurer la façade mais pas l’intérieur, de façon à y loger le maximum de mètres carrés ; la protection au titre des Monuments historiques attire souvent des gens qui sont intéressés par la défiscalisation et pas du tout par le patrimoine. Il est souligné que le propriétaire semble très attentif à l’étude de la maison et à la restauration des peintures et l’on fait remarquer que l’opération s’est accompagnée d’une étude archéologique alors qu’elle est conduite par un propriétaire privé, ce que l’on n’a pas été capable de faire pour un bâtiment public comme l’ancien collège de Périgord. C’est en tout cas une affaire à suivre.
Le Directeur se félicite que cette séance commencée avec l’affaire de l’ancien collège de Périgord s’achève sur une note plus optimiste avec la maison des Dames de la Foi à Périgueux.
Le Directeur fait appel à communications pour la prochaine année académique. Afin de mieux organiser les séances, le Bureau souhaite que soient bien distinguées les communications longues, de trois quarts d’heure à une heure, des communications courtes qui ne doivent pas excéder un quart d’heure.
Le Directeur remercie tous les membres de leur assiduité et de leur participation aux séances et prononce la clôture de l’année académique 2002-2003.
ERRATUM
Page 240, à la Bibliographie, lire :
DU BOURG (M. Antoine), Histoire du Grand-Prieuré de Toulouse [...], Louis Sistac et Joseph Boubée, Toulouse, 1882 (et 1883).
C.I.F.M. = FAVREAU (Robert), MICHAUD (Jean), LEPLANT (Bernadette), Corpus des inscriptions de la France médiévale, 7, Ville de Toulouse, Éditions du C.N.R.S., Paris, 1982 ; 8, Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Tarn-et-Garonne, Éditions du C.N.R.S., Paris, 1982.
GILLES (Henri), Les Coutumes de Toulouse (1286) et leur premier commentaire (1296), Académie de Législation, Toulouse, 1969.
H.G.L.3 = DEVIC (dom Claude), VAISSETE (dom Claude), Histoire générale de Languedoc [...], 3e édition, Édouard Privat, Toulouse, VIII, 1879 ; X, 1885.
LAFAILLE (Germain de), Annales de la ville de Toulouse [...], Prémiére Partie, Guillaume-Louïs Colomyez, Jérôme Posuël, Toulouse, 1687.
LAHONDÈS (Jules de), « Une inscription sur pierre du treizième siècle », dans B.S.A.M.F., nouvelle série, fascicules nos 37-39 [séances du 27 novembre 1906 au 29 juin 1909], Édouard Privat, Toulouse, 1909, p. 534-536 [29 juin 1909].
MUNDY (John Hine), The Repression of Catharism at Toulouse -The Royal Diploma of 1279, Studies and texts, 74, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto, 1985.
© S.A.M.F. 2002-2003. La S.A.M.F. autorise la reproduction de tout ou partie des pages du site sous réserve de la mention des auteurs et de l’origine des documents et à l’exclusion de toute utilisation commerciale ou onéreuse à quelque titre que ce soit.