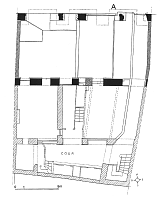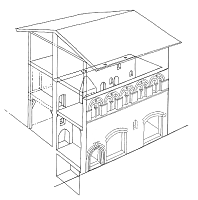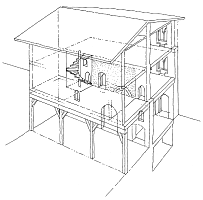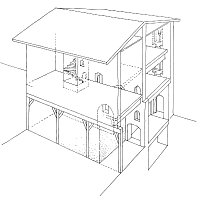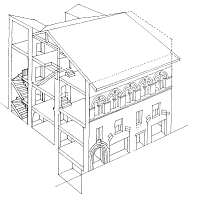|
Mémoires |
BULLETIN DE L'ANNÉE ACADÉMIQUE
2000-2001
établi par Patrice CABAU & Maurice SCELLÈS
| Séances du 3 octobre 2000 au 23 janvier 2001 | Séances du 20 février 2001 au 11 mai 2001 |
| Séances du 15 mai 2001 au 19 juin 2001 | |
M.S.A.M.F., t. LXI, p. 225
SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2001
Présents : MM. Peyrusse, Président, Cazes, Directeur, Scellès,
Secrétaire général, Cabau, Secrétaire-adjoint, Latour,
Bibliothécaire-Archiviste ; Mme Cazes, l’abbé Baccrabère, le Père Montagnes,
membres titulaires ; Mmes Aribaud, Debax, Jimenez, Napoléone, Suau, MM. Manuel,
Molet, membres correspondants.
Invités : Mme Éliette Dambès, M. Forichon.
La Société se retrouve à 17 heures à l’Institut catholique de Toulouse pour une visite du rempart antique et du musée archéologique conduite par l’abbé Georges Baccrabère.
La Compagnie est tout d’abord accueillie par le
Recteur, Mgr Bressolette, qui dit tout l’intérêt qu’il porte au rempart et au
musée de l’Institut ; il signale qu’étant né au Maroc, à Fez, il a
connu jeune les ruines de la ville romaine de Volubilis, dont la visite l’a
passionné.
Le Président remercie le Recteur pour son accueil, puis il évoque le
problème que représente, à terme, la succession de l’abbé Baccrabère :
comment assurer pour l’avenir la conservation des collections et du monument, ainsi
que leur présentation au public ? Le Recteur déclare se soucier de cette question,
dont la solution est à l’étude. À ce propos, il met en avant les difficultés,
d’ordre décisionnel et pécuniaire, que pose le remplacement d’un homme tout
dévoué, qui n’a pas hésité à financer de ses propres deniers les travaux utiles
à la valorisation du patrimoine de l’Institut. Pris par les devoirs de sa charge,
Mgr Bressolette regrette de ne pouvoir suivre la Compagnie.
Georges Baccrabère annonce le plan de la visite,
qui sera successivement consacrée à la maquette de Toulouse antique, à la
reconstitution des monuments funéraires de la voie Narbonnaise et à la courtine
édifiée en bordure de la Garonne dans la seconde moitié du IIIe
siècle.
Dans le musée, la Compagnie fait cercle autour de la maquette de Tolosa,
dont l’abbé Baccrabère indique les caractéristiques : il s’agit
d’une représentation évolutive, où les monuments reconnus archéologiquement sont
matérialisés en cuivre rouge et les monuments hypothétiques figurés en cuivre
jaune ; un système d’éclairage variable permet d’animer la présentation.
Notre confrère fournit d’amples commentaires sur les différents édifices de la
ville antique : la longue enceinte de prestige du Ier
siècle, le grand théâtre, les monuments des eaux (aqueducs de Lardenne
M.S.A.M.F., t. LXI, p. 226
et de Guilheméry, thermes de la rue de Languedoc), les édifices du
culte (le grand temple du forum de la place Esquirol, les temples de la rue
Sainte-Anne et de la Daurade). Quitterie Cazes intervient pour constater
l’enrichissement de la maquette au fur et à mesure des découvertes
archéologiques ; elle suggère de faire pivoter de 90° la figure du temple de la
rue Sainte-Anne, sur le podium duquel avait été construite l’ancienne église
Saint-Jacques. L’abbé Baccrabère répond que, n’ayant vu de ses propres yeux
aucun vestige de ce temple, il ne saurait en fixer l’orientation.
La visite continue avec la présentation des éléments de pierre
sculptée provenant des monuments funéraires de la voie narbonnaise qui ont été
extraits du fondement du rempart du Bas-Empire. Georges Baccrabère rappelle que le
dégagement de ces pièces fut entrepris au début des années 1930 par l’architecte
Pierre Fort, en accord avec le Recteur de l’Institut catholique, Mgr Ducros. Notre
confrère précise qu’il s’est appuyé pour ses restitutions sur les tombeaux
romains de Tunisie ; dans un souci didactique, afin de donner un aperçu de la
diversité des modes de sépulture en fonction des différents niveaux sociaux, il a
également présenté des reconstitutions de tombes ordinaires, telles que des inhumations
en amphore ou sous tuiles en bâtière.
La visite se poursuit par l’exploration des sapes longeant la base
de la courtine du IIIe siècle, où se voient encore en place
les divers éléments architectoniques remployés pour la fondation de ce rempart.
Au terme de la visite, à 19 h 15, l’abbé Baccrabère invite la Compagnie à une collation servie dans une salle de l’Institut catholique. La réunion prend fin dans une atmosphère très conviviale.
SÉANCE DU 6 MARS 2001
Présents : MM. Peyrusse, Président, Coppolani, Directeur
honoraire, Ahlsell de Toulza, Trésorier, Scellès, Secrétaire général, Cabau,
Secrétaire-adjoint, Latour, Bibliothécaire-Archiviste ; Mmes Cazes,
Merlet-Bagnéris, Pradalier-Schlumberger, MM. l’abbé Baccrabère, Gilles, Hermet,
Pradalier, Mgr Rocacher, M. Tollon, membres titulaires ; Mmes Blanc-Rouquette,
Fronton-Wessel, Pujalte, Stutz, MM. Balagna, Bordes, Garland, Ginesty, Manuel,
Salvan-Guillotin, Testard, membres correspondants.
Excusés : M. Cazes, Directeur, le Père Montagnes.
Invités : Mlle Mélanie Chaillou, M. Jean-Michel Garric.
Le Secrétaire général donne lecture du
procès-verbal de la séance du 23 janvier, qui est adopté.
Henri Pradalier signale l’article que La Dépêche du Midi
a consacré au remontage, pour servir d’accès secondaire à la Préfecture, de la
porte provenant de l’Hôtel de Rivière, dont il est précisé
qu’elle a été déposée en 1948. La présentation n’est absolument pas
critique.
Le Président souhaite la bienvenue à Mlle Mélanie
Chaillou, étudiante en maîtrise d’Histoire de l’Art à l’Université de
Toulouse-Le Mirail, et à M. Jean-Michel Garric, conservateur de l’abbaye de
Belleperche.
Il annonce que les rapports pour le concours seront examinés au cours
de la prochaine séance et rappelle la date de la séance publique, qui se tiendra le 28
mars à 18 h à l’Hôtel d’Assézat. Auparavant, la Compagnie est invitée à se
rassembler, à 17 h, dans la salle de lecture, pour fêter le jubilé académique de Jean
Coppolani, notre Directeur honoraire, membre de notre Société depuis plus de cinquante
ans.
Le Bibliothécaire rend compte de la vente d’ouvrages organisée
samedi dernier à l’Hôtel d’Assézat par Mlle Rieg. Le Président rend compte
de la correspondance manuscrite : M. Péchoux nous rappelle de prévoir la
présentation de nos publications lors du congrès du C.T.H.S. et nous avons reçu le
programme des États généraux de la Garonne qui se tiendront le 27 avril 2001.
Le Secrétaire général présente à la Compagnie les dix-sept volumes
de l’Histoire des villes et provinces de France et les cinq volumes des Cahiers
de Fanjeaux que Mme Akermann offre pour notre bibliothèque. Le Président exprime au
nom de notre Société ses plus vifs remerciements à Mme Akermann.
L’ordre du jour appelle l’élection de membres titulaires.
Sur proposition du Bureau, François Bordes et Jean-Luc Boudartchouk sont élus membres
titulaires.
La parole est alors à Henri Pradalier et Jean-Michel Garric pour une communication sur la découverte d’un pavement de carreaux émaillés au palais de la Berbie à Albi, qui sera publiée dans le prochain volume de nos Mémoires (t. LXII, 2002).
M.S.A.M.F., t. LXI, p. 227
Le Président remercie les orateurs. Maurice
Scellès demande quels sont les arguments qui seraient en faveur d’un unique atelier,
dont on imagine difficilement l’activité itinérante alors que nombre
d’édifices, en particulier nombre de grandes demeures, devaient posséder des sols
de carreaux émaillés qui ont aujourd’hui disparu. Jean-Michel Garric dit suivre sur
ce point les hypothèses de Norton mais qu’en l’état actuel de nos
connaissances, il est impossible de se décider. Pour Quitterie Cazes, la question doit
être abordée avec plus de prudence et avec plus d’ambition : raisonner sur un
éventuel atelier demanderait de pouvoir comparer les estampes. Elle souligne qu’il
serait en particulier nécessaire de réaliser un relevé complet de l’ensemble du
pavement de la Berbie. Jean-Michel Garric indique que les comparaisons auxquelles il
s’est déjà livré lui ont montré que des carreaux que Norton disait tirés des
mêmes matrices ne l’étaient pas. Il remarque en outre que certains motifs sont à
l’évidence réalisés à la commande : ainsi en est-il des carreaux aux armes
de l’abbaye que l’on connaît à Moissac. Pour Quitterie Cazes, il est
prématuré de s’en tenir à un atelier alors que l’on a peut-être affaire à
une technique qui se diffuse.
Françoise Stutz signale les nombreux carreaux estampés mis au jour
par les fouilles de l’abbaye cistercienne de l’Île de Ré, dont on s’est
très vite aperçu qu’ils avaient été produits par la fabrique du monastère.
Henri Pradalier rappelle que l’étude des matrices doit tenir
compte de leur usure et Jean-Michel Garric fait remarquer que l’on trouve
fréquemment dans un même pavement des carreaux de très bonne qualité et d’autres
plus médiocres.
Bruno Tollon évoque la maison des Chevaliers de Pont-Saint-Esprit,
bien étudiée par Alain Girard, dont la salle a révélé une parfaite cohérence entre
le décor du sol et celui du plafond. Il ajoute que les carreaux de pavement
d’Avignon et d'Arles ont fait l’objet de publications récentes et que des
articles sont également parus dans des revues comme L’estampille et L’objet
d’art. Maurice Scellès signale également la toute récente mise en ligne sur le
site Internet de notre Société d’une importante bibliographie sur les carreaux de
pavement médiévaux établie par notre confrère Pierre Garrigou Granchamp.
La parole est à Bruno Tollon pour une communication sur la « maison au balcon » à Toulouse :
« Balcon, prestige et sociabilité à Toulouse au XVIIe siècle
Dans le paysage urbain du XVIIe siècle français, le balcon exprime avec évidence la position sociale du bénéficiaire de la noble façade. Si le Mercure français accueille le terme en 1623 pour désigner "une sorte de fenestre qui s'advance au dehors en forme de saillie" ("pour mieux voir sur une place" ajoute Félibien en 1676), l'usage est beaucoup plus ancien. Les balcons ne se comptent pas à Venise ou Rome dès le XVe siècle et la France qui les fait dériver des échauguettes accueille le mot italien et la formule.
Pour les façades des maisons urbaines, l'usage se répand au XVIe siècle. Sur l'Île-Saint-Louis à Paris, le "quai du balcon" sert même à désigner le quai de Béthune. À Toulouse, les premières mentions appartiennent au dernier tiers du siècle, avec le balcon de l'Hôtel Barthélemy de Gramont (1678) et celui de l'Hôtel Du Bourg (1684). Or il existait avant cette date un édifice à balcon bien antérieur. Il est signalé dans les Annales de la ville de Toulouse de Du Rozoy (t. IV, 1776, p. 337) relatant longuement le cérémonial de l'entrée dans sa cathédrale du nouvel archevêque, en 1628. Charles de Montchal, arrivé sur la place Saint-Étienne, quitte le cortège et "entre dans la maison du Balcon, où, ayant pris ses habits pontificaux, il est harangué par le Prévôt Louis de Bertier" avant de pénétrer dans la cathédrale pour la suite des cérémonies. Ainsi, dans le déroulement de l'entrée solennelle, cette "maison du Balcon" utilisée dans un cérémonial rigoureusement codifié doit certainement faire partie des bâtiments dépendants du palais épiscopal, sans que le texte ne nous apporte aucune indication sur son statut ni sur son emplacement. En outre, les bâtiments actuels de la préfecture qui occupent les locaux de l'ancien archevêché n'en ont pas conservé la trace. On sait que l'édifice actuel est largement postérieur à l'épiscopat de Montchal et fut rebâti pour l'essentiel entre 1690 et 1704, et pour le grand portail d'entrée après 1770. Par chance, sur une peinture de la fin du XVIIe siècle qui relate la Procession des corps saints (huile sur toile, 0,185 x 0,690 m, Musée des Augustins) analysée par Robert Mesuret (Miniaturistes du Capitole 1610-1789, Toulouse, 1956, n° 33), le peintre a consacré l'arrière-plan à une vue idéalisée de la ville entre Saint-Étienne et Saint-Sernin. Sur la gauche du tableau, on voit le portail occidental de la cathédrale et le passage qui conduit aux bâtiments de la prévôté et de la résidence épiscopale ; à droite de ce passage, les maisons qui limitent le côté ouest de la place jusqu'à la rue Fermat. L'une d'elles, proche de l'entrée du palais, montre à l'étage un pavillon coiffé à l'impériale supporté par trois grandes consoles de pierre. Après vérification, cet immeuble appartenait bien à l'enclos épiscopal (cadastre de 1679, A.M. Toulouse, CC 126) et ceci jusqu'à la fin de l'ancien régime (cadastre Grandvoinet et plan Saget, 1750). En outre, le projet de Charles-Antoine D'Aviler consulté par Mgr de Colbert pour les travaux de 1690, montre l'état des lieux qui correspond à la maison du tableau (A.D. Haute-Garonne).
M.S.A.M.F., t. LXI, p. 228
Cet élément exceptionnel en façade, conçu encore comme un pavillon en saillie sur "bouquets de pierre" à la manière de nombre de cabinets en encorbellement ou d'échauguettes, forme plutôt ici une sorte de loggia largement ouverte pour répondre à un usage public. On peut proposer d'y voir l'endroit d'où Montchal écouta la harangue, au vu de la foule massée sur la place, avant de prendre possession de sa cathédrale. Outre l'intérêt de cet édicule qu'on pourrait rapprocher du perron des palais et des autres éléments destinés à entrer dans le déroulement des mises en scène à caractère politique, juridique et religieux, et qui mériteraient une étude approfondie, relevons le fait qu'il a servi à désigner l'ensemble de l'immeuble édifié le long de la place. Cette façade à balcon constituait l'élément avancé des bâtiments épiscopaux et le désignait à une fonction de caractère public qu'on aimerait pouvoir préciser. De la même façon, rien ne permet jusqu'ici d'avancer une date pour sa construction, même si les consoles destinées à porter les coursières se rencontrent au XVIe siècle. On connaît celles de l'Hôtel d'Assézat (ca 1561) et des châteaux de Caumont (1575) et de Laréole (1579). Quant aux pavillons ou baldaquins sur colonnes, ils servaient à mettre en valeur des perrons d'entrée (celui du Parlement de Toulouse est daté, sans preuve, des années 1554 et aurait servi de modèle pour celui de l'Hôtel d'Ulmo – ca 1660 –). Remarquons enfin que les premiers balcons établis en façade l'ont été à proximité de la cathédrale. L'architecte Nicolas Buterne dessine le premier pour Gabriel Barthélemy de Gramont en 1678, place Saint-Étienne, et le second pour Léonard Du Bourg en 1684, sur la place Saintes-Scarbes. Tous deux conservent leur dalle portée par de puissantes consoles d'un type comparable à celles du balcon de l'horloge qui décore le clocher de la cathédrale. La "maison au Balcon" fournit donc un témoignage irremplaçable du goût pour les éléments hors-œuvre installés sans aucun souci de symétrie ou d'axialité dans l'organisation des façades, mais seulement pour leur fonction dans l'utilisation publique des espaces ou leur simple commodité pour satisfaire orgueil et curiosité, et c'est notre vision longtemps réductrice des siècles classiques et des formules architecturales qui a amené à les passer sous silence.
Bruno Tollon »
Le Président remercie Bruno Tollon et demande comment s’explique le fait que cette forme italienne, que connaissait le Midi méditerranéen, soit aussi tardive à Toulouse. Bruno Tollon rappelle que les encorbellements sont des éléments de curiosité, qu’ils soient en façade ou en logette sur cour. Le balcon de la place Saint-Étienne est antérieur à 1628, sans que l’on puisse fixer la date de sa réalisation. Il faudrait faire la recherche dans le fonds de l’archevêché, et faire peut-être également appel à la réglementation urbaine puisqu’il s’agit d’une saillie sur la voie publique. Guy Ahlsell de Toulza ayant demandé s’il s’agissait de l’exemple le plus ancien à Toulouse, Bruno Tollon signale les consoles de l’Hôtel de Barthélemy de Gramont, dont Alain Smitarrello a retrouvé le contrat, lequel demanderait à être étudié.
Le Président donne la parole à Quitterie Cazes pour quelques observations sur le chantier de la rue Sainte-Anne :
« Le rempart de Toulouse est particulièrement bien conservé dans le secteur de la cathédrale Saint-Étienne, entre les rues Sainte-Anne à l'ouest et Bida et François-Verdier à l'est : il forme encore les limites parcellaires à l'intérieur de ce moulon. L'abbé Baccrabère en avait étudié les soubassements visibles (1), mais d'autres portions en ont été analysées, à plusieurs reprises, depuis une dizaine d'années (2). Outre les bases d'une tour ronde et d'un segment de courtine actuellement dégagés près de la place Saint-Jacques, la tour à talon du n° 5 bis rue Bida est représentée sur le plan cadastral, et deux autres tours sont en partie conservées au n° 15 de la rue Bida et au n° 18 de la rue Sainte-Anne. Un pan complet de courtine d'une dizaine de mètres de hauteur a été analysé par C. Boccacino en 1992 au n° 10 de la rue Sainte-Anne, et deux autres sont visibles au n° 22 de la rue Sainte-Anne ainsi qu'au n° 25 des allées François-Verdier. Les textes nous renseignent aussi sur les travaux que le rempart a connu en cet endroit : en 1355, il est couronné de mâchicoulis portant un chemin de ronde couvert (3), tandis qu'en 1579, on réalise le bastion au nord de l'enceinte, contre la porte Saint-Étienne (4). Mais le document le plus précieux concernant cet ensemble est sans conteste le relevé, d'une précision tout archéologique, effectué par J.-P. Virebent vers 1780, intitulé "L'élévation des Tours et des Murs de clôture du Cloître St Etienne du côté de l'esplanade servant de murs de Ville" et conservé au Musée Paul-Dupuy (5).
Or, depuis la fin de l'année 2000, l'enceinte est très visible au n° 18 rue Sainte-Anne depuis que les bâtiments fondés en 1850 par les sœurs de Saint-André de Colomiers – avec la petite chapelle construite par Henri Bach (6) – ont été démolis pour laisser la place à un nouveau projet immobilier d'immeubles d'habitation. Les enduits de plâtre des différentes pièces de l'ancienne institution empêchent une bonne lisibilité de l'ensemble, mais la tour ronde se voit parfaitement : sa partie basse, intacte mais enterrée, est couverte d'une coupole de brique, et son
M.S.A.M.F., t. LXI, p. 229
TOULOUSE, DÉTAIL DU "MUR DE LA VILLE"
relevé par J.-P. Virebent vers
1780, Musée Paul-Dupuy. Cliché Q. Cazes.
élévation, amputée dans sa partie occidentale, est conservée sur une dizaine de mètres de hauteurs. Pour bien comprendre ce qui subsiste, il faut d'abord analyser le relevé de Virebent.
De droite à gauche, c'est-à-dire du nord vers le sud, on aperçoit d'abord le bâtiment dit de la Chancellerie, probablement l'école du chapitre de la première moitié du XIIe siècle, puis une élévation avec deux grands percements rectangulaires surmontés de deux plus petits ; leur fait suite une tour ronde, avec trois niveaux de baies (une rectangulaire dans l'axe au premier niveau, deux de même forme surmontées d'arcs de décharge au deuxième niveau, trois enfin apparaissent sous le toit conique) ; un cordon de briques sépare les deux premiers niveaux. La courtine qui fait suite montre une série de mâchicoulis (ceux du XIVe siècle), portant le parapet du chemin de ronde qui n'a conservé qu'au sud ses mirandes ; au-dessous de la surélévation médiévale apparaissent une série de petites fenêtres couvertes en plein cintre, peut-être les créneaux réaménagés de l'enceinte antique.
C'est une partie du revers de cette élévation qui est visible au n° 18 rue Sainte-Anne. Dans la tour, sont visibles les percements dessinés par Virebent, mais le couronnement paraît avoir disparu. Le décrochement visible aux deux-tiers de la hauteur correspond au sommet de la muraille antique, et par endroits s'aperçoivent bien les petits murets transversaux et le blocage de galets pris dans du mortier caractéristiques de la construction antique. ÀTOULOUSE, RUE SAINTE-ANNE,
revers du « mur de la ville » après la démolition des bâtiments de la maison des Filles de la croix de Saint-André. Cliché Q. Cazes.
M.S.A.M.F., t. LXI, p. 230
gauche de la tour, l'élévation avec ses deux grands percements rectangulaires correspond au dessin du XVIIIe siècle, tandis que le mur qui fait retour est tout ce qui subsiste de l'ancienne "Chancellerie" romane.
Il s'agit ici, si la tour est bien romaine dans sa totalité comme cela semble être le cas, du plus haut monument romain conservé à Toulouse. L'étude archéologique de l'ensemble est plus que souhaitable : on a ici une chance, probablement unique, d'étudier le rempart dans ses parties hautes, tant antiques que médiévales. Le rêve serait bien sûr qu'à la suite, cet impressionnant vestige soit mis en valeur… (7)Quitterie Cazes »
1. G. Baccrabère, Étude de Toulouse romaine, Chronique n° 3 (supplément au Bulletin de littérature ecclésiastique), 1977, p. 49-51.
2. Q. Cazes, Le quartier canonial de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, Centre d'Archéologie médiévale du Languedoc, suppl. n° 2, p. 13-16.
3. A.M. Toulouse, EE 32.
4. A.M. Toulouse, CC 2501.
5. Dessin aquarellé, inv. n° 459 : R. Mesuret, Inventaire général des dessins des musées de province, II, Toulouse : musée Paul-Dupuy, dessins antérieurs à 1830, Paris, 1958, n° 163.
6. J. Nayrolles, Henri Bach, 1815-1899, mémoire de maîtrise sous la dir. d'Y. Bruand, 1987, p. 61-62.
7. À l'heure où le Bulletin est sous presse, l'étude archéologique a été entreprise par Olivier Gaiffe, conservateur au Service régional de l'Archéologie.
Le Président remercie notre consœur de nous mettre une fois de plus en présence d’une situation catastrophique. Nous croyons vivre dans une société de progrès, dotée des outils empêchant le vandalisme, et il nous faut prendre acte que celui-ci existe toujours, conséquence de l’ignorance ou de la rapacité. Pour Quitterie Cazes, dans le cas du rempart romain, il n’y a pas à proprement parler de vandalisme puisque le nouveau bâtiment sera plaqué et ne le détruira donc pas ; elle s’étonne en revanche qu’aucune étude de l’élévation du XIe siècle ne soit prévue et se demande s’il est utile de publier le résultat de ses recherches si cela ne suscite pas la moindre curiosité scientifique.
Au titre des questions diverses, Bruno Tollon attire l’attention de la Société sur le fait que des objets dont le prêt avait été demandé à Maurice Prin par le conservateur de l’ensemble conventuel des Jacobins ne sont pas revenus sur leur lieu de conservation habituel, mais ont été relégués en réserve.
SÉANCE DU 20 MARS 2001
Présents : MM. Peyrusse, Président ; Coppolani,
Directeur honoraire ; Ahlsell de Toulza, Trésorier ; Latour,
Bibliothécaire-Archiviste ; Scellès, Secrétaire général ; Cabau,
Secrétaire-adjoint ; Mmes Pousthomis-Dalle, Pradalier-Schlumberger, MM. l’abbé
Baccrabère, Bordes, Boudartchouk, Gilles, le Père Montagnes, Nayrolles, Pradalier, Prin,
Tollon, membres titulaires ; Mlle Jimenez, Mme Suau, MM. Gillis, Manuel, Molet,
Testard, Vézian, membres correspondants.
Excusés : M. Cazes, Directeur ; Mmes Cazes, Ugaglia, Fraïsse.
La parole est au Secrétaire-adjoint, puis au
Secrétaire général, pour la lecture des procès-verbaux des séances du 20 février et
du 6 mars, qui sont l’un et l’autre adoptés.
Le Président rend compte de la correspondance imprimée, qui comprend
notamment l’annonce de diverses expositions, ainsi que le programme du colloque
international qui aura lieu à Toulouse du 7 au 9 juin sur le thème :
« Nicolas Tournier et la peinture de la réalité ». Il présente ensuite
plusieurs tirés-à-part que Maurice Scellès offre à notre bibliothèque. Puis il
signale divers articles ou comptes rendus intéressants publiés dans le dernier fascicule
du Bulletin monumental (158-V, 2000) :
- Pascal Julien, De l’imagier Jean Bauduy au Maître de Biron : les
"momies des comtes de Toulouse", statues en terre cuite de 1523, p. 323-340
(article malheureusement tronqué) ;
- Marie-Laure Fronton-Wessel, Le plafond de la Grand’Chambre de la Cour
d’Appel de Toulouse (fin du XVe siècle), p.
361-362 ;
- recensions des articles de Gilles Séraphin et de Chantal Fraïsse parus dans le tome
LIX (1999) des M.S.A.M.F., p. 373-374.
M.S.A.M.F., t. LXI, p. 231
Louis Peyrusse rappelle enfin que le mercredi 28
mars auront lieu, à 17 heures, le Jubilé académique de notre confrère Jean Coppolani,
Directeur honoraire, et, à 18 heures, la séance publique annuelle de la Société, dont
la conférence consacrée aux comtes de Toulouse sera prononcée par notre confrère
Laurent Macé.
Michèle Pradalier-Schlumberger intervient pour présenter les Journées
d’études sur les maisons médiévales dans le Midi de la France qui se tiendront
les samedi 19 et dimanche 20 mai sous l’égide du C.N.R.S., de l’Université de
Toulouse-Le Mirail et de notre Société. Organisées à l’initiative de nos
confrères Maurice Scellès et Anne-Laure Napoléone, ces Journées seront axées non sur
des études monographiques, mais sur des recherches thématiques : la symbolique de
la maison médiévale, la brique dans le Midi, le bois, le verre dans l’architecture
civile, la polychromie de la maison médiévale, le vocabulaire architectural de la maison
dans les textes…
La parole est ensuite aux rapporteurs pour le concours 2001 de notre Société. Jean Nayrolles lit son rapport sur le travail de François de Vergnette, Jean-Paul Laurens (1838-1921), peintre d’histoire, thèse de doctorat nouveau régime en Histoire de l’Art soutenue en novembre 2000 à l’Université de Paris X-Nanterre :
« Trois ans après l’exposition consacrée à Jean-Paul Laurens par le Musée d’Orsay et le Musée des Augustins, l’étude de François de Vergnette vient apporter la synthèse complète et approfondie qui manquait encore sur le grand peintre toulousain. En 1997-1998, l’exposition présentée à Paris puis à Toulouse fut un événement : le Musée d’Orsay consacrait pour la première fois une importante rétrospective à l’un de ces peintres d’histoire de la fin du XIXe siècle stigmatisés par le vocable péjoratif de "peintres pompiers". Le catalogue s’ouvrait sur une préface d’Alain Daguerre de Hureaux au titre évocateur : "Pourquoi une exposition Jean-Paul Laurens ?". La question méritait en effet d’être posée : face, par exemple, au chroniqueur du journal Le Monde qui voyait en Laurens un vulgaire et risible "entrepreneur de spectacles", il fallait réaffirmer la nécessité de faire toute sa place à "l’autre XIXe siècle", celui des artistes restés fidèles à la tradition. Les deux articles de François de Vergnette – "Jean-Paul Laurens et la critique de son temps" et "Portrait de Jean-Paul Laurens en homme exemplaire" – apportaient une contribution de poids au catalogue édité par la Réunion des Musées nationaux. Déjà, son point de vue était celui qui devait présider à l’élaboration de sa thèse : se situer rigoureusement en historien, au-delà de toute polémique, de tout panégyrique. Il s’agissait d’abord de prendre l’œuvre de Jean-Paul Laurens au sérieux. Cette exigence est rappelée dans l’avant-propos de sa thèse : "Je me suis gardé de tout éloge gratuit envers les œuvres de Laurens, ayant préféré conserver une curiosité tranquille et objective dont André Chastel demandait de faire preuve devant cette peinture du XIXe siècle". Pour défendre son droit de cité à l’autre XIXe siècle, François de Vergnette a compris que l’heure des passions militantes doit fait place au temps de l’approfondissement tempéré. Sa monographie n’est donc pas tant un procès en réhabilitation qu’une enquête historique comparable à toutes les grandes monographies d’artistes de la période moderne.
Nombre de ses contemporains voyaient en Laurens le dernier des peintres d’histoire. Afin de saisir la notion clef de peinture d’histoire, François de Vergnette retrace dans son introduction le devenir du genre historique, depuis David jusqu’à la fin du siècle, en passant par Gros et la geste napoléonienne, les peintres troubadours et le genre anecdotique, Paul Delaroche et la vérité de la couleur locale, Thomas Couture et le retour à la grande tradition, etc. Il analyse aussi la crise de la hiérarchie des genres sous la pression du réalisme de Courbet, puis de la génération des naturalistes de Salon (Bastien-Lepage, Lhermite… ) et la tentative de conciliation entre peinture d’histoire et réalisme, tentative dont Jean-Paul Laurens sera le principal représentant. L’introduction, brillante, pose les fondements théoriques sur lesquels se construira le développement et prouve la grande maîtrise de l’auteur face à des notions complexes, souvent mouvantes.
Le corps de l’étude se répartit simplement en deux volets : "Jean-Paul Laurens, sa formation, l’homme, sa carrière" d’une part, et "L’œuvre, sa réception, ses sujets, son style" d’autre part. Chacun de ces titres donne, dans l’ordre, le contenu des deux triptyques qui composent l’ensemble.Dans la première partie, François de Vergnette dose avec subtilité la particulier et le général, passe sans cesse de l’un à l’autre pour éclairer la figure singulière de l’artiste à la lumière du contexte historique, politique, social et institutionnel. En retour, il dégage ce qui, dans la biographie de son personnage, relève d’un parcours hors du commun. Ce fils de paysans de Fourquevaux, accédant à l’école des beaux-arts de Toulouse, puis à celle de Paris, ne parvenant pas à obtenir le prix de Rome, traversant des années difficiles à la fin du Second Empire, mais se hissant au cours des années 1870 au rang des vedettes du Salon, a inspiré l’écrivain Ferdinand Fabre, devenu son ami, qui en fit le sujet de l’un de ses livres, le Roman d’un peintre (1878).
François de Vergnette s’arrête particulièrement sur la formation intellectuelle et politique d’un Jean-Paul Laurens que l’on voit passer dans le salon de Juliette Adam fréquenté par Gambetta, se passionner pour Victor Hugo, lire
M.S.A.M.F., t. LXI, p. 232
Georges Sand, Michelet et Augustin Thierry, bref, devenir, très jeune, républicain. Un républicain fortement marqué par l’esprit de 1848 : anticlérical, il demeure pétri de préoccupations religieuses et métaphysiques. Son déisme est semblable à celui d’Hugo qui, à la fin de sa vie, détestait les prêtres autant qu’il adorait Dieu. Parvenu à la notoriété, élu membre de l’Académie des beaux-arts, il ne renie rien de ses engagements : il est même l’un des rares membres de l’Institut à prendre ouvertement parti pour Dreyfus. Au nombre de ses proches et de ses intimes, on compte à cette époque Charles Péguy, Auguste Rodin (qui l’appelle "cher maître") et le jeune André Gide – ami de l’un de ses fils.
Ayant eu accès à de nombreuses archives, dans des fonds privés en particulier, François de Vergnette a recueilli une quantité impressionnante de faits qui, rangés dans l’ordre, reconstituent une biographie précise, mais aussi permettent de brosser le tableau d’une époque. Dans le chapitre III qui clôt cette première partie, chapitre intitulé "La carrière d’un peintre d’histoire sous la IIIe République", l’auteur analyse surtout les rapports entre Laurens et les pouvoirs publics, commanditaires des grands décors monumentaux : le plafond du palais de la Légion d’honneur, le cycle du Panthéon sur la mort de sainte Geneviève, la coupole du théâtre de l’Odéon, le salon Lobau à l’Hôtel de Ville de Paris, la salle des Illustres et l’escalier du Capitole de Toulouse, la bibliothèque de la Sorbonne, la salle du conseil municipal à l’Hôtel de Ville de Tours, la salle des fêtes de la préfecture de la Loire à Saint-Étienne et la coupole ainsi que le foyer du théâtre municipal de Castres. Il faut aussi mentionner plusieurs cartons de tapisseries commandés pour la manufacture des Gobelins. Un tel catalogue impressionne. Il fait à coup sûr de Jean-Paul Laurens le peintre décorateur le plus prolixe de la IIIe République. Mais ses participations aux Salons ne sont pas négligeables pour autant. Dans ce domaine aussi, l’État et les municipalités jouent un rôle important grâce à leurs nombreuses acquisitions, surtout dans les années 1870 et 1880. Par la suite, les acheteurs privés vinrent relayer les institutions publiques. On en trouve un peu partout dans le monde : des États-Unis à la Russie, en passant par l’Argentine et le Japon ! Cependant, il ne faudrait pas croire que, dans ces conditions, Laurens accéda à un niveau de fortune comparable à celui des peintres contemporains exclusivement voué au public des particuliers – les Messonier et les Gérôme. Homme de convictions aux goûts austères, Laurens a toujours préféré œuvrer pour la Cité que travailler pour l’argent.
Tout au long de cette première partie, François de Vergnette situe son enquête dans le prolongement des travaux du professeur Pierre Vaisse, qui fut d’ailleurs son premier directeur de recherche, avant son départ de Paris-Nanterre pour l’université de Genève. Les grilles d’analyse proposées dans sa thèse, La IIIe République et les peintres, devenue un classique, trouvent ici une série d’applications fines et précises.La seconde partie, consacrée à l’étude de l’œuvre, ne se veut pas moins objective que la première. Afin d’éviter les pièges de la subjectivité dans les analyses stylistiques ou des interprétations personnelles dans les analyses iconographiques, l’auteur a choisi de faire de la réception de l’art de Laurens par ses contemporains son point de départ. C’est un choix plein d’audace si l’on considère la part faite en principe à la question de la fortune critique dans les plupart des études monographiques, soit en fin de développement, comme une question annexe, la chronologie dictant habituellement son ordre à la logique de l’exposé. La prise en compte préalable de la réception de l’art de Laurens donne une assise historique solide à la compréhension de celui-ci. Embrassant l’immense production critique des comptes rendus du Salon et des articles de synthèse parus sur le peintre de son vivant, François de Vergnette détermine plusieurs familles d’auteurs en fonction de leurs combats esthétiques ou de leur appartenance politique. Pour Laurens : la plupart des tenants du naturalisme – Duranty, Castagnary, etc. – à l’exception notoire de Zola et de ses épigones, Huysmans et Mirbeau ; contre : les catholiques, à cause du contenu anticlérical de nombreux tableaux du peintre, et les symbolistes à cause du puissant effet de réalité prosaïque qui émane de l’ensemble de l’œuvre. Peu de critiques échappent donc au déterminisme de leur famille idéologique. On note cependant la pénétration des analyses de l’un d’entre eux, esprit indépendant, à la fois moderne et réactionnaire, issu du symbolisme mais admirateur de Claude Monet : Camille Mauclair. Ce dernier met sans doute le doigt sur l’essentiel en désignant les obsessions de Laurens – la mort, le pouvoir, la confrontation entre individus, le tragique de l’existence… – et en situant l’élément psychologique au centre de son œuvre.
Dans le chapitre suivant, consacré aux thèmes iconographiques, on apprend non sans surprise que les grands historiens romantiques (Michelet et Thierry) n’ont peut-être joué qu’un rôle secondaire dans l’inspiration de Laurens. Plus exactement, ils lui ont donné sa vision de l’histoire plutôt que des thèmes iconographiques particuliers. D’ailleurs, le Moyen Âge n’est pas omniprésent dans ses œuvres. Les sources du peintre sont plus variées qu’on ne le croit habituellement et s’étendent jusqu’aux Histoires extraordinaires d’Edgar Poe. Laurens n’est pas un illustrateur mais un peintre d’idées dans la grande lignée des peintres d’histoire. Il donne à ses œuvres une valeur morale ou idéologique. Par exemple, au Salon de 1872, La mort du Duc d’Enghien apparaît
M.S.A.M.F., t. LXI, p. 233
comme une évocation du pouvoir arbitraire de l’Empire et donc comme une critique envers le régime de Napoléon III, tandis que Le pape Formose et Étienne VII constitue une réponse cinglante au dogme de l’infaillibilité pontificale. Tableaux idéologiques certes, mais aussi expression des obsessions de l’artiste, drame individuel dans un cas, cérémonie macabre dans l’autre, les deux œuvres parlent de la mort, son thème de prédilection.
Le dernier chapitre porte sur le style de Jean-Paul Laurens. François de Vergnette insiste sur l’erreur consistant à croire qu’il s’agit là d’une "peinture sans problème de peinture", comme cela a été dit à propos de la production des pompiers trop systématiquement considérée comme une pure et simple production d’images.
Il y a d’abord la question de la facture : des pâtes inlassablement triturées dans les tableaux de chevalet, ou au contraire des effets de légèreté et de transparence dans de nombreux décors – ceux de la salle des Illustres en particulier, où Laurens a cherché à obtenir l’aspect d’une aquarelle à l’échelle monumentale grâce à une technique peu commune en matière de peinture murale.
Il y a surtout la question de la "mise en scène" dans chacune de ses compositions : le choix du moment, de l’action, la définition de l’espace pictural, la disposition des personnages… – toutes choses qui font d’emblée penser au monde du théâtre que Laurens connaissait bien. Mais encore une fois, François de Vergnette détruit une idée reçue en démontrant que Laurens n’a pu être influencé par des mises en scène contemporaines car il devançait, par ses audaces, des effets qui ne sont apparus que plus tard dans les représentations théâtrales. Il resterait à cerner la part destinée au spectateur dans les jeux savants de la psychologie laurensienne, mais, manifestement, François de Vergnette a hésité à s’aventurer sur ce terrain déjà balisé par les historiens d’art anglo-saxons, Michael Fried et Stephen Bann, sans doute pour ne pas faire d’entorse à son vœu d’objectivité.
Sans pousser les interprétations jusqu’à la conjecture, l’étude de François de Vergnette met en évidence l’inventivité de Jean-Paul Laurens. Une inventivité qui, pourtant, devait demeurer lettre morte après sa disparition en 1921. Laurens aura bien été le dernier peintre d’histoire, portant la description et la narration à un degré de réalisme qui n’avait jamais été atteint dans le genre historique. Être un réaliste à la fois narratif et descriptif, cela revenait à se détourner de la modernité qui ne se souciait plus ni de raconter ni de dépeindre.Au-delà de l’apport considérable à la connaissance de la peinture d’histoire parvenue à son point d’achèvement, la thèse de François de Vergnette mérité d’être considérée comme un modèle de monographie d’artiste. À ses qualités universitaires s’ajoutent deux raisons particulières pour lesquelles la Société Archéologique du Midi de la France devrait la distinguer : tout d’abord parce que Laurens a orné le Capitole de ses plus belles compositions peintes, qui par conséquent font corps avec un des monuments insignes du patrimoine de Toulouse ; mais aussi parce que, dans nombre de ses œuvres, il fut le peintre de l’histoire du Languedoc avec une telle verve que tout un imaginaire régional en reste, peut-être inconsciemment, marqué. »
Maurice Scellès donne lecture du rapport rédigé par M. Robert Sablayrolles sur les travaux de Fabien Colléoni, un mémoire de maîtrise consacré à la prospection archéologique de quatre communes du Gers, suivi d’une Recherche sur les campagnes du sud-ouest de la Gaule (diplôme d’études approfondies) :
« Monsieur Fabien Colléoni a poursuivi à l'université Toulouse II - Le Mirail des études d'histoire, d'histoire de l'art et d'archéologie. Étudiant brillant, Monsieur Colléoni témoigna, dès ses premières années à l'université, de qualités exceptionnelles, rarement réunies chez un néophyte, surtout dans les périodes actuelles : vaste culture, maîtrise de la langue et plaisir de l'écriture, curiosité intellectuelle, sérieux dans le travail et ténacité dans l'effort.
Fabien Colléoni décida de poursuivre un cursus archéologique, obtenant, après un double DEUG d'histoire et d'histoire de l'art, une licence d'archéologie. Il réalisa, en 1997-1999, une maîtrise de prospection archéologique sur quatre communes du Gers, située à la limite des antiques cités d'Auch et d'Eauze (Saint-Jean-Poutge, Lannepax, Marambat et Vic-Fezensac), puis soutint, en 1999-2000, un DEA sur Recherche sur les campagnes du sud-ouest de la Gaule. Il obtint, pour ces deux diplômes, la mention Très Bien, avec la note exceptionnelle de 19/20 pour chacun des deux mémoires.
La carrière universitaire de Fabien Colléoni a été construite de façon réfléchie et lui a fait méthodiquement gravir les degrés d'apprentissage d'un métier de chercheur. Avec son travail de maîtrise, Fabien Colléoni s'initia aux techniques de terrain, du dépouillement de la bibliographie à l'enquête orale auprès de la population et au parcours systématique des terroirs. Dans chacun de ces domaines, Fabien Colléoni fit preuve de ses remarquables facultés d'adaptation à des exercices d'un genre bien différent. Le succès de Fabien Colléoni peut se chiffrer en la matière : de huit sites archéologiques connus avant son intervention, le corpus est passé à soixante-douze à l'issue de sa
M.S.A.M.F., t. LXI, p. 234
maîtrise. Au-delà du travail d'inventaire, Fabien Colléoni fit la preuve de son aptitude à la recherche et à la synthèse, en élaborant une grille d'analyse de ses cartes, qui, croisant diverses données, comme la topographie, la pédologie, l'hydrographie, les distances des sites entre eux, les distances des sites à l'eau et aux voies de communication, mit en lumière les principales règles qui avaient présidé à l'occupation du terroir dans l'Antiquité.
Homme de terrain, Fabien Colléoni s'est avéré chercheur au sens plein du terme dans le cadre d'un DEA qui exigeait la maîtrise d'une vaste bibliographie, un esprit critique et une approche prospective de la recherche. En une seule année, malgré un travail de surveillant d'internat, il a fait le tour d'un problème à la mode, et sur lequel, par conséquent, la bibliographie était abondante et variée : l'occupation de l'espace rural, qui allie la connaissance des données naturelles, géologiques, pédologiques et climatologiques, celle des sciences du paléo-environnement (palynologie, carpologie, archéozoologie) et celle des techniques culturales et de l'organisation du territoire. Fabien Colléoni a dominé cette matière foisonnante, il a montré à nouveau son sens de la synthèse et également cet esprit critique qui permet de prendre l'indispensable distance face aux phénomènes de mode. Fabien Colléoni a su, par sa parfaite connaissance de l'archéologie régionale, montrer les lacunes considérables de la recherche en la matière dans le Sud-Ouest et élaborer, grâce à une perspicacité intuitive et aux contacts qu'il a noués avec les chercheurs tant régionaux que nationaux (ce qui n'est pas la moindre de ses qualités !), un projet de recherche pour commencer à combler le retard de notre région dans ce domaine.
Ces qualités exceptionnelles et cette maturité étonnante chez un jeune chercheur, alliées à un style agréable et brillant, malheureusement si rares dans la littérature archéologique, ont valu à Fabien Colléoni une allocation de recherche pour une thèse sur Les campagnes de la cité d’Auch dans l'Antiquité, et un poste d'allocataire-moniteur dans notre université, où il fait partager à des étudiants qui étaient, il y a si peu, ses condisciples sa passion pour l'archéologie agraire. Son attachement et ses compétences pour l'archéologie régionale, ses qualités d'homme de terrain, sa valeur de chercheur et ses talents d'écrivain désignent Fabien Colléoni comme un remarquable candidat au prix du professeur Michel Labrousse, souvenir d'un homme qui était attaché à sa région, possédait une immense culture archéologique et historique, qu'il fit partager au travers d'écrits qu'on prenait plaisir à lire. »
Louis Peyrusse remercie les rapporteurs pour leurs recensions ; il s’associe aux éloges concernant la thèse sur Jean-Paul Laurens, qu’il qualifie de très remarquable. Il est ensuite procédé au vote : le prix de Champreux est décerné à François de Vergnette ; le prix du professeur Michel Labrousse est attribué à Fabien Colléoni.
L’ordre du jour appelant les communications, le Président cède la parole à Maurice Prin et Bruno Tollon, qui interviennent pour évoquer Les chapelles funéraires du XVIe siècle aux Jacobins de Toulouse.
Le Président remercie les intervenants. Il rend hommage au travail de Maurice Prin, qui s’est voué depuis plus de cinquante ans à l’histoire du couvent des Jacobins, suivant les chantiers de restauration et accumulant les observations sur le monument en même temps qu’il explorait documentation graphique et sources écrites. Louis Peyrusse souligne l’aspect surprenant, révélé par la communication, que l’église des Jacobins présentait avant les restaurations des dix-neuvième et vingtième siècles : on a du mal à imaginer cet édifice aujourd’hui homogène entouré des chapelles adventices ajoutées dans le deuxième quart du XVIe siècle. Puis il interroge Bruno Tollon sur l’identité des artistes auxquels ont fait appel les Bernuy, Lopez et Saint-Étienne (San Esteban), nouveaux riches castillans qui s’étaient établis à Toulouse pour leurs affaires et qui firent de l’église des Dominicains le lieu privilégié de leurs dévotions. Bruno Tollon répond que l’on est assez mal renseigné pour la période 1510-1530 ; pour les années 1540, on sait que le retable représentant saint Jérôme au désert avec le lion a été sculpté par Nicolas Bachelier, puis peint par Bernard Nalot en 1543. Louis Peyrusse se demande s’il ne serait pas possible de tenter une restitution par infographie de ce retable, à partir notamment de l’iconographie de gravures italiennes.
Le Président donne la parole à Jean-Luc Boudartchouk pour une communication brève concernant les lacs des Tectosages :
« Les "lacs sacrés" des Tectosages ont-ils jamais existé ?
Les fameux "lacs" des Tectosages / Tolosates hantent la littérature toulousaine depuis la fin du Moyen Âge ; de nombreuses études leur ont été consacrées à l’époque moderne et contemporaine où l’on s’est efforcé de (re)découvrir leur emplacement. Ces "lacs" en sont graduellement venus à composer l’un des éléments – le plus
M.S.A.M.F., t. LXI, p. 235
pittoresque – du paysage antique du Toulousain tel que l’on se le représente. Effectuons un bref "retour aux sources".
C’est Strabon, dans une longue dissertation sur les Tectosages (Géographie IV, 1, 13) qui nous transmet la fabuleuse histoire des "lacs" ou des "étangs sacrés" (limnai) de Toulouse où était déposée avant leur pillage par Caepio une partie des trésors des Toulousains. Il affirme, à la suite de Posidonius d’Apamée, que "les richesses trouvées à Toulouse faisaient quelque 15000 talents, déposées les unes dans des sanctuaires, les autres dans des étangs sacrés (limnai), et qu’il s’agissait d’or et d’argent non travaillé, mais à l’état brut" ; plus loin, Strabon revient sur ce sujet si exotique pour lui : "(...) il y avait en maints endroits de la Celtique des dépôts sacrés. C’étaient surtout les lacs (limnai) qui leur assuraient l’inviolabilité et l’on y jetait de grandes masses d’argent et d’or. Maîtres du pays, les Romains mirent en vente les lacs au bénéfice de l’État et nombre des acquéreurs y trouvèrent des meules d’argent martelé. À Toulouse aussi le sanctuaire était sacro-saint, en grande vénération auprès des habitants (...)" (traduction de L. Lerat, La Gaule romaine - 249 textes traduits du grec et du latin, Paris, 1977, n° 11). Strabon est le seul auteur grec de l’Antiquité à faire mention de ces limnai, sans équivalent par ailleurs. Les autres auteurs anciens qui ont traité du pillage des trésors des Tectosages par Caepio en 106 avant notre ère (Aulu-Gelle, Dion Cassius, Orose) ne mentionnent pas ces "étangs sacrés". Seul Justin – d’après Trogue-Pompée –, parle d’un tolosensem lacum, lieu où avait été placé le trésor sacré issu du pillage de Delphes par les Tectosages. Il faut attendre Nicolas Bertrand (1515) pour voir ressurgir le souvenir des "lacs" des Tectosages : l’auteur, qui cite les sources antiques (Posidonius et Timagène, donc Strabon), parle de consecratis lacubus. Bertrand se fait par ailleurs l’écho d’une tradition situant un lac sous Saint-Sernin, alors qu’à cette époque le "temple d’Apollon" des Tectosages était le plus souvent identifié à l’église de la Daurade. Ces différentes légendes et traditions s’entremêlent rapidement et dès le milieu du XVIe siècle, on situe le "lac au trésor" des Tectosages, (parfois associé à un "gouffre" ou un "abîme") soit sous Saint-Sernin, soit sous la Daurade. Au siècle suivant, le pillage des "lacs" va devenir un thème historique et iconographique très prisé et répandu, phénomène qui a abouti à accepter sans discussion la réalité archéologique des "lacs" dont on a voulu – encore très récemment – voir les traces en plusieurs points réputés "humides" des environs de Toulouse.
Or, l’existence des "lacs" ne repose que sur un unique témoignage écrit : Strabon et ses limnai (les sens habituels du mot étant : eau stagnante, marais, étang, lac, lac creusé de main d’homme). Le "lacus" de Justin peut en effet avoir une toute autre signification, notamment désigner une structure destinée au stockage, voire une fosse bâtie ou non. Seul le terme limnai implique la présence d’eau stagnante, sauf à supposer que le mot ait un sens particulier et inhabituel chez Strabon. Ici se pose le problème des sources utilisées par Strabon : limnai est-il un terme déjà présent dans le récit que fait Posidonius du sac de Toulouse ? Au-delà, quelles ont été les sources de Posidonius qui écrit une dizaine d’années après les événements : sources latines sans doute, orales et / ou écrites ? Le fait que Trogue-Pompée, contemporain de Strabon, parle d’un seul lacus (dans le sens vraisemblable d’un lieu de dépôt protégé) et non de paludes, ce qui eût été la traduction fidèle de limnai, permet de s’interroger sur la nature réelle de ces lieux (ou de ces structures) qui protégeaient les richesses des Tectosages disposées pour partie dans les sanctuaires, pour partie dans les "lacs", ces "lacs" qui, à bien lire Strabon, ne sont pas l’apanage de Toulouse mais bien du territoire des Tectosages, voire même de la "Celtique" (cf. supra). Il serait déraisonnable d’envisager un "culte des lacs" généralisé qui traduirait une singulière volonté d’immerger des métaux précieux appartenant aux dieux et / ou au trésor public.
Au contraire, si l’on émet l’hypothèse que le terme latin lacus soit en fait plus proche que limnai de la réalité archéologique de ces dépôts de valeurs, on peut envisager qu’il s’agisse de dépôts réalisés dans des fosses. Cette traduction de lacus (qui a sans doute également alimenté les légendes médiévales évoquant des "gouffres") permet de rendre très cohérente la description de Trogue-Pompée ; son application au texte de Strabon ne crée par ailleurs aucune incohérence : des dépôts souterrains permettent d’assurer à la fois le stockage (donc la disponibilité) et la protection des valeurs... à l’évidence mieux que des "lacs"...
Bien sûr et surtout, si les "lacs de Toulouse" ne sont simplement – et de façon banale – que des dépôts en fosse de richesses, cela permet d’aller à la rencontre d’une réalité archéologique bien connue pour la Gaule de la fin de l’Âge du Fer... notamment pour le Toulousain où l’on connaît des dépôts en fosse de métaux précieux mais également les fameux fosses et puits ("rituels" ou "funéraires" selon les chercheurs), usage tectosage spectaculaire dont l’épicentre est situé, dans l’état actuel des connaissances, à Vieille-Toulouse.Jean-Luc Boudartchouk,
avec la collaboration de Philippe Gardes et François Quantin »
Louis Peyrusse remercie l’intervenant pour cette relecture d’un passage problématique de la Géographie de
M.S.A.M.F., t. LXI, p. 236
Strabon (livre IV, 1, 13), puis il fait appel aux questions. Répondant à Jean Vézian, Jean-Luc Boudartchouk dit que Michel Labrousse avait bien vu que les « lacs sacrés » de Toulouse, ou de Vieille-Toulouse, constituaient un problème. Bruno Tollon note le traitement très idéologique de cet épisode historique : les vainqueurs civilisateurs sont présentés comme des pilleurs de trésors. Jean Nayrolles fait quant à lui observer que l’erreur possible d’interprétation (des fosses prises pour des lacs ?) est très intéressante pour ce qu’elle révèle des systèmes de représentations mentales ; le mythe de l’or volé des Tectosages renvoie à l’un des thèmes permanents de l’imaginaire : l’or maudit.
Pour terminer, Maurice Scellès fait part d’une invitation que Bertrand Ducourau adresse aux membres de la Société, qui pourront se rendre à l’église Notre-Dame-du-Taur pour y voir la restauration des peintures murales.
SÉANCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2001
Elle se tient dans la grande salle de l'Hôtel d'Assézat.
Allocution du Président.
Rapport sur le concours présenté par Jean Nayrolles : M. François de Vergnette reçoit le prix de Champreux et M. Fabien Colléoni le prix du professeur Michel Labrousse.
Conférence de Laurent Macé : Les comtes de Toulouse.
SÉANCE DU 24 AVRIL 2001
Présents : MM. Peyrusse, Président, Coppolani, Directeur
honoraire, Cazes, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier, Scellès, Secrétaire
général, Cabau, Secrétaire-adjoint, Latour, Bibliothécaire-Archiviste ; Mmes
Cazes, MM. l’abbé Baccrabère, Bordes, Hermet, le Père Montagnes, MM. Nayrolles,
Prin, Tollon, membres titulaires ; Mmes Blanc-Rouquette, Fronton-Wessel, Jimenez, MM.
Manuel, Testard, membres correspondants.
Excusés : Mme Napoléone, MM. Burroni, Cranga, Mgr Rocacher.
Le Secrétaire-adjoint donne lecture du procès-verbal de la
dernière séance, qui est adopté après quelques compléments.
Le Président rend compte de la correspondance manuscrite. M. Forichon
nous communique deux photocopies de documents conservés parmi les archives de la famille
de Lassus, qui pourraient être utiles à l’histoire de la vallée d’Aure. M.
Péchoux nous adresse son « compte rendu de la présentation des publications des
académies et sociétés de l’Union au forum du Congrès du C.T.H.S. les 11-13 avril
2001 ».
Puis le Président fait circuler dans l’assemblée
l’argumentaire des journées du patrimoine de l’automne prochain, dont le thème
sera cette année « Associations et patrimoine », et l’annonce de la
manifestation organisée à l’occasion de l’édition d’un timbre-poste
consacré aux peintures des enfeus de l’Hôtel de Malte.
Le Président offre à la Société une photographie d’Eugène
Delon, prise vers 1860, représentant la restauration du « donjon du
Capitole » avant la démolition de la grande vis des archives.
Le Secrétaire général rend compte de la réunion
qui a eu lieu entre, d’une part, deux représentants de la société Arthur Andersen,
et d’autre part, M. Paul Féron, pour l’Académie des Sciences, et lui-même
pour la Société archéologique. La société Arthur Andersen a en effet accepté, dans
le cadre de ses actions de mécénat, d’apporter ses conseils pour
l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’informatisation des
bibliothèques des Académies et Sociétés savantes de l’Hôtel d’Assézat.
Le Président donne la parole à François Bordes pour un rapport sur
l’évolution des coûts d’édition de nos Mémoires. La discussion qui
s’ensuit fait apparaître que le maintien à un niveau raisonnable de la dépense
consentie pour l’édition des Mémoires passe par la maîtrise du nombre de
pages, qui doit être absolument limité à 300.
La parole est alors à Anne-Laure Napoléone et Olivier Testard pour une communication consacrée à la maison médiévale de la rue Croix-Baragnon à Toulouse, dont l’étude a paru à l’automne dernier (A.-L. Napoléone, Olivier Testard, « Étude archéologique des élévations de la maison n° 15 de la rue Croix-Baragnon à Toulouse », dans Archéologie médiévale, t. 29, 1999, p. 145-168) :
M.S.A.M.F., t. LXI, p. 237
TOULOUSE, N° 15 RUE CROIX-BARAGNON, PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE.
En noir : maçonneries médiévales ; hachures croisées : reprises du XVIe siècle ; hachures simples : reprises du XVIIe siècle ; semis de points : aménagements du XVIIIe siècle ; en blanc : aménagements des XIXe et XXe siècles ; A : limite nord de la cave. Relevés et dessin O. Testard.
« Étude archéologique de la maison n° 15 de la rue Croix-Baragnon à Toulouse
À l’occasion de récents travaux, la plus célèbre des maisons médiévales toulousaines a fait l’objet d’une étude détaillée. L’analyse archéologique des maçonneries a permis de retracer l’histoire de la construction et des modifications opérées jusqu’à nos jours. La maison de la rue Croix-Baragnon, édifiée au début du XIVe siècle, a été bâtie sur les caves d’un bâtiment antérieur. La récupération de cette structure a sans doute conditionné l’organisation des constructions sur une parcelle exiguë. En effet, cet édifice était composé de deux corps de bâtiment accolés (double profondeur) parallèles à la rue et qui donnaient à l’arrière sur une cour. Le corps de bâtiment sur rue s’élève sur l’emprise de la cave. Bâti en briques, il se terminait probablement par un deuxième étage en pan de bois. Le corps de bâtiment sur cour, intégralement en bois, était porté par des poteaux afin de laisser le rez-de-chaussée dégagé et en continuité avec la cour. Les grandes arcades du rez-de-chaussée révèlent la fonction marchande de ce niveau qui communiquait aussi directement avec la cour. Le sens des portes conservées sur le mur de refend indique clairement la façon dont s’organisait la circulation à l’intérieur de la maison. L’accès aux parties privées se faisait par le grand portail de pierre qui donnait dans un couloir qui menait à la cour où se trouvait certainement l’escalier. Celui-ci conduisait au premier étage à un couloir qui traversait le corps de bâtiment sur cour pour déboucher côté rue dans la salle par une porte dont la taille signale un accès principal. La pièce était équipée d’une grande cheminée placée sur le mur de refend. Ses murs étaient recouverts d’un enduit uni ponctué d’un faux appareil de briques sur les arcs des baies. Cette salle, noyau de la demeure, redistribuait vers les parties arrières, dont une chambre et un escalier en vis interne qui menait aux étages supérieurs. La chambre a reçu un décor plus recherché composé de rosaces à quatre feuilles cernées de noir et mises en relief par des dégradés de rouge. Au XVIe siècle, une première campagne de travaux amène la modification du plafond de la grande salle, et des planchers de la
M.S.A.M.F., t. LXI, p. 238
TOULOUSE, N° 15 RUE CROIX-BARAGNON, CROQUIS DE L'ÉTAT DU XIVe
SIÈCLE,
vu de la rue. Dessin O. Testard.
TOULOUSE, N° 15 RUE CROIX-BARAGNON, CROQUIS DE L'ÉTAT DU XIVe
SIÈCLE,
vu de la cour. Le semis de points matérialise l'emprise de la peinture murale de
la chambre. Dessin O. Testard.
M.S.A.M.F., t. LXI, p. 239
|
TOULOUSE, N° 15 RUE CROIX-BARAGNON, PEINTURE du corps arrière. |
|
|
TOULOUSE, N° 15 RUE CROIX-BARAGNON, CROQUIS DE L'ÉTAT DU XVIe
SIÈCLE, |
TOULOUSE, N° 15 RUE CROIX-BARAGNON, CROQUIS DE L'ÉTAT DU XVIIe
SIÈCLE, |
M.S.A.M.F., t. LXI, p. 240
partie arrière dont l’importante surélévation impose l’agrandissement des portes du mur de refend. Par ailleurs, les murs mitoyens sont doublés pour recevoir de grandes cheminées. L’une d’elles est encore conservée dans la salle. Une nouvelle importante campagne se déroule durant le XVIIe siècle. Le corps arrière est entièrement rebâti en briques et tout le système de distribution renouvelé. Les niveaux des planchers sur cour sont une nouvelle fois modifiés. L’aménagement d’un entresol au rez-de-chaussée entraîne de nouveaux percements en façade principale. Le deuxième étage en pan de bois est supprimé. Ce furent les dernières transformations avant la reconstruction d’un deuxième étage sur rue en 1923, date à laquelle furent classées les belles fenêtres médiévales de la salle que les siècles précédents avaient pris soin de conserver. Les travaux de réhabilitation qui touchèrent l’édifice en 1998, après son classement en totalité, ont tenté de restaurer la façade nord au plus près de son état médiéval tout en proposant aux nouveaux habitants le confort d’une demeure contemporaine.
Anne-Laure Napoléone et Olivier Testard »
Le Président remercie Anne-Laure Napoléone et
Olivier Testard et souligne tout l’intérêt de cet extraordinaire reportage
photographique des travaux, comme celui des écorchés qui accompagnent la démonstration.
Après avoir dit que la question était sans doute naïve, il demande où se trouvait
l’escalier médiéval par rapport à l’aula. Anne-Laure Napoléone et
Olivier Testard répondent qu’il faut le situer dans la cour, mais qu’aucune
trace ne vient confirmer l’hypothèse qui est déduite de l’analyse
archéologique de l’édifice. En outre, la profondeur de la parcelle au Moyen Âge ne
peut être déterminée, l’étendue de la cour actuelle correspondant à l’état
du XVIIe siècle.
Le Président s’étonne de la restitution d’un niveau en
pan-de-bois au-dessus d’un étage en brique aussi soigné et orné de sculptures.
Anne-Laure Napoléone confirme que de telles constructions ne sont pas exceptionnelles.
Puis le Président s’étant interrogé sur la grande hauteur du rez-de-chaussée,
double de celle de l’étage, elle cite un exemple semblable à Figeac où le
rez-de-chaussée comportait cependant un niveau d’entresol, Olivier Testard y
ajoutant un exemple de la maison des Trois-Nourrices à Narbonne, où un sondage de 1,50 m
n’a pas permis de trouver le sol d’origine alors que le rez-de-chaussée
présente déjà une hauteur respectable.
Relevant que le logis est double au XVIIe
siècle, Bruno Tollon s’interroge quant à la restitution proposée pour l’état
médiéval. Anne-Laure Napoléone précise que les preuves sont claires d’un mur de
fond en extérieur en rez-de-chaussée et en intérieur à l’étage. Ne faut-il pas
penser à une galerie ? Olivier Testard et Anne-Laure Napoléone répondent que les
peintures et surtout la cloison imposent de restituer des pièces sur la partie arrière
de l’étage.
Le Président demande ce que l’on sait du statut social des
propriétaires. Anne-Laure Napoléone indique que la demeure appartient au XVe
siècle à un conseiller au Parlement et fait remarquer que l’édifice
se place dans une gamme qui n’est pas celle de l’hôtel Maurand. Maurice
Scellès note que la maison se trouvait cependant sur l’un des grands axes de la
ville médiévale et que les contraintes parcellaires ont sans doute été importantes.
Répondant à une question de Quitterie Cazes, Olivier Testard explique
que la structure très solide de la cave a sans doute été imposée par les risques
d’affouillement du côté de la rue. Le Président l’interroge alors sur les
poutres et planchers du Moyen Âge conservés en place. Olivier Testard précise que le
plancher du premier étage subsiste, entièrement caché parce qu’il s’est
affaissé avant le XVIIe siècle et qu’il a fallu le
doubler pour rétablir un sol horizontal.
Daniel Cazes demande ce qu’il faut penser des représentations
héraldiques du décor sculpté. Anne-Laure Napoléone dit que les recherches faites dans
ce domaine n’ont donné aucun résultat et qu’elle incline aujourd’hui à
n’y voir qu’un ornement. Guy Ahlsell de Toulza rappelle que l’héraldique
de cette époque est très mal connue ; il ajoute que, pour lui, l’atelier qui a
réalisé le décor de la rue Croix-Baragnon est celui qui a sculpté les chapiteaux de
Notre-Dame-du-Bourg à Rabastens, où figurent également des blasons dont les meubles
diffèrent sans qu’il soit possible d’établir de quelconques correspondances.
Daniel Cazes fait remarquer le curieux mélange de styles, que
l’on pourrait être tenté d’attribuer à des périodes différentes, que
présente la frise sculptée. Guy Ahlsell de Toulza évoque la frise de la chasse de la
maison dite du Grand Veneur à Cordes, dont le sens nous échappe, et note que celle de la
rue Croix-Baragnon n’était pas lisible de la rue ; puis il s’interroge sur
la signification que pouvait avoir vers 1300 l’emploi de formes que l’on
pourrait dater des années 1240. Maurice Scellès y voit la marque de l’attachement
de Toulouse à des formes anciennes. Anne-Laure Napoléone et Olivier Testard rappellent
que les édifices conservés sont néanmoins très peu nombreux.
M.S.A.M.F., t. LXI, p. 241
VISITE DU 11 MAI 2001
Restauration des peintures murales de Notre-Dame-du-Taur à Toulouse.
Présents : MM. Peyrusse, Président, Cazes, Directeur, Scellès, Secrétaire général, Cabau, Secrétaire-adjoint ; Mme Pradalier-Schlumberger, M. Nayrolles, membres titulaires ; Mmes Blanc-Rouquette, Pujalte, MM. Burroni, Mange, Manuel, Salvan-Guillotin, Testard, membres correspondants.
Les membres qui ont pu être avertis à temps et ont pu se libérer se retrouvent à 11 heures à l’église Notre-Dame-du-Taur. Au nom de la Société, le Président dit le bonheur que nous avons d’être aujourd’hui devant ces peintures presque oubliées. Il remercie M. Jean-Marc Stouffs, le restaurateur, d’avoir accepté de nous accueillir sur son chantier, et M. Bertrand Ducourau qui, au nom de la conservation régionale des Monuments historiques, a souhaité que les membres de la Société Archéologique du Midi de la France puissent juger du travail accompli sur ce chantier exemplaire.
Jean-Marc Stouffs présente l’historique des restaurations de la peinture, tel qu’il a pu être établi à partir de la documentation conservée et de l’examen de l’œuvre elle-même :
« C’est en 1872, à l’occasion de travaux de rénovation de l’église du Taur, que la peinture murale datée du début du XIVe siècle, située sur le côté sud de la troisième travée, est découverte derrière des boiseries du XVIIe siècle. Il s’agit d’une représentation de la généalogie de Jacob par trente-huit figures portant chacune un phylactère, réparties sur deux registres superposés. Il est fait état à ce moment-là d’une "conservation relativement bonne de ces peintures" que l’on souhaite "non seulement conserver, mais restaurer et harmoniser avec les peintures décoratives qu’on exécute en ce moment" (Congrès archéologique de France, XLIe session, Agen-Toulouse 1874, Paris, 1875, p. 400).
C’est à cette même époque que le peintre Joseph Engalière réalise un relevé aux dimensions de l’original, conservé actuellement au musée des Augustins.
À nouveau recouverte par un lambris de style gothique en partie amovible, et retiré après 1958 par l’architecte M. Stym-Popper, elle est restaurée par l’atelier Malesset (Robert Mesuret, Les peintures murales du sud-ouest de la France).Une première tranche de travaux de restauration, du mois de janvier au mois d’avril 2001, a révélé la complexité de ces peintures murales, compte tenu de la diversité des matériaux utilisés lors des différentes interventions qui se sont succédé depuis leur découverte.
Étude des peintures murales
Support de la couche picturale :
Les analyses montrent que c’est un enduit composé principalement de quartz et de calcite avec des feldspaths et de la kaolinite. Il s'agit donc d’un enduit de sable et chaux à la surface duquel on peut remarquer le scintillement de grains de mica. Il n’excède pas 1 à 1,5 centimètre et est appliqué sur un mur de brique.
Nous n’avons pas trouvé de traces de reprise d’enduit pouvant indiquer la présence de giornate ou pontate. Certains résultats d’analyses sembleraient indiquer la possibilité d’un fond, passé à la surface de l’enduit, à base de blanc de plomb.
Des décollements conséquents du support mur sont présents au registre supérieur, particulièrement au deux tiers de sa hauteur. Des lacunes importantes de mortier sont réparties sur toute la surface ainsi qu’un grand nombre de trous de petites et moyennes tailles, souvent consécutifs à la présence de clous ou de morceaux de fer plantés dans le mur.
Dans l’ensemble la cohésion du mortier est bonne, à l’exception des bords de lacunes où il a tendance à s’effriter. L’analyse des sels montre la présence de sulfates consécutifs aux rebouchages réalisés au plâtre lors de la restauration du XIXe.Couche picturale :
Les personnages, le plus souvent de face ou de trois quarts, sont dessinés d’un trait à l’ocre rouge pour les carnations : mains, visages, ainsi que les mèches de cheveux, tandis que les vêtements et les phylactères sont
M.S.A.M.F., t. LXI, p. 242
TOULOUSE, NOTRE-DAME-DU-TAUR, peinture du mur sud : Jessé et David après restauration.
Cliché Jean-Marc Stouffs.TOULOUSE, NOTRE-DAME-DU-TAUR, peinture du mur sud : Jessé et David après restauration.
Cliché Jean-Marc Stouffs.cernés d’un trait noir. Le traitement de l’ombre et de la lumière au niveau des plis des robes, parfois soulignés par un rehaut de blanc, marque un réel souci de traduire le modelé.
Il est par ailleurs remarquable que la façon dont les phylactères sont tenus et se répondent anime cette composition d’une sorte de danse introduisant le mouvement dans la composition.
Les étoiles visibles sur le fond du registre haut comportent des traces d’or ainsi que les couronnes des personnages. On remarque un repentir sur le personnage portant le phylactère avec l’inscription Iesse autem genuit David regem. Initialement il portait une couronne dont l’or est perceptible sous la chevelure.La palette des pigments est variée et importante. Parmi les couleurs étudiées, nous avons :
Rouge
Mélange de cinabre et hématite
Bleu
Mélange d’azurite et chalcanthite
Ocre rouge
Hématite
Noir
Charbon de bois (?)
Vert
Non étudié
Ocre jaune
Non étudié
Orange
Minium (?)
Blanc
Blanc de plomb
Blanc de zinc
Lithopone (pigment du XIXe s.)
M.S.A.M.F., t. LXI, p. 243
Nous constatons une différence de conservation entre le registre haut et le registre bas de la peinture. La partie basse se trouvant à portée de mains, des frottements, des dépoussiérages ou des nettoyages ont probablement occasionné une usure plus importante. Si l’on excepte cette usure, et la probable disparition de couleurs plus fragiles passées en couche plus mince, dont on peut parfois percevoir des traces sur certaines robes, la couche picturale offre une cohésion et une solidité satisfaisantes, montrant la qualité technique de l’exécution de ces peintures.
Liants :
L’analyse des liants montre la présence de nombreux matériaux à la surface de ces peintures. Nous sommes en présence à la fois d’huile, de cire, de résine et de colle, parfois mélangées.
Ces produits proviennent probablement de l’intervention du XIXe, où la cire et la colle peuvent avoir servi de fixatif, et où l’huile et la résine correspondent aux repeints confirmés par la présence de lithopone et les recherches documentaires.
L’intervention la plus récente reprend visiblement celle du XIXe dégradée, en remplaçant les enduits de plâtre endommagés par un matériau à base de chaux fortement hydraulique (mélangée à du ciment ?), et par une restitution picturale.Conservation / Restauration
La restauration actuelle consiste essentiellement en une "dé-restauration", par la purge des anciens rebouchages rendue nécessaire pour une meilleure conservation de l’enduit original, par un nettoyage de la couche picturale et par l’enlèvement des repeints qui altéraient la vision des peintures.
Les décollements d’enduit sont traités par injection de coulis de mortier. Les lacunes de grande surface ne permettant pas de reconstitution sont fermées par un enduit de sables colorés et chaux aérienne en harmonie avec le fond de la peinture.
Après rebouchage des trous de petites et moyennes dimensions par un enduit blanc à base de chaux et poudre de marbre, la réintégration picturale se fait à l’aide de la technique du tratteggio (juxtaposition de traits verticaux de différentes couleurs), permettant de différencier la peinture originale de la retouche.Une seconde tranche de travaux, programmée pour l’année 2002, permettra de compléter l’étude de cette peinture murale et d’achever sa restauration.
Jean-Marc Stouffs »
Jean-Marc Stouffs explique encore que la peinture est en partie une fresque, complétée par un travail a secco et l’application de feuilles d’or pour les couronnes et les étoiles du fond. Des analyses chimiques ont permis de déterminer la plupart des pigments utilisés. Le nettoyage a fait découvrir le blason de l’angle inférieur droit, de gueules à trois têtes, identique à ceux qui marquent les trois autres angles, et un repentir sur l’un des personnages dont la couronne a été effacée et masquée par une chevelure peinte avec le rouge avec lequel on était en train de tracer les inscriptions des banderoles.
Le Président exprime sa surprise devant la très
grande qualité de cette peinture. Jean-Marc Stouffs partage ce jugement : si le
dessin des mains est assez maladroit, les visages et le traitement en volume des drapés
font montre d’une certaine préciosité et d’une grande finesse.
Après avoir fait remarquer le motif de la bordure qui donne
l’impression d’une fausse tapisserie, le Président demande pourquoi seule la
moitié du panneau a été restaurée. Jean-Marc Stouffs explique qu’en raison de
problèmes financiers, il a été décidé de répartir le chantier sur deux exercices, la
restauration devant être achevée l’année prochaine.
Quant à la datation, Jean-Marc Stouffs rappelle que Maurice Prin situe
la réalisation de la peinture au début du XIVe siècle, par
comparaison avec le décor des chapelles des Jacobins, ce que confirme Michèle
Pradalier-Schlumberger en évoquant les relations établies avec la Catalogne ou
Pampelune. L’atelier n’est pas encore italianisant comme le seront ceux
d’Avignon ou celui de la chapelle Saint-Antonin.
Dominique Watin-Grandchamp ayant attiré l’attention sur le décalage vers la droite du panneau peint, Louis Peyrusse suppose que sa position était en relation avec le banc d’œuvre. Dominique Watin-Grandchamp et Daniel Cazes ajoutent qu’une chaire pouvait se trouver sur le côté gauche.
M.S.A.M.F., t. LXI, p. 244
À court de superlatifs pour exprimer son admiration devant la qualité de la restauration, le Président exprime son souhait de voir notre Compagnie revenir l’année prochaine, et il remercie Jean-Marc Stouffs pour ses explications très complètes et l’amabilité de son accueil.
| Séances du 3 octobre 2000 au 23 janvier 2001 | Séances du 20 février 2001 au 11 mai 2001 |
| Séances du 15 mai 2001 au 19 juin 2001 | |
© S.A.M.F. 2000-2001. La S.A.M.F. autorise la reproduction de tout ou partie des pages du site sous réserve de la mention des auteurs et de l'origine des documents et à l'exclusion de toute utilisation commerciale ou onéreuse à quelque titre que ce soit.